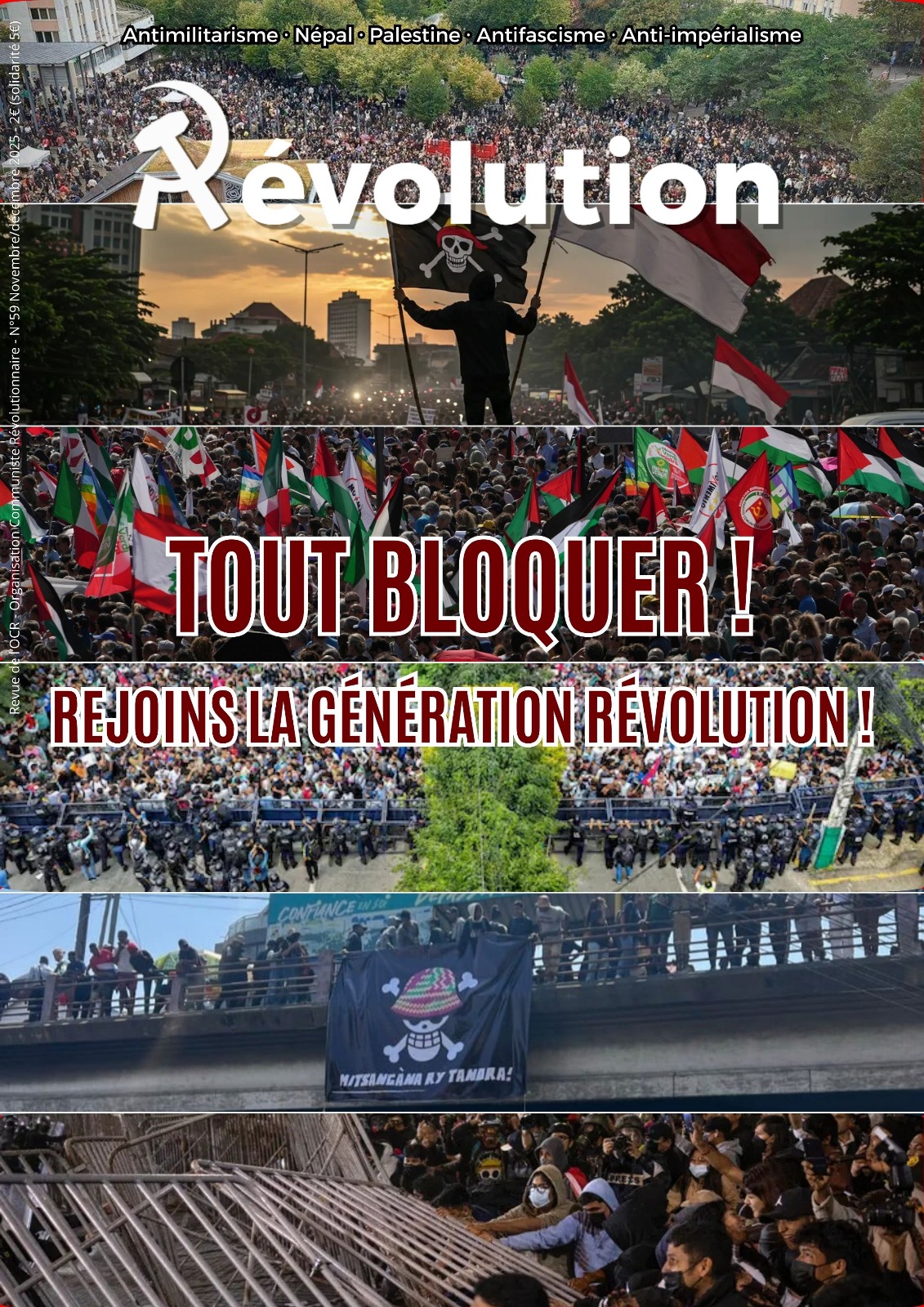Bien avant la proclamation de l’État d’Israël (14 mai 1948), le rêve sioniste de former un État qui protégerait les Juifs en insufflant une nouvelle vie à la terre sacrée d’Israël n’avait produit qu’un cauchemar. « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre » – le slogan adopté sous diverses formes par la propagande sioniste – était une mystification de la situation réelle de la Palestine, effaçant complètement la présence gênante des Palestiniens, qui peuplaient cette terre.
La direction sioniste, cependant, comprenait trop bien qu’un conflit avec la majorité arabe pour le contrôle de la Palestine était inévitable. David Ben-Gourion, le premier dirigeant de l’État nouveau-né d’Israël, disait, dès 1919, lors d’une réunion d’un organisme dirigeant sioniste : « Tout le monde voit une difficulté dans la question des relations entre Arabes et Juifs. Mais tout le monde ne voit pas qu’il n’y a pas de solution à cette qestion. Aucune solution! Il y a un fossé et rien ne peut le combler […] Je ne sais pas quel Arabe acceptera que la Palestine appartienne aux Juifs. Nous, en tant que nation, voulons que ce pays soit le nôtre; les Arabes, en tant que nation, veulent que ce pays soit le leur. » (cité dans B. Morris, Righteous Victims, p.91)
Du point de vue des dirigeants sionistes, chaque colon qui mettait les pieds en Palestine représentait un soldat de plus dans la guerre pour la conquête de leur terre. Chacune de leurs actions visait à créer les conditions qui leur permettraient de chasser la majorité de la population arabe de la Palestine et de provoquer la naissance de l'État d’Israël.
« La tentative de régler la question juive à travers la migration des juifs en Palestine peut maintenant être vue pour ce qu’elle est, une moquerie tragique du peuple juif », écrivait Léon Trotsky en juillet 1940, faisant référence au volte-face de l'impérialisme britannique, qui avait d’abord favorisé l’immigration juive, avant de tenter de la stopper violemment quand elle ne convenait plus à ses intérêts. Trotsky soulignait que toute solution de la question juive sur la base d’un système capitaliste pourri deviendrait un piège sanglant pour des centaines de milliers de juifs. Trotsky n’a pas vécu pas assez longtemps pour voir comment la guerre s’est terminée et comment le nouvel équilibre des forces auquel elle a donné naissance s’est répercuté sur le développement du sionisme.
Dans le nouvel équilibre des forces qui émerge de la guerre, ce qui semblait improbable est devenu possible, puis est devenu une réalité. Israël est établi sur les ruines du mandat britannique. Cependant, il naît dégoulinant de sang palestinien, à travers l’expulsion de 750 000 Palestiniens de leurs terres. Le nouvel État est fondé au prix de devoir se baser sur la répression et l’oppression systématique du peuple palestinien. Le projet sioniste s’est révélé être une utopie réactionnaire lourde de conséquences tragiques. Sa mise en œuvre inflige des plaies encore ouvertes, plus de sept décennies plus tard. Depuis sa fondation, l’histoire d’Israël a été ponctuée de guerres. La liste est longue et nous incluons seulement les guerres principales. Comme nous le verrons, Israël est né de la soi-disant « Guerre d’indépendance » de 1948-1949, connue comme la Nakba (la Catastrophe) par les Palestiniens et dans le monde arabe. S’en sont suivis la « Guerre de Suez » de 1956, la « guerre des Six Jours » de 1967, la « guerre du Yom Kippour » de 1973, ainsi que trois invasions du Liban, en 1978, 1982 et 2006, les innombrables bombardements et affrontements pendant la guerre d’usure qui a duré des décennies avec le Hezbollah au sud du Liban, et une demi-douzaine de « guerres » (c’est-à-dire principalement des campagnes de bombardements massifs à distance), contre le Hamas à Gaza. L'histoire d’Israël a été caractérisée par d’innombrables mouvements exprimant la résistance palestinienne, incluant des mouvements de masse insurrectionnels (la première Intifada en 1987-1992 et la deuxième Intifada en 2000-2003) par la population insoumise des territoires occupés en 1967.
Plutôt qu’un « refuge » pour les Juifs, la réalité concrète de la « terre promise » s’est avérée être celle d’une forteresse assiégée, entourée de peuples hostiles et d’ennemis. La classe dirigeante israélienne a habilement exploité ces guerres pour enraciner profondément une mentalité de « siège » parmi la majorité du peuple juif en Israël et parmi les partisans d’Israël dans la diaspora juive.
Terrorisme sioniste et retrait britannique
Durant la guerre, la plupart des sionistes et des nationalistes arabes avaient collaboré avec l’armée britannique. Une brigade juive de 23 000 hommes combattait sous le commandement allié. Le contingent palestinien s’élevait à 9000 hommes.
En 1944, la terre acquise par les sionistes en Palestine ne représentait pas plus de 6,6% du territoire du mandat britannique. Cependant, le sionisme avait émergé considérablement renforcé de la guerre. L’Agence juive était en fait devenue, du moins sous forme embryonnaire, un demi-État doté de sa propre économie distincte, de ses propres institutions et par-dessus tout, de sa propre armée composée de milliers d’hommes entraînés et armés par les Alliés pendant la guerre.
Une fois la guerre terminée, les dirigeants sionistes changent de tactique. Entre 1945 et 1948, la Haganah et l’Irgoun Zwaï Leoumi (la milice armée de la droite sioniste) unissent leurs forces dans des attaques contre l’occupation britannique et la population arabe.
La plus grave de ces attaques terroristes sionistes porte un coup mortel au cœur même de l’administration du mandat. Le 22 juillet 1946, l’Irgoun, sous le commandement du futur premier ministre israélien Menahem Begin, pose suffisamment d’explosifs pour faire sauter l’aile sud de l’hôtel King David à Jérusalem, où siège l'administration civile du mandat britannique. Quatre-vingt-onze Britanniques, Palestiniens et Juifs sont tués dans l’explosion et des dizaines sont blessés.
Cette soudaine escalade rend la situation insoutenable pour l’impérialisme britannique. La Grande-Bretagne, bien que victorieuse dans la Deuxième Guerre mondiale, en est ressortie affaiblie, avec son empire en lambeaux. En avril 1947, par conséquent, le Royaume-Uni annonce son désengagement de la Palestine dans l’année.
Cela déclenche un débat sur le statut de la Palestine. Le centre de gravité du pouvoir impérialiste avait changé de manière décisive en faveur de la puissance mondiale montante, les États-Unis. Ceux-ci interprètent correctement la position britannique comme un signe de faiblesse d’un empire débordé et grinçant, et commencent à utiliser le conflit judéo-palestinien comme un gourdin pour infliger des coups à l’influence de leur ancien allié au Moyen-Orient.
La résolution 181 de l’ONU passe le 29 novembre 1947 sous la pression des Américains. Le plan de l’ONU peut être résumé comme la partition de la Palestine en trois zones : un État arabe (englobant une superficie de 11 500 kilomètres carrés pour 804 000 Palestiniens et 10 000 Juifs); un État juif (14 000 kilomètres carrés pour 558 000 Juifs et 405 000 Palestiniens); et une zone (Jérusalem), placée sous contrôle international. Ce plan est bourré d’utopisme, considérant que les deux États devraient rejoindre une Union économique palestinienne et partager une monnaie, des ressources et des infrastructures (ports, bureaux de poste, chemins de fer, routes), comme si une guerre sans retenue entre sionistes et Palestiniens n’avait pas lieu depuis plus de deux décennies.
Offensive sioniste
Avec le départ des occupants britanniques, la direction sioniste réalise qu’elle a une occasion en or pour remplir le vide et dicter les conditions de la partition.
À la fin de 1947, la Haganah, l’Irgounet le Groupe Stern, maintenant réunis dans un effort commun, déchaînent une campagne de terreur avec une série d’attaques coordonnées contre des villages palestiniens faisant des dizaines de victimes civiles. Les attaques s’intensifient dans les premiers mois de 1948. À Tantura, al-Tira, Sasa, Haïfa, Hfar Husseinia, al-Sarafand, il y a des centaines de victimes palestiniennes.
Le 9 avril, l’Irgoun massacre la population du village de Deir Yassin, près de Jérusalem.La Croix-Rouge trouve 254 hommes, femmes et enfants abattus. Certains d’entre eux ont été mutilés et jetés dans leurs puits. Begin se vante publiquement du massacre.
À la suite de la campagne de terreur, amplifiée par les menaces et les rumeurs propagées par les sionistes, des centaines de milliers de Palestiniens désarmés fuient leurs domiciles, qui sont ensuite rasés pour rendre leur retour impossible. Les réfugiés palestiniens passent de 60 000 à 350 000 en un seul mois. Le terrorisme sioniste se concentre alors sur les villes : le 22 avril, Haïfa est attaquée au milieu de la nuit, faisant 50 morts et 200 blessés. Cent autres sont tués et des centaines blessés dans une attaque sioniste sur une colonne de femmes et d’enfants palestiniens essayant de fuir.
Comment expliquer une telle férocité? Le calcul cynique des dirigeants sionistes était de conquérir autant de terrain sur le sol qu’ils le pouvaient et de rendre impossible le retour de la population palestinienne : le plan consistait à terroriser les Palestiniens pour les pousser à fuir et pouvoir raser leurs maisons. Ceci, afin d’imposer une partition de la Palestine plus favorable au futur État d’Israël.
L’État d’Israël est proclamé le 13 mai 1948. Tous les dirigeants sionistes principaux ont été impliqués dans des massacres et du terrorisme à grande échelle. À cet égard, il n’y a aucune différence entre la gauche et la droite sioniste. Moshe Dayan, Golda Meir, David Ben-Gourion, Menahem Begin, et bien d’autres, les jeunes Ariel Sharon, Ytzhak Shamir et Yitzhak Rabin – les dirigeants principaux du futur État d’Israël – ont appris de leur expérience concrète dans quelle mesure ce sont les rapports de force établis avec l’acier et le feu sur le terrain qui détermine le cadre des scénarios possibles dans le domaine de la diplomatie internationale, une leçon qu’ils allaient assimiler et appliquer systématiquement dans les décennies à venir.
La Nakba
Immédiatement, le 15 mai, les armées égyptienne, irakienne, syrienne, libanaise et transjordanienne entrent en Palestine, en obtenant quelques succès militaires durant la première phase. Une trêve est proposée par l’ONU en juin et acceptée par les deux côtés, mais cela ne fait qu’aider les sionistes à s’organiser et à se réarmer.
La contre-attaque de l’armée sioniste après le 8 juillet brise la résistance des forces arabes, mal coordonnées et souvent placées sous la direction d’officiers britanniques. Les dirigeants des régimes arabes n'ont jamais abandonné les tentatives de secrètement parvenir à un accord avec les sionistes, pour promouvoir leurs propres intérêts. Abdallah, roi de Transjordanie, rencontre à plusieurs reprises Golda Meir et Moshe Dayan, pour négocier l’annexion de la Cisjordanie à son royaume (qui survient en décembre 1948), pendant que les Égyptiens occupent la bande de Gaza.
Les dirigeants sionistes sont déterminés à balayer tous les obstacles. L’envoyé de l’ONU, le comte Folke Bernadotte, ordonne à Israël le 13 septembre de réadmettre les réfugiés et de reconstruire leurs maisons. Quatre jours plus tard, il est assassiné par le Groupe Stern avec son assistant, le colonel français Sérot. L’armistice de Rhodes de 1949 sanctionne la défaite arabe, mettant fin à ce que les Israéliens considèrent comme leur « guerre d’indépendance ». Encore une fois, l’histoire écrite par les vainqueurs nie et tente de supprimer des documents officiels toute référence aux massacres et aux atrocités commises. Pour les Palestiniens, 1948 est plutôt l’année de la Nakba, la Catastrophe, une défaite qui plongera les masses palestiniennes dans un état de profonde prostration pendant plus de 20 ans.
La question des réfugiés et des « Arabes israéliens »
Sur un total de 750 000 réfugiés palestiniens, 39% fuient vers la Cisjordanie; un autre 10% finissent en Jordanie; 26% fuient dans la bande de Gaza occupée par l’Égypte, qui voit sa population doubler en quelques semaines; 14% fuient au Liban depuis le nord de la Palestine et 10% traversent le Golan vers la Syrie. Seulement quelques-uns (1% au total) s’échappent vers l’Égypte. Presque tous les réfugiés sont rassemblés dans d’énormes camps « temporaires » à la périphérie des villes, dans des conditions de dénuement total, et c’est dans de telles conditions qu’eux et leurs descendants sont restés jusqu'à aujourd'hui malgré que cette population de réfugiés se soit multipliée par huit.
En 1950, l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA en anglais) est mis en place. Depuis, d’après les chiffres de l’UNRWA, le total de réfugiés enregistrés lors du déplacement de 1948, et leurs enfants – trois générations plus tard – a atteint le nombre faramineux de 5,9 millions, et ce nombre ne prend pas en compte les réfugiés de la guerre des Six Jours de 1967. Plusieurs générations n’ont connu que ces camps et ces conditions. La plupart des réfugiés palestiniens de 1948 et leurs descendants n’ont aucun droit de citoyenneté dans les pays qui les accueillent, encore moins en Israël, et dépendent du soutien que l’UNRWA leur apporte.
La question du droit de retour des réfugiés palestiniens est au cœur de la question palestinienne. Elle ne peut pas être résolue sous le capitalisme. Seulement une révolution socialiste dans le Moyen-Orient et la mise en place d’une fédération socialiste de tous les peuples avec un droit à l’autonomie pour les minorités peuvent permettre de créer les conditions nécessaires à la guérison des blessures accumulées depuis des décennies et fournir les bases matérielles d’un règlement de la question qui pourrait répondre à toutes les doléances sans créer un autre système d’oppressions monstrueux.
Environ 150 000 Palestiniens sont restés sur leur terre à l’intérieur de la « ligne verte », le territoire occupé par Israël en 1948. Aujourd’hui, ils représentent plus de 20% de la population israélienne. L’État israélien a procédé à l’expropriation des propriétés et des terres de ceux qui ont fui, en utilisant des lois ad hoc, et porte systématiquement atteinte aux droits des Palestiniens restants avec des lois telles que la Loi sur la propriété des absents de 1950, la Loi d’acquisition foncière de 1953 et d’autres. En 1952, les Arabes israéliens (les Palestiniens à l’intérieur de la ligne verte) obtiennent la citoyenneté formelle avec la Loi sur la citoyenneté de 1952.
Cependant, jusqu’en 1966, les Palestiniens israéliens restent soumis à la loi martiale, et vivent dans un état de ségrégation avec d’énormes restrictions sur leurs déplacements, ce qui permet aux autorités israéliennes d’exproprier aussi les Palestiniens déplacés à l’intérieur du pays, les empêchant physiquement de rentrer chez eux. En quelques années, les 550 villages palestiniens qui avaient survécu à la Nakba sont réduits à 100. Plus de 25% des paysans palestiniens voient leur terre expropriée et doivent prendre refuge dans des villages « fantômes », considérés illégaux par Israël et donc périodiquement vidés par l’armée et rasés, avant d’être reconstruits plus tard. Leurs emplacements ont été effacés des cartes.
Après 1967, le gouvernement israélien allègera la pression sur les citoyens palestiniens, tentant une plus grande intégration des Arabes israéliens, tout en consolidant les conquêtes territoriales de la guerre des Six Jours : les territoires occupés de la Cisjordanie, Gaza, le Plateau du Golan et Jérusalem-Est.
La consolidation du capitalisme israélien
Pour les Palestiniens, Israël représentait un régime hostile, usurpateur de leur terre, responsable d’un génocide et de déportations massives. Pour les réfugiés juifs, qui continuaient d’affluer d’Europe, après la Shoah, et du monde arabe, où l’équilibre de coexistence entre les religions avait été brisé par l’impact sismique de la Nakba, rendant impossible pour des centaines de milliers de juifs de rester – Israël devenait de plus en plus la meilleure chance de reconstruire leurs vies détruites par la guerre et la persécution.
Entre 1948 et 1951, la population d’Israël fait plus que doubler (de 650 000 à plus de 1 400 000), et continue de croître rapidement dans les décennies suivantes, grâce à l’immigration juive. La population d’Israël atteint plus de 3 millions en 1978 et aujourd’hui a franchi la barre des 9 millions.
La bourgeoisie israélienne sioniste et l’impérialisme ont été capables d’exploiter avec un cynisme remarquable la détermination des masses juives à construire ce qu’elles considéraient comme un refuge contre la persécution. Durant les années 1950 et 1960, ils exploitent les masses de réfugiés juifs comme une main-d’œuvre bon marché, pratique et toujours renouvelable pour leurs industries et si nécessaire, comme soldats pour assurer la suprématie d'Israël sur la région. Toutefois, le développement remarquable du capitalisme israélien n’aurait pas pu arriver sans subventions et investissements américains importants (estimés à 140 milliards de dollars au milieu des années 1990, depuis 1949).
Malgré l’afflux considérable d’immigrants, au fil des années, une proportion croissante de Juifs israéliens naît à l’intérieur d’Israël : 27,7% en 1949, 44% en 1968, 57% en 1981. Aujourd’hui, 75% des Juifs d’Israël y sont nés. L’hébreu, une langue conçue par Eliezer Ben-Yehuda à la fin du 19e siècle, prend racine, de plus en plus, parmi les jeunes générations, remplaçant progressivement le Yiddish des Ashkénazes et le Ladino des Séfarades. De nombreux Israéliens de seconde génération abandonnent la langue de leur pays d’origine.
Les masses juives étaient, bien entendu, insensibles à la propagande nationaliste des régimes arabes, qui les décrivait sans discernement comme des ennemis qu’il fallait écraser. La menace militaire continue posée par les régimes arabes voisins et les tactiques de terrorisme individuel adoptées par les organisations nationalistes palestiniennes depuis la deuxième moitié des années 1960 pousse la majorité des Israéliens dans les bras de l’État sioniste. Cela aidera le sionisme à façonner une conscience nationale israélienne, basée sur la peur que les Arabes veuillent les détruire.
Le boom économique des années 1950 et 1970, amplifié par l’aide américaine, permet aux travailleurs israéliens (y compris dans une certaine mesure la minorité arabo-israélienne) d’atteindre un niveau de vie considérablement plus élevé que celui des masses arabes des pays voisins. Ces conquêtes matérielles représentaient, pour les travailleurs israéliens, un capital à défendre, surtout lorsqu’il était menacé par des attaques extérieures.
Parmi la minorité palestinienne d’Israël, bien que soumise à une forte discrimination, beaucoup étaient également conscients du sombre paysage de misère offert par les régimes arabes autocratiques et réactionnaires.
La monarchie saoudienne, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis et le reste des pays du Golfe riches en pétrole, tout en prétendant être des « amis » des Palestiniens et en finançant l’OLP, avaient l’habitude de compter sur des centaines de milliers de Palestiniens et autres pauvres travailleurs migrants pour travailler dans des conditions de semi-esclavage. Cependant, ils se gardaient bien de leur accorder des droits politiques ou syndicaux, encore moins des droits de citoyenneté et les exploitaient sans pitié. Cela durera jusqu’au début des années 1990, quand l’impact de la première guerre du Golfe poussera ces régimes à se débarrasser des travailleurs palestiniens et à se tourner vers l’Inde, le Pakistan et le Népal comme leur source principale de main-d’œuvre bon marché.
Contradictions de classe à l’intérieur d’Israël
Sans oublier ces facteurs fondamentaux qui garantissent une certaine base de soutien pour le capitalisme israélien, surtout lorsqu’il est menacé, il faut dire que la société israélienne était et est toujours profondément polarisée et loin d’être homogène.
En 1974, une enquête gouvernementale est déclenchée par les violentes manifestations des « Black Panthers » israéliens au début des années 1970. Ces manifestations étaient durement réprimées par l’État sioniste. L’enquête se penche sur les conditions des Juifs séfarades (s’installant principalement en Israël après 1948 depuis l’Afrique du Nord, l’Irak, le Yémen et le reste de l’ancien Empire ottoman), qui représentent la moitié de la population juive d’Israël.
Le rapport révèle l’existence d’un « deuxième Israël » pauvre et exploité. Quatre-vingt-douze pour cent des enfants souffrant de problèmes de malnutrition et 90% de la population carcérale juive sont d’origine séfarade; leur taux d’éducation secondaire n’est que de 17%, tandis que pour les Juifs d’origine européenne (Ashkénazes) il est de 41%; dans les universités, les jeunes Séfarades représentent 20% du total, contre 78% pour les Ashkénazes. La composition sociale séfarade est à 62% ouvrière (contre 39%) et seulement 5% bourgeoise (contre 14%). La discrimination sociale est incarnée par le faible nombre de mariages « mixtes » : seulement 17%. Ce n’est pas un hasard si la rébellion radicale de la jeunesse séfarade en Israël contre l’oppression et la discrimination est inspirée par la lutte des Black Panthers aux États-Unis.
Le capitalisme israélien est devenu de plus en plus inégalitaire au cours des dernières décennies. En 1992, les 10% les plus riches de la population s'appropriaient 27% du revenu national, tandis que les 10% les plus pauvres n’en détenaient que 2,8% (CIA, The World Factbook 1999). Les inégalités ont énormément augmenté depuis. D’après le Rapport sur les inégalités mondiales 2022, publié par le Laboratoire sur les inégalités mondiales :
Israël est l’un des pays à revenus élevés les plus inégalitaires. Les 50% les plus pauvres de la population gagnent en moyenne 11 200 euros ou 57 900 shekels, tandis que les 10% les plus riches gagnent 19 fois plus (211 900 euros, 1 096 300 shekels). Ainsi, les niveaux d’inégalités sont similaires à ceux des États-Unis, avec les 50% les plus pauvres de la population gagnant 13% du revenu national total, tandis que la part des 10% les plus riches est de 49%.
La puissance économique et militaire d’Israël s’est construite sur l’exploitation de la classe ouvrière israélienne et palestinienne, dans une mesure tout aussi grande que celle de tout autre pays capitaliste. En fait, ces chiffres montrent ce que signifie pour la classe ouvrière d’être divisée. L’État d’Israël est fondé sur l’oppression et la discrimination systémique des Palestiniens, mais cela signifie seulement une exploitation continue des Palestiniens et des travailleurs israéliens ordinaires, pendant que les capitalistes israéliens accumulent des fortunes.
Le tournant de la guerre des Six Jours
L’année 1967 marque un tournant dans l’histoire du Moyen-Orient. Jusque-là, la majorité des réfugiés palestiniens dans les différents pays arabes nourrissaient l’espoir que l’intervention des armées égyptienne, syrienne et jordanienne garantirait un jour le rétablissement des droits des Palestiniens. À l’aube, le 5 juin, après un mois d’affrontements et de tensions, l’armée de l’air israélienne lance une attaque éclair contre les bases aériennes égyptiennes et jordaniennes, détruisant plus de 90% de l’aviation militaire des deux pays avant même que leurs avions puissent décoller. Le même jour, l’armée d’Israël envahit la Cisjordanie et Gaza et, en quelques jours de combats acharnés, défait la Légion jordanienne arabe et l’armée égyptienne stationnée à Gaza. Le 6, ils conquièrent Gaza et le 7 prennent Jérusalem, complétant leur occupation de la Cisjordanie. Le 10 juin, pendant que le monde arabe reste stupéfait, Israël prend le contrôle non seulement de l’ensemble du territoire du Mandat britannique sur la Palestine, mais occupe le Golan syrien et le Sinaï égyptien, infligeant une défaite monumentale à ses ennemis arabes et causant une nouvelle vague de 300 000 réfugiés palestiniens.
La défaite désastreuse dans la guerre des Six Jours, toutefois, n’a pas le même impact démoralisant que la Nakbaavait eu sur le peuple palestinien; cette fois, c’est la colère qui prend le pas sur la démoralisation. La défaite arabe a pour effet (totalement imprévu pour les stratèges sionistes) d’effacer toute illusion qu’une intervention extérieure « arrangerait les choses ».
L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) avait été mise en place en 1964 par une décision de la Ligue arabe. Pendant ses premières années, elle n’était rien d’autre qu’un appendice de ces régimes. Cependant, elle se heurte à une opposition croissante de la part des forces issues de la résistance palestinienne, comme le Fatah, l’organisation de guérilla de Yasser Arafat, et de ceux qui, comme lui, avaient eu la chance de faire l’expérience des prisons des régimes « amis » au début des années 1960. En 1967, la formation du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) de George Habache reflète la radicalisation sous-jacente de la lutte palestinienne.
Le nationalisme arabe bourgeois est totalement démasqué et discrédité par la défaite écrasante dans la guerre des Six Jours. Parmi les Palestiniens, qui se retrouvent soudainement sous une domination israélienne directe, et parmi tous ceux qui s’entassent dans les camps de réfugiés en Jordanie, en Syrie et au Liban, se développe un terrain fertile pour la critique du nationalisme arabe et des régimes arabes. Ce ferment donne un énorme élan à la résistance palestinienne (en particulier au Fatah et au FPLP nouvellement formé), qui gagne une base massive dans les camps de réfugiés.
Le 21 mars 1968, l’armée israélienne attaque le quartier général de la résistance dans le village de Karameh en Jordanie. Les combattants du Fatah, prévenus de l'attaque, tiennent bon. L’armée israélienne ne s’attendait pas à trouver un tel niveau de résistance et doit battre en retraite. Vingt-huit soldats israéliens sont tués et 69 blessés. Plus d’une centaine de combattants palestiniens sont tués, mais cet épisode suscite une énorme vague de sympathie à travers le monde arabe parce que la résistance palestinienne a réussi là où les armées des États arabes avaient toujours échoué : ils ont vaincu l’armée israélienne pour la première fois. Alors que l’OLP se trouve en proie à des luttes intestines, la bataille de Karameh propulse le Fatah et Arafat à son sommet en février 1969.
Les régimes arabes mis à mal par la résistance palestinienne
Les réfugiés palestiniens avaient été relégués dans la misère des camps de réfugiés surpeuplés, leur population atteignant un million et demi en 1968. Ils étaient exploités par les capitalistes des différents pays comme main-d’œuvre bon marché, les soumettant à des conditions humiliantes. Mais la montée de la résistance à la fin des années 1960 redonne de la fierté aux Palestiniens, transformant les camps en sanctuaires pour les organisations de la résistance.
Cela expose les camps et les pays d’accueil à de violentes représailles israéliennes. La friction constante entre la résistance et les gouvernements des pays d’accueil est aggravée par la propagation d’idées révolutionnaires parmi les Palestiniens qui concevaient la révolution palestinienne comme faisant partie d’une révolution arabe plus générale à caractère socialiste. Ces positions, renforcées par le prestige montant de la résistance palestinienne, résonnaient avec les masses libanaises et jordaniennes.
La première crise explose en 1969 au Liban, déjà profondément fracturé par les tensions avec la minorité chrétienne maronite. Les frictions entre la résistance et le gouvernement libanais dégénèrent à l’automne 1969 en plusieurs jours de combats acharnés au cours desquels l’armée libanaise se retrouve du côté des perdants. L’accord du Caire met temporairement un terme à la confrontation.
Le septembre noir
Un processus similaire était en cours depuis un certain temps en Jordanie. Le dégoût croissant face aux liens étroits entre la monarchie hachémite de Hussein et l’impérialisme américain, combiné avec les conditions oppressives à laquelle est confrontée la grande majorité de la population, résonne avec la perspective d’une révolution palestinienne.
L’OLP s’efforce d’éviter un affrontement frontal avec le roi Hussein, mais la montée révolutionnaire des masses jordaniennes surmonte tous les obstacles. Le mouvement de masse confronte le régime jordanien, mais sans véritable direction en raison des hésitations de l’OLP. À partir de l’été 1970, une série d’affrontements entre les combattants de la résistance palestinienne et l’armée s’intensifient. Une série de détournement d’avions de ligne (PanAm, Swissair et British Airways, cependant sans pertes civiles) par le FPLP donne à Hussein l’excuse qu’il cherchait pour justifier la répression auprès d’un public international.
La résistance palestinienne prend le dessus et conquiert une grande partie de la capitale Amman en quelques semaines. Hussein nomme un gouvernement militaire le 16 septembre, qui déclenche, le 17, à l’aube, une offensive contre les camps de réfugiés palestiniens. Les unités de l’armée bédouine (moins infectées par l’humeur révolutionnaire) sous le commandement du général al-Majali bombardent les camps avec des obus au phosphore et au napalm et déploient des chars contre les quartiers ouvriers d’Amman. Malgré la disproportion des forces militaires, la résistance est si féroce que les combats durent encore presque deux semaines, forçant Hussein à chercher un accord le 27 septembre 1970. La résistance palestinienne accepte de quitter la Jordanie et de s’installer au Liban.
Le nombre exact de victimes du « septembre noir » jordanien n’a jamais été connu. Des sources palestiniennes parlent de 20 000 tués, d’autres sources de 5 à 10 000, principalement parmi la population civile.
L'attitude des dirigeants de l’OLP et d’Arafat est durement critiquée par un très grand secteur du mouvement révolutionnaire palestinien, qui était sorti des événements jordaniens en lambeaux. Face au massacre perpétré par Hussein et au silence des autres nations arabes, les sentiments dominants chez les Palestiniens sont la frustration et la colère, ce qui prépare le terrain au développement de formations terroristes extrêmes (la formation du groupe terroriste Septembre noir par exemple).
Le tournant diplomatique de l’OLP
La défaite jordanienne ne fait rien pour surmonter les limites fondamentales de la résistance palestinienne. La conception d’une lutte de libération « apportée de l’extérieur » assignait aux masses palestiniennes des territoires occupés un rôle purement passif. L’engagement de l’OLP en faveur d’une politique de « non-ingérence » dans les affaires intérieures des États arabes, paradoxalement, se renforce.
La limitation de la lutte à un cadre purement national, reportant à plus tard le problème de savoir quel type de société construire en Palestine libérée, avait permis à l’OLP de préserver une fausse unité avec les régimes arabes, mais ne l’avait pas protégé de la trahison de ces mêmes régimes chaque fois que les masses arabes avaient tenté de se libérer de leurs chaînes et que leur lutte se heurtait aux intérêts fondamentaux de leurs oppresseurs.
Sous la direction d’Arafat, l’OLP arrive, finalement, à conquérir un soutien massif parmi les Palestiniens. Cependant, face à la pression diplomatique internationale, en particulier de la part des régimes arabes, Arafat impose un virage à 180 degrés : l’idée selon laquelle la lutte de libération devait être menée par le peuple palestinien elle-même est abandonnée au profit d’une conception de la lutte armée comme instrument de pression auxiliaire dans la diplomatie internationale.
Le 6 octobre 1973, à la veille des festivités juives du Yom Kippour, l’Égypte et la Syrie attaquent Israël. L’appareil de défense israélien est pris au dépourvu et subit un coup dur. La résistance palestinienne prend part au combat dans les territoires occupés. Des unités jordaniennes, irakiennes et marocaines et un détachement symbolique tunisien participent aussi dans la guerre. Les premiers succès des forces arabes rachètent la défaite humiliante de 1967 aux yeux des masses arabes.
La guerre du Yom Kippour a un impact profond sur la société israélienne en brisant la confiance en l’invincibilité de l’armée israélienne. Cependant, l’armée israélienne finit par se réorganiser et rattraper le terrain perdu et, le 22 octobre, un armistice est conclu alors qu’Israël reprend le dessus.
Le « tournant diplomatique » se trouve renforcé. L’OLP est reconnu par la Ligue arabe comme « le seul et légitime représentant du peuple palestinien » le 27 novembre 1973. Les amendements à la Charte nationale palestinienne en mai 1974 introduisent pour la première fois la perspective d’une libération partielle de la Palestine (et la reconnaissance implicite d’Israël). Arafat est invité à prononcer un discours aux Nations Unies le 13 novembre 1974. Dans son célèbre discours, il condamne le sionisme, mais déclare : « Aujourd’hui, je suis venu avec un rameau d’olivier et un fusil de combattant de la liberté. Ne laissez pas tomber le rameau d’olivier de ma main. »
Le tournant d’Arafat permet aux régimes arabes traîtres de reprendre l’initiative, une ligne poursuivie même au prix de saper la seule force réelle de la résistance, soit les racines du mouvement parmi les masses palestiniennes.
Révolution et contre-révolution au Liban
Malgré l’expérience jordanienne et les affrontements de 1969, la résistance palestinienne au Liban prend confiance en sa force grandissante. Le Liban est déchiré par de profondes divisions entre la classe dirigeante chrétienne maronite installée par les Français et les diverses factions bourgeoises et petites-bourgeoises musulmanes.
Comme en Jordanie, le renforcement de l’autorité de la résistance palestinienne va de pair avec la montée des sentiments révolutionnaires au sein des masses libanaises. Les Palestiniens des camps de réfugiés étaient devenus une partie intégrante de la classe ouvrière libanaise. Les capitalistes libanais exploitaient leur travail depuis des années, déplaçant les camps à proximité des villes, et tentaient d’utiliser les réfugiés pour saper les puissantes organisations de la classe ouvrière libanaise. Mais ce calcul cynique mène rapidement à la fusion du mouvement de libération palestinien et des aspirations révolutionnaires des travailleurs libanais.
Le déplacement forcé de milliers de combattants de l’OLP depuis la Jordanie fait inévitablement du Liban leur principale base. Des quartiers entiers de Beyrouth deviennent contrôlés par l’OLP, qui forme un pouvoir concurrent à l’État, tout en bénéficiant d’un large soutien de la part des masses libanaises. Grâce aux fonds collectés pour soutenir la résistance, de nombreuses institutions sociales, écoles et hôpitaux fleurissent autour de l’OLP, offrant souvent un soutien de meilleure qualité que celui offert par l’État libanais. L’accès à toutes ces institutions est ouvert à l’ensemble de la population.
Au milieu des années 1970, ce fragile équilibre se brise. Une « guerre civile » est déclenchée par la classe dirigeante chrétienne maronite, l'armée et les milices phalangistes chrétiennes et leurs alliés. Il s’agit en réalité d’une guerre de classe contre-révolutionnaire visant à réaffirmer leur contrôle sur la société. Les masses libanaises et leurs organisations, telles que le Mouvement national libanais dirigé par Kamal Joumblatt, ainsi que la résistance palestinienne, devaient être écrasées. Israël intervient dans cette guerre par de fréquentes incursions au sud du Liban pour frapper la résistance.
Le 26 janvier 1975, des combattants palestiniens interviennent pour défendre la grève des pêcheurs de Sidon contre la tentative de répression de l’armée. La résistance palestinienne force l’armée libanaise à battre en retraite, laissant dix morts sur le terrain. La Phalange chrétienne brandit une main de fer contre l’OLP. En février, un député libanais pro-palestinien, Maarouf Saad, est abattu, semble-t-il par l’armée libanaise. Le 13 avril, une tentative d’assassinat sur le leader phalangiste Pierre Gemayel déclenche des représailles immédiates de la part des phalangistes qui bloquent un autobus se rendant au camp de réfugiés de Tall el-Zaatar et massacrent les 27 passagers de sang-froid, déclenchant des combats dans tout Beyrouth.
Pendant toute l’année 1975, l’attitude de l’OLP se limite à assister les milices de la gauche libanaise en leur apportant un soutien logistique et des armes. L’attentisme de l’OLP ne fait que prolonger le conflit, mais lorsque les Phalanges assiègent les camps de réfugiés de Dbayeh et de Tall el-Zaatar, les groupes de résistance armés palestiniens se voient forcés d’entrer de tout leur poids dans le conflit. Les phalangistes contre-révolutionnaires sont poursuivis dans les montagnes jusqu’à ce qu’ils soient au bord de la défaite. C’est à ce moment-là que se produit un renversement spectaculaire des positions. À l’annonce de la possible mise en place d’un gouvernement révolutionnaire de la gauche libanaise, le front arabe des « amis » de la lutte palestinienne flanche. L’Égypte et la Jordanie sont effrayées par la perspective d’une révolution se propageant dans tout le Moyen-Orient. Cependant, la trahison ouverte vient de l’endroit où l’on s’y attendait le moins. Le champion de la lutte anti-impérialiste Hafez al-Assad, président baathiste de la Syrie, effectue un revirement spectaculaire en envoyant des troupes syriennes soutenir les phalangistes en juin 1976.
L’intervention syrienne fait brutalement pencher la balance. La résistance doit se replier dans les villes au prix de lourdes pertes, tandis que les phalangistes, protégés par l’armée syrienne, assiègent de nouveau le camp de Tall el-Zaatar. Après 52 jours, le 12 août, Tall el-Zaatar se rend et les Phalanges et les Syriens se vengent en massacrant 3000 Palestiniens alors qu’ils évacuent le camp.
Le plus « progressiste » des régimes arabes, la Syrie, devant la menace, même indirecte, d’un développement révolutionnaire, n’a pas hésité à se ranger du côté de l’aile la plus réactionnaire de la contre-révolution bourgeoise contre la même résistance palestinienne dont elle hébergeait le quartier général à Damas et qu’elle avait financée pendant des années.
Les cliques dirigeantes de la Ligue arabe sont restées passives à observer la situation. Après 19 mois de guerre et 60 000 morts, le Liban est divisé en zones où les différents belligérants se retranchent dans une fragile « trêve » armée. Malgré la trahison d’Assad, la direction de l’OLP s’investit dans des négociations humiliantes pour « colmater » la brèche et recomposer le « front arabe ».
Invasions israéliennes du Liban
Pour Israël, la présence même de combattants palestiniens sur le sol libanais était intolérable. Le 14 mars 1978, Israël envahit le sud du Liban et, en quelques jours, écrase la résistance palestinienne (abandonnée par l’armée libanaise). Cependant, le président israélien Shamir décide de se retirer avant d'atteindre ses objectifs sous la pression du président américain Jimmy Carter, qui avait décidé de soutenir les négociations secrètes bilatérales entre Sadate, le président d’Égypte, et Shamir, visant à normaliser les relations entre Israël et l’Égypte. Un accord sera officiellement ratifié à Camp David le 18 septembre 1978.
Pour Israël, cependant, le problème n’est pas résolu. Le 6 juin 1982, l’armée israélienne lance une deuxième grande invasion du Liban sous le commandement d’Ariel Sharon, ministre de la Défense du gouvernement Begin. L'invasion se transforme en bain de sang. En quelques heures, un déluge de feu de l'armée de l'air israélienne s'abat sur les villes et les camps de réfugiés, tandis que des colonnes de chars avancent sur Beyrouth, laissant derrière elles une traînée de mort et de destruction : 14 000 victimes rien qu'au cours des deux premières semaines.
L’armée israélienne assiège Beyrouth Ouest dans une étreinte meurtrière de 78 jours, au cours desquels tous les approvisionnements sont bloqués et la ville est bombardée sans relâche. Sept-mille civils libanais morts et un nombre indéterminé de Palestiniens tués (dont on ne connaîtra jamais le nombre exact) ne suffisent pas à briser la résistance.
L'impasse permet à la diplomatie impérialiste d'entrer en jeu et de négocier l'évacuation complète de la résistance palestinienne du Liban. À la fin du mois d'août 1982, plus de 10 000 combattants palestiniens évacuent Beyrouth sous la surveillance d'une force franco-italo-américaine, mais le prix à payer pour préserver les structures de l'OLP est extrêmement élevé. La population libanaise et les dizaines de milliers de Palestiniens qui continuent à s'entasser dans les camps de réfugiés sont laissées à la merci de la vengeance des phalangistes, des milices chiites pro-syriennes d'Amal, de l'armée syrienne et de l'armée israélienne, avec pour seule garantie un pacte écrit dans le sable que personne n'a intérêt à respecter.
La vengeance israélienne est immédiate et terrible. Entre le 16 et le 18 septembre, dès que le contingent international « de paix » a quitté le Liban (après avoir désarmé et évacué les derniers combattants palestiniens), les phalangistes libanais, protégés par l'armée israélienne, massacrent 3000 réfugiés palestiniens sans défense en ravageant les camps de réfugiés de Sabra et Chatila, à Beyrouth, pendant 40 heures interminables.
Ariel Sharon observe l'opération du haut d'un immeuble, à 200 mètres du mur du camp de Chatila, depuis son quartier général. Comme les Syriens l'avaient fait six ans plus tôt à Tall al-Zaatar, l'armée israélienne se contente d'apporter un soutien logistique aux phalangistes, en éclairant la zone à l'aide de fusées éclairantes, en bloquant toutes les voies d'évacuation des camps, en nourrissant et en aidant les phalangistes qui se livrent au massacre.
Le massacre de Sabra et Chatila provoque une onde de choc jusqu'en Israël. Le 25 septembre 1982, une manifestation de 400 000 personnes envahit les rues de Tel-Aviv pour protester contre le rôle des soldats israéliens et de Sharon dans ce massacre. Une enquête officielle est ouverte pour désamorcer le mouvement et dissimuler le rôle des soldats de l'armée israélienne, mais même le rapport de cette enquête n'arrive pas à cacher la responsabilité personnelle d'Ariel Sharon, qui est contraint de démissionner.
La direction de l'OLP s'installe en Tunisie, où Arafat et son entourage vivent un exil doré jusqu'à ce qu'ils s'installent à Gaza en 1994. Toute leur énergie est consacrée à élaborer des stratégies de négociation et à jongler avec les rivalités entre les régimes arabes, ainsi qu'à rétablir des relations normales avec les monarchies du Golfe.
La politique de l'OLP se fonde alors de plus en plus sur la négociation, s’imaginant qu’elle peut obtenir des concessions en offrant en échange une stabilisation du Moyen-Orient. Afin d’établir un rapport de force à la table des négociations aux yeux de l'impérialisme américain et de l’Europe, Arafat s'appuie sur la Résistance, et même de plus en plus sur des tactiques terroristes individuelles (formellement condamnées par l'OLP), à mesure que la force du mouvement de résistance de masse diminue après la défaite.
Les territoires occupés à la veille de l’Intifada
Pendant les vingt années d'occupation militaire, les territoires occupés ont été pour Israël un marché supplémentaire pour ses produits et une source de main-d'œuvre non qualifiée. Un facteur important dans la décision d'occuper la Cisjordanie et le Golan a été la présence de sources d’eau de la région, qu’Israël s’est appropriées. Israël ne voulait surtout pas que les territoires développent une vie qui leur serait propre.
Le gouvernement israélien a élaboré un plan d'étranglement progressif de l'économie des territoires occupés, qui était principalement liée à l'agriculture, avec une part limitée de petit artisanat. Cette situation a mis à mal les moyens de subsistance des paysans et des ouvriers agricoles, qui ont été contraints de venir grossir les rangs des 120 000 Palestiniens qui faisaient quotidiennement la navette pour aller travailler en Israël (soit un tiers de la main-d'œuvre de Cisjordanie et 50% de celle de la bande de Gaza). L'État israélien s’est servi du fait que des milliers de Palestiniens doivent franchir la « ligne verte » quotidiennement comme une arme de représailles contre les travailleurs palestiniens, qui se trouvent sous la menace constante d'une fermeture de la frontière selon son bon vouloir.
L'économie des territoires occupés était (et est toujours) complètement dépendante d'Israël, même pour les biens de consommation de base. La politique israélienne a exacerbé l'interdépendance économique naturelle et historique des territoires avec le reste de la Palestine. En 1970, 82% des importations étaient déjà d'origine israélienne, atteignant 91% en 1987. Les centaines de milliers de Palestiniens à l'étranger ont également alimenté un flux d'envois de fonds à leurs familles, représentant 37% du PIB des territoires à l'époque. Aujourd'hui encore, ces envois de fonds représentent une part importante (environ 20%) du PIB de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Paradoxalement, cela a contribué à maintenir un marché vers lequel les excédents de production israéliens pouvaient être exportés.
Au cours des dix premières années d'occupation, le nombre total de colons n'a pas dépassé 7000. Cependant, avec l'arrivée au pouvoir de la droite sioniste du Likoud en 1977, la politique de colonisation s'est rapidement intensifiée. Au cours des dix années suivantes, 18 000 maisons et 139 colonies ont été construites sur des terres palestiniennes, pour accueillir un total de 80 000 colons. Un réseau de routes spéciales a été mis en place pour séparer les colons des Palestiniens, ce qui a eu pour effet de limiter considérablement la liberté de mouvement de ces derniers. La présence croissante des colons juifs est devenue la manifestation la plus odieuse de l'occupation.
La population palestinienne des territoires a connu une explosion démographique remarquable au cours des 20 années d'occupation. En 1987, 75% de la population a moins de 25 ans et 50% moins de 15 ans. La majorité – à la veille de l'Intifada – n'a connu que le régime de plus en plus intolérable, humiliant et oppressif de l'occupation israélienne.
L’Intifada
Quatre décennies après la Nakba et 20 ans après la guerre des Six Jours, les perspectives de la lutte nationale palestinienne sont sombres. Les mouvements révolutionnaires en Jordanie et au Liban ont été écrasés dans le sang et la résistance palestinienne, brisée. L'énorme sacrifice consenti par les masses palestiniennes dans les camps de réfugiés n'a donné aucun résultat concret. Israël a consolidé son emprise sur l'ensemble de la Palestine.
Le fossé béant entre la direction de l'OLP à Tunis et la réalité des territoires était devenu si grand que de nombreux signes d'un changement d'humeur sur le terrain n'avaient pas été détectés, même par Arafat, d'ordinaire assez clairvoyant.
Quelques mois avant l'Intifada, un rapport de l'institut West Bank Data Base du sociologue israélien Meron Benvenisti notait : « La violence est de plus en plus le fait de groupes désorganisés et spontanés [...] Entre avril 1986 et mai 1987, 3150 incidents violents ont été enregistrés, allant du simple jet de pierres aux barrages routiers, en passant par une centaine d'agressions à l'explosif ou à l'arme à feu. » La combativité croissante de la population palestinienne sous occupation se manifeste dans les journées des 5 et 6 juin, lorsqu'une grève générale souligne l'anniversaire des 20 ans d'occupation israélienne.
Le 7 décembre 1987, un événement totalement inattendu par les services secrets israéliens et les dirigeants de l'OLP se produit : un incident, semblable à beaucoup d'autres, déclenche le soulèvement spontané de dizaines de milliers de jeunes et de travailleurs contre l'occupation israélienne en plein cœur des territoires occupés, alors que les dirigeants de l'OLP avaient cessé de considérer cet endroit comme théâtre d'une potentielle lutte de masse.
Un camion de l'armée israélienne entre en collision avec une voiture civile, tuant quatre travailleurs palestiniens. Qu'il s'agisse d'un acte délibéré de représailles de la part des soldats pour l'assassinat d'un Israélien à Gaza la veille, ou d'un simple accident, cela ne fait pas vraiment de différence. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'étincelle met le feu aux matières combustibles que l'occupation israélienne accumulait depuis 20 ans.
Le mot Intifada (que l'on peut traduire par « soulèvement ») décrit bien la réaction des masses palestiniennes. Une fois déclenché, le soulèvement bouleverse en quelques heures l'équilibre des forces établi de longue date et, pendant des mois, il s'amplifie, mettant à rude épreuve les forces d'occupation. L'Intifada a également un énorme impact international et suscite le soutien des Arabes israéliens en Israël, ainsi qu'un dégoût croissant d'une partie de la jeunesse juive pour les méthodes brutales employées pour réprimer le soulèvement.
Même la répression la plus brutale se révèle inefficace. Israël a systématiquement recours aux détentions administratives sans inculpation ni procès, parfois pour une durée même d’un an. Neuf mille arrestations en quelques mois, des centaines de morts et des milliers de blessés, des démolitions de maisons et des sanctions contre les familles des personnes tuées ou arrêtées, des représailles collectives sur des villages ou des quartiers – couronnées par l'ordre donné par le ministre de la Défense israélien Rabin de « casser les bras et les jambes » de ceux qui seraient pris en train de jeter des pierres (des enfants pour la plupart) – une répression aussi impitoyable n’a aucun effet, si ce n'est d’alimenter la révolte. La lutte prend la forme de grèves générales, de barrages routiers, d'embuscades tendues aux patrouilles israéliennes par les shebabs, les garçons de la révolte, avec leurs lance-pierres. Elle prend des formes de désobéissance civile comme la grève des impôts et le refus de respecter les horaires d'ouverture des magasins décidés par les autorités israéliennes. À Jérusalem-Est, les militaires israéliens tentent en vain de forcer l'ouverture des magasins lors d'un lock-out. Les commerçants menacés ouvrent, puis referment leur boutique dès le départ des soldats.
Dès les premiers jours de l'Intifada, des comités populaires apparaissent spontanément un peu partout. Au départ, ils coordonnent des groupes de jeunes qui luttent contre les forces d'occupation, l'armée israélienne et les patrouilles de police, à l'aide de lance-pierres et de pneus enflammés. Au fur et à mesure que la lutte se poursuit, les comités populaires distribuent également des produits de base pendant les grèves et les confinements, et mettent en place des groupes chargés de surveiller les communautés. Ces organes rassemblent et organisent les jeunes et les travailleurs militants (dont la grande majorité ne faisait pas partie d'organisations préexistantes) et prennent la direction de la lutte, s'occupant de tous les aspects des besoins immédiats de la population et des tâches découlant de la lutte.
Des comités spécifiques sont chargés d'organiser les différents aspects de la lutte. Des postes de santé sont créés dans les quartiers et les villages. L'enseignement est réorganisé après la fermeture des écoles de tout niveau en février 1988 par les autorités d'occupation. Les tarifs professionnels, les loyers et les prix sont plafonnés. Les comités organisent une lutte contre le stockage des denrées, un boycottage des produits israéliens et la distribution des denrées rares; ils tentent même de répondre à la crise alimentaire par le développement de l'agriculture de subsistance et de l'élevage. Des tribunaux populaires sont mis en place. Les femmes jouent un rôle important dans le fonctionnement de cette galaxie de comités.
En raison du poids de l'occupation militaire, les comités ne peuvent pas déployer pleinement leur potentiel de pouvoir concurrent aux autorités coloniales en se coordonnant à un niveau général. Tout au long de la première phase de l'Intifada, c’est à travers ces structures que les masses expriment leur pouvoir et leur combativité.
En mai 1988, six mois après le début du soulèvement, des sources israéliennes estiment à 45 000 le nombre de comités actifs. Ceux-ci commencent à se coordonner à l’échelle des villes, tandis qu'un Commandement unifié de l'Intifada avait été immédiatement mis en place à l'initiative des principaux partis de la gauche palestinienne (FPLP, FDLP et PCP).
Contrairement à ce qui a été affirmé par la suite, la direction de l'OLP à Tunis est complètement écartée par le développement explosif de la mobilisation révolutionnaire dans les territoires. Les directives d'Arafat sont largement ignorées par le Commandement unifié jusqu'à un an plus tard, après que la répression israélienne aura décapité le mouvement de sa direction initiale, en septembre 1988.
Divisions israéliennes
L'armée la plus puissante de la région était déployée contre des enfants armés seulement de pierres et de courage. Cela rappelle le mythe biblique du combat de David contre Goliath, sauf que David est devenu palestinien. Les forces d'occupation effectuaient régulièrement des perquisitions pour réquisitionner et brûler les « armes dangereuses » telles que les livres scolaires, les médicaments et les fournitures médicales, et pour détruire les jardins qui avaient poussé un peu partout pour nourrir la population vivant dans des conditions de privation extrême. Cette situation ébranlera la confiance des jeunes soldats de l'armée israélienne et suscitera une répulsion croissante à l'égard de l'occupation parmi des couches de la jeunesse israélienne.
Les divisions atteignent des sommets en mars 1988, avec la formation du « Conseil pour la paix et la sécurité » par un groupe de généraux israéliens à la retraite, dont la position est résumée par le général Orr, ancien commandant suprême de l'armée israélienne dans la région du nord (Liban) : « Nous sommes tous d'accord pour dire que l'occupation doit cesser, parce que son maintien constitue un danger bien plus grand pour notre sécurité que sa cessation » (Le Monde, 2 juin 1988). Leur pétition est signée par l'ancien chef du Mossad (Yariv) et l'ancien administrateur de la Cisjordanie (Sneh), ainsi que par 30 généraux de division et 100 généraux de brigade, soit la moitié des généraux de réserve.
Shamir, au contraire, décide de sortir de la crise en redoublant de répression dans les territoires. En août 1988, les comités populaires sont bannis et des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans sont introduites à l'encontre de leurs membres. L'Intifada, un an après son début, commence à subir les coups de la répression et de la dégradation des conditions économiques.
Le Commandement unifié reconnaît l'autorité de l'OLP en tant que « seul représentant du peuple palestinien » à la fin de l'année 1988. Le 15 novembre, Arafat proclame l'indépendance d'un État palestinien dans les territoires occupés par Israël, peu après quoi l'OLP entreprend de reprendre le contrôle de la mobilisation dans les territoires. Les comités sont assimilés aux structures sociales de l'OLP et dépouillés de leur rôle d'organismes embryonnaires du pouvoir de la masse des Palestiniens.
Ce développement porte un coup décisif au caractère de masse de l'Intifada et ouvre une seconde phase, plus dure, du soulèvement qui prend une tournure désespérée parmi une partie de la jeunesse. Ce n'est pas un hasard si, à mesure que le caractère de masse de l'insurrection s'estompera, le rôle des formations islamiques telles que le Hamas et le Djihad islamique s’accroîtra.
Le Hamas
Les Frères musulmans n'ont joué aucun rôle dans la première phase de l'Intifada. Le Hamas a été créé en tant qu'organisation distincte après le début de l'Intifada, afin de protéger les intérêts du Mujama Al-Islamiya, l'organisation fondée par le chef des Frères à Gaza, le cheikh Ahmed Yassine.
Un article révélateur publié en 2009 par Andrew Higgins dans le Wall Street Journal a mis en lumière le rôle joué par Israël dans le développement de ce qui allait devenir le Hamas.
Après deux décennies de répression par le régime égyptien, les Frères musulmans ont trouvé des conditions favorables pour prospérer dans la bande de Gaza occupée par Israël. Israël a permis au Mujama Al-Islamiya d'être enregistré en tant qu'organisation caritative et de fonctionner légalement tout au long des années 1970 et 1980, accumulant de l'argent et des propriétés. Autour de l'organisation, un réseau d'écoles, de clubs, de mosquées et l'université islamique de Gaza ont fourni aux Frères musulmans l'environnement idéal pour développer leurs activités. L'objectif d'Israël était d'utiliser les fondamentalistes islamiques pour saper le mouvement révolutionnaire de gauche de la résistance palestinienne.
Le Mujama s'est violemment opposé à la gauche palestinienne pour le contrôle d'institutions telles que le Croissant-Rouge palestinien (la version musulmane de la Croix-Rouge), en prenant d'assaut ses bureaux. La lutte s'est poursuivie à tous les niveaux. Les islamistes ont attaqué des magasins d'alcool et des cinémas. L'armée israélienne est restée le plus souvent à l'écart, observant la situation.
Les relations entre le Mujama et les services secrets israéliens ont été maintenues même après l'arrestation du cheikh Yassine en 1984 et ont donné lieu à des consultations au plus haut niveau. Bien après le déclenchement de l'Intifada, M. Hacham, expert militaire israélien en affaires arabes, a raconté avoir emmené l'un des fondateurs du Hamas, Mahmoud Zahar, rencontrer le ministre israélien de la Défense, Yitzhak Rabin, dans le cadre de consultations régulières.
Le massacre de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem en octobre 1990, combiné au désespoir engendré par une lutte aussi longue et sans perspectives, créera un environnement favorable à la croissance du Hamas.
Les accords d’Oslo de 1993
Arafat et l'OLP soutiennent l'Irak dans la guerre du Golfe de 1990. Saddam Hussein avait brandi la question palestinienne contre l'impérialisme américain, en dénonçant la politique de « deux poids, deux mesures » appliquée à l'Irak et à Israël, et avait proposé de se retirer du Koweït si Israël faisait de même avec les territoires occupés. Cela provoque une rupture de l'OLP avec les États-Unis, mais aussi avec la Ligue arabe, qui s'était rangée derrière Bush.
Les impérialistes américains pensent pouvoir tourner la faiblesse d'Arafat à leur avantage. Une table de négociation pour la « solution de la question palestinienne » est organisée à Madrid au cours de l'été 1991, à laquelle l'OLP se joint. Le Hamas la qualifie de « braderie de la Palestine ». Les négociations bilatérales israélo-palestiniennes aboutissent finalement à la signature des accords d'Oslo, officiellement sanctionnés en public à la Maison-Blanche le 13 septembre 1993, avec la célèbre poignée de main entre Yasser Arafat et le premier ministre israélien Ytzhak Rabin.
Du côté israélien, les accords constituaient une reconnaissance de l'impossibilité de poursuivre l'occupation directe des territoires, révélée par l'Intifada.
Rabin avait passé la plus grande partie de sa vie à combattre les Palestiniens. En 1948, il avait participé aux attaques de Lydda et de Ramle, entre Tel-Aviv et Jérusalem. Plusieurs centaines de personnes ont été abattues au cours de cette opération. En 1967, Rabin était le chef d'état-major de l'armée israélienne pendant la guerre des Six Jours, à l'issue de laquelle il avait acquis le statut de héros israélien. À la fin des années 1980, en tant que ministre de la Défense sous Shamir, il avait dirigé la réponse d'Israël à l'Intifada, ordonnant notamment aux soldats israéliens de briser les bras des jeunes Palestiniens surpris en train de jeter des pierres, ce qu'il a démenti par la suite.
C'est précisément l'Intifada qui l'a convaincu que le statu quo était devenu insoutenable. Un article du New Yorker (19 octobre 2015) cite Rabin déclarant à un groupe de collègues du Parti travailliste en 1988 : « J'ai appris quelque chose au cours des deux derniers mois et demi. Entre autres choses, qu'on ne peut pas gouverner par la force un million et demi de Palestiniens. »
Les paroles de Rabin illustrent à quel point le bouleversement révolutionnaire de l'Intifada a ébranlé les fondements mêmes de l'occupation israélienne. Cela a obligé les dirigeants sionistes à changer de tactique. L'autorité de Rabin leur a permis de le faire, mais au prix d'un ressentiment croissant de l'extrême droite sioniste, qui a coûté la vie à Rabin en 1995.
L'« ennemi juré », la direction de l'OLP, est coopté par la classe dirigeante israélienne dans le cadre d'un compromis instable, qui était essentiellement un piège. L'OLP accepte de reconnaître l'existence d'Israël et abandonne la revendication du droit de retour des réfugiés palestiniens de 1948. Israël accepte la création d'une Autorité palestinienne dans une partie des territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie, qui serait responsable de la sécurité d'Israël. En d'autres termes, l'OLP a pris en charge le maintien de l'ordre au sein de son propre peuple en échange du simulacre d'un semi-État palestinien, dépendant à tous les niveaux des caprices d'Israël. L'accord a été conclu sous les auspices des régimes arabes, des « amis » de la Palestine et de l'impérialisme américain.
Les accords d'Oslo ont représenté un tournant dans la situation, en sanctionnant la disparition de la Résistance palestinienne. Le Hamas est resté la seule force palestinienne significative à s'opposer aux accords. C'est ainsi qu'ont mûri les fruits empoisonnés du soi-disant processus de paix piloté par l'impérialisme américain, qui allait façonner le cadre du conflit israélo-palestinien jusqu'à aujourd'hui.
Après tout ce processus de luttes héroïques menées par les masses, de renoncements et de trahisons de la part des dirigeants, rien n'a été résolu. En vérité, pour beaucoup, la Nakba n'a jamais pris fin.
Cliquez ici pour lire la première partie