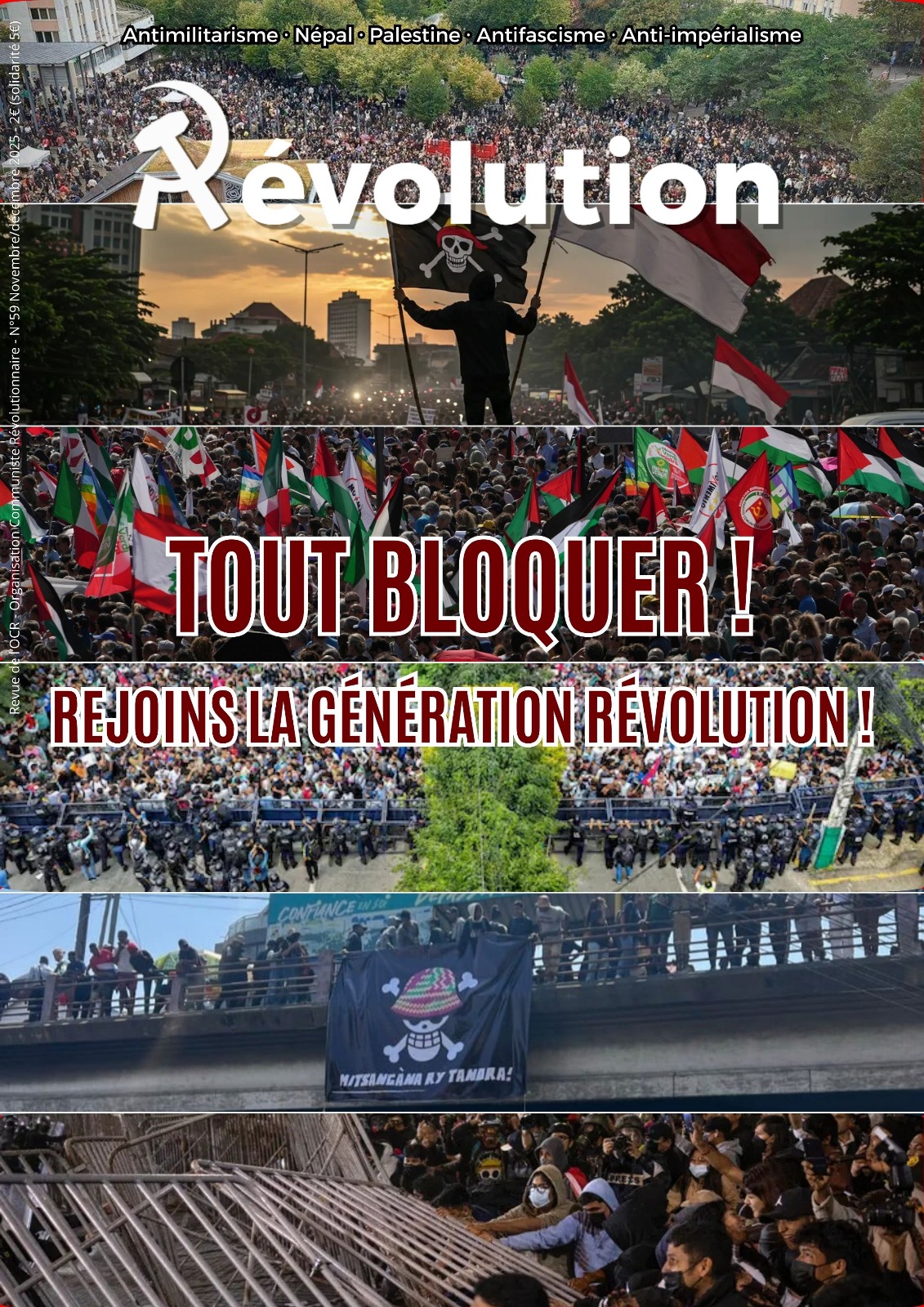Cet article a été rédigé par les marxistes britanniques Alan Woods et Ana Munoz, en juillet 2001. Nous avons décidé de le traduire et le publier pour alimenter les débats en cours, dans le mouvement revolutionaire (en France sortout), sur la question du « féminisme ». Des idées extrêmement confuses circulent sur la prétendue hostilité des marxistes à l’égard de la lutte pour l’émancipation des femmes. Nous espérons que ce texte, qui formule les idées fondamentales du marxisme sur cette question, permettra de lever un certain nombre de malentendus.
Pour les marxistes, la racine de toutes les formes d’oppression consiste dans la division de la société en classes. Pour de nombreux féministes, l’oppression des femmes s’enracinerait dans la nature des hommes. Ce serait un phénomène, non pas social, mais biologique. C’est là une conception du genre humain complètement statique, non-scientifique et non-dialectique. Ceux qui adoptent cette vision an-historique de la condition humaine en tirent des conditions profondément pessimistes. Car si nous acceptons l’idée qu’il y a quelque chose d’inhérent aux hommes qui les détermine à opprimer les femmes, on voit mal comment remédier au problème. La conclusion de telles prémisses, c’est que l’oppression de la femme par l’homme a toujours existé et, doit-on supposer, existera toujours.
Le marxisme explique qu’il n’en est rien. Il montre que, tout comme la société de classes, la propriété privée et l’Etat, la famille bourgeoise n’a pas toujours existé, et que l’oppression des femmes ne date que de la division de la société en classes. En conséquence, son abolition dépend de l’abolition des classes – c’est-à-dire de la révolution socialiste. Cela ne signifie pas que l’oppression des femmes disparaîtra automatiquement avec la prise du pouvoir par la classe ouvrière. L’héritage psychologique de la barbarie de classe ne sera complètement éliminé que lorsque se seront développées des conditions sociales permettant l’établissement de rapports véritablement humains entre l’homme et la femme. Mais tant que la classe ouvrière n’aura pas renversé le capitalisme, posant les bases d’une disparition de la division de la société en classes, une authentique émancipation de la femme ne sera pas possible.
Pour mener à bien la révolution socialiste, il est nécessaire d’unir la classe ouvrière et ses organisations, en levant toutes les barrières liées à la langue, à la nationalité, à la race, à la religion et au sexe. Cela implique, d’une part, que la classe ouvrière doit lutter contre toutes les formes d’oppression et d’exploitation, et se placer à la tête de toutes les couches opprimées de la société. D’autre part, la classe ouvrière doit rejeter catégoriquement toute tentative de diviser ses propres rangs – y compris lorsque ces tentatives viennent d’une section des opprimés eux-mêmes.
Il y a un parallèle assez net entre la position marxiste sur la question des femmes et sur la question nationale. Nous avons le devoir de lutter contre toute forme d’oppression nationale. Mais est-ce que, pour autant, nous soutenons le nationalisme ? La réponse est non. Le marxisme est un internationalisme. Notre objectif n’est pas d’ériger des frontières, mais au contraire de dissoudre toutes les frontières dans une fédération socialiste mondiale.
Les nationalistes bourgeois et petit-bourgeois jouent un rôle pernicieux en divisant la classe ouvrière suivant des lignes nationales. Ce faisant, ils exploitent le ressentiment – compréhensible – causé par de longues années de discrimination et d’oppression nationales. Lénine et les marxistes russes menaient une guerre implacable contre toute forme d’oppression nationale, mais aussi contre l’utilisation démagogique de la question nationale par les nationalistes bourgeois et petit-bourgeois. Ils insistaient sur la nécessité d’unir la classe ouvrière de toutes les nationalités dans la lutte contre les capitalistes et les propriétaires terriens – une fédération socialiste étant la seule garantie d’une résolution durable de la question nationale. En d’autres termes, les marxistes abordent la question nationale exclusivement d’un point de vue de classe.
Il en va de même pour l’attitude des marxistes vis-à-vis de l’oppression des femmes. Tout en luttant contre toute forme de discrimination et d’oppression, nous devons fermement rejeter le féminisme bourgeois et petit-bourgeois, qui considère l’essence du problème comme un conflit entre l’homme et la femme, et non comme une question de classe.
Toute l’histoire montre que la question de classe est déterminante, et qu’il y a toujours eu une lutte intense entre les femmes des classes opprimées, qui voulaient un changement révolutionnaire, et les femmes « progressistes » des classes supérieures, qui utilisaient la question de l’oppression des femmes pour promouvoir leur propres objectifs égoïstes. A chaque étape, cette différence de classe s’est manifestée de façon très nette. Quelques exemples suffiront à le montrer.
Dès le XVIIe siècle, les femmes commencèrent à défendre des revendications pour leur émancipation sociale et politique. La révolution anglaise a vu une large implication des femmes dans la lutte contre la monarchie, pour la démocratie et l’égalité des droits. En 1649, une Pétition des Femmes de Londres déclarait : « Puisqu’on nous assure que nous avons été créées à l’image de Dieu, que tous les hommes sont égaux aux yeux du Christ, ainsi que dans notre part des bienfaits du Commonwealth, nous ne pouvons que nous étonner et nous désoler de ce que nous soyons aussi méprisables à vos yeux, au point de nous considérer comme indignes de pétitionner ou de présenter nos doléances à cette honorable Chambre. N’avons-nous pas, comme tous les hommes de cette Nation, un intérêt égal dans les libertés et sécurités consacrées dans la Pétition du Droit et dans d’autres bonnes lois du pays ? » (Not in God’s Image, J. O’Faolain et L. Martines)
Les femmes étaient actives dans des groupes et des sectes religieuses qui se situaient sur la gauche du mouvement révolutionnaire et qui demandaient que les femmes puissent devenir prêtres ou ministres. Mary Cary, par exemple, participait au mouvement de la « Cinquième Monarchie ». Dans The New Jerusalem’s Glory, elle écrivait : « Et s’il y a si peu de hommes qui soient doués du don de l’Esprit, combien peut-il y en avoir parmi les femmes ? Et si tant est qu’il y ait des femmes pieuses, dont beaucoup ont effectivement reçu l’Esprit – quelle en est la proportion ? Sont-elles si faibles ? Sont-elles incapables de prophétie ? Car c’est de cela que je parle, cela qui se trouve dans le texte, mais que nous ne trouvons pas dans les faits. Mais l’heure approche qui verra la réalisation de cette promesse, et les Saints seront abondamment remplis de l’Esprit ; où non seulement les hommes, mais aussi les femmes, pourront prophétiser ; non seulement les hommes âgés, mais aussi les jeunes ; non seulement les supérieurs, mais aussi les inférieurs ; non seulement ceux qui ont appris dans les Universités, mais aussi ceux qui n’y ont pas appris ; et même les servants et domestiques. »
Le féminisme et la révolution française
A l’époque de la révolution française, la situation avait beaucoup évolué. Les rapports de classe – et, par conséquent, la conscience de classe – étaient devenus plus nets, plus tranchés. La révolution n’avait plus besoin de se parer d’un voile biblique. Elle parlait désormais le langage de la Raison et des Droits de l’Homme. Mais qu’en était-il des droits des femmes ?
La révolution française ne peut être comprise que d’un point de vue de classe. Les différents partis, clubs, tendances et individus, qui entrent en scène à un rythme déroutant, surgissant et retombant comme les vagues d’une mer agitée, n’étaient que l’expression de la lutte de différentes classes pour le contrôle de la situation, suivant une loi générale de toute révolution qui voit le tendances les plus radicales remplacer les plus modérées, jusqu’à ce que la dynamique de la révolution soit épuisée et que son film commence à se dérouler en sens inverse. Telle est la destinée de toute révolution bourgeoise : l’impulsion qui vient des masses finit par se heurter à la contradiction entre leurs illusions et le contenu de classe réel du mouvement.
Les divisions de classe, au sein du mouvement révolutionnaire, se sont manifestées dès le début. Les Girondins représentaient la tendance bourgeoise qui voulait arrêter la révolution à mi-chemin et conclure un accord avec le roi pour instaurer une monarchie constitutionnelle. C’eut été fatal à la révolution, qui n’a acquis son élan nécessaire que lorsque les masses sont entrées en action et ont commencé à régler leur compte avec la réaction par des méthodes plébéiennes et révolutionnaires. C’est l’irruption des masses qui a garanti la victoire de la révolution et a permis de complètement balayer l’ordre féodal.
On ignore souvent que les femmes ont joué un rôle dirigeant dans la révolution française (comme d’ailleurs dans la révolution russe). Nous ne parlons pas ici des petites-bourgeoises féministes et cultivées qui ont émergé au cours de la révolution, mais des femmes ordinaires du peuple et de la classe ouvrière qui se sont soulevées contre l’oppression de leur classe. Les femmes plébéiennes et semi-prolétariennes qui ont commencé la révolution, en 1789, réclamaient d’abord du pain, sans dans un premier temps poser la question de l’oppression des femmes – bien que cette question ait naturellement surgi au cours de la révolution.
Dans Le peuple et le révolution française, l’historien Gwynne Lewis écrit : « Exclues du vote et de la majorité des sociétés populaires, les femmes pouvaient jouer, et ont effectivement joué un rôle de premier plan dans les insurrections, en particulier celles d’octobre 1789, du 10 août 1792 et du printemps de 1795. Mêmes les femmes les plus radicales demandaient rarement qu’on leur accorde le droit de vote, conditionnées qu’elles étaient par la distinction qui plaçait l’homme dans la "sphère publique" et la femme dans la "sphère privée". Elles ont constitué des sociétés populaires de femmes, dont la plus connue était la Société des Citoyennes Républicaines Révolutionnaires. Mais ce club n’a duré que de mai à octobre 1793. Cependant, cela ne signifie pas que les femmes ne partageaient pas le programme économique et politique des hommes. Les femmes soutenaient les hommes, et les poussaient même à l’action. Elles prenaient place dans les galeries des sociétés populaires ; elles créaient leur propre espace politique à la sortie des boulangeries, sur les marchés, dans les rues. »
Une révolution secoue la société jusque dans ses profondeurs, libérant les sentiments et les aspirations des masses et de toutes les couches opprimées. La revendication de l’émancipation des femmes a donc acquis un caractère brûlant, au cours de la révolution. Mais cette revendication était comprise différemment par les différentes tendances politiques, lesquelles reposaient en dernière analyse sur différents intérêts de classe. Ce n’est pas un hasard si les femmes pauvres du prolétariat et du semi-prolétariat parisiens étaient à l’avant-garde. Elles constituaient la couche la plus opprimée de la société, celles qu’accablaient le plus de souffrances. Par ailleurs, elles n’avaient pas d’expérience de la lutte et des organisations politiques, et sont entrées dans l’action sans être encombrées de préjugés. Par contraste, les hommes étaient plus prudents, plus hésitants, plus « légalistes ». Depuis, on a pu observer ce contraste à de nombreuses reprises. Dans de nombreuses grèves impliquant des femmes, elles ont fait preuve d’une combativité, d’une élan et d’un courage bien supérieurs aux hommes. Il est significatif que, lors de la révolution française, les femmes ont commencé à se mobiliser sur des questions de classe – la question du pain. Et c’était également le cas plus d’un siècle après, à Petrograd.
A chaque tournant décisif de la révolution française – tout au moins dans ses premières phases – les femmes des classes inférieures ont joué un rôle dirigeant. En octobre 1789, alors que les membres de l’Assemblée Constituante se perdaient en discours interminables sur les réformes et la Constitution, les femmes pauvres de Paris – les poissonnières, les lavandières, les couturières, les vendeuses, les domestiques et femmes de travailleurs – se sont spontanément révoltées. Elles ont organisé une manifestation et marché jusqu’à l’Hôtel de Ville, réclamant une baisse du prix du pain. Elles défiaient les hommes de marcher sur Versailles et d’en ramener le roi et la reine pour les placer, à Paris, sous la surveillance du peuple (elles ne faisaient d’ailleurs aucune différence entre le roi et la reine, celle-ci – la « femme autrichienne » – étant peut-être encore plus détestée que son mari). Cette scène est très bien décrite dans le livre de George Rudé, La foule dans la révolution française :
« Les femmes ont commencé à prendre les choses en main. La crise du pain les affectait tout particulièrement, et ce sont elles, plus que les hommes, qui ont joué le rôle dirigeant dans le mouvement. Le 16 septembre, Hardy rapporte que des femmes ont arrêté, à Chaillot, cinq charrues chargées de blé et les ont amenées à l’Hôtel de Ville de Paris. Le 17, à midi, l’Hôtel de Ville était assiégé par des femmes en colère qui fustigeaient l’attitude des boulangers ; elles ont été reçues par Bailly, au Conseil Municipal. "Ces femmes, notait Hardy, disaient hautement que les hommes n’y entendaient rien et qu’elles voulaient se mêler des affaires". Le jour suivant, l’Hôtel de Ville était de nouveau assiégé, et les femmes reçurent des promesses. Le soir même, Hardy rapporte avoir vu des femmes saisir un chargement de blé, Place des Trois Maries, et l’escorter jusqu’au quartier général le plus proche. Ce mouvement devait se poursuivre jusqu’à la manifestation politique du 5 octobre, et au-delà. »
Plus loin : « Les femmes convergèrent vers l’Hotel de Ville. En premier lieu, elles réclamaient du pain, et en deuxième lieu des armes et des munitions pour leurs hommes. Un marchand passant par le vieux marché, vers 8 h 30, dit avoir aperçu des groupes de femmes qui arrêtaient des passants et les forçaient à les suivre jusqu’à l’Hôtel de Ville, "où l’on devait aller pour se faire donner du pain". Les gardes étaient alors désarmés et leurs armes livrées aux hommes qui suivaient les femmes en les encourageant. Un autre témoin, caissier de l’Hôtel de Ville, rapporte comment, vers 9 h 30, un grand nombre de femmes, parmi lesquelles se trouvaient également des hommes, ont dévalé les escaliers et pénétré de force dans tous les bureaux du bâtiment. Un témoin dit qu’elles étaient armées de bâtons et de piques, et un autre qu’elles avaient des haches, des pieds-de-biche, des matraques et des mousquets. Un caissier de la Mairie qui avait eu la témérité de protester s’est entendu dire "qu’ils étaient les maîtres et les maîtresses de l’Hôtel de Ville". A la recherche d’armes et de poudre, elles déchiraient des documents et des livres de compte. Une liasse de billets de la Caisse des Comptes disparût de l’un des bureaux. Mais leur but n’était pas de piller ou de voler de l’argent. Le trésorier municipal rapporta à la police que les femmes n’avaient pas touché aux 3,5 millions de livres en billets qui se trouvaient sur les lieux, et, quelques semaines plus tard, la liasse de billets manquante a été intégralement restituée. Après avoir sonné le tocsin, les manifestants se retrouvèrent Place de la Grève, vers 11 heures.
« C’est à ce moment que Maillard et ses Volontaires arrivèrent. D’après son témoignage, les femmes menaçaient de mort Bailly et Lafayette. Soit pour les empêcher de mettre leur menace à exécution, soit pour promouvoir les objectifs politiques des "patriotes", Maillard s’est persuadé de la nécessité de prendre la tête de la longue marche sur Versailles, où une pétition réclamant du pain devait être remise au roi et à l’Assemblée. En partant, dans l’après-midi, elles enlevèrent les canons du Châtelet et obligèrent les femmes de toutes conditions – "même des femmes à chapeau"– à se joindre à elles. »
Ici, on voit parfaitement comment les femmes pauvres de Paris concevaient la lutte. L’inaction de leurs hommes les frustrait, et elles se lancèrent elles-mêmes dans le combat avec une fougue extraordinaire qui balayait tout sur son passage. Mais à aucun moment elles n’ont considéré cela comme une lutte « des femmes contre les hommes ». C’était une lutte de toute la classe des pauvres et des exploités contre les riches oppresseurs. Avec des revendications économiques (« du pain »), elles marchaient vers la Mairie. Puis une autre revendication a commencé à émerger : les femmes demandaient des armes et des munitions pour leurs hommes. Elles cherchaient à susciter la honte chez les hommes, pour les pousser à l’action. Ce faisant, elle sont brillamment parvenues à sauver la révolution.
L’irruption des masses sur la scène politique est la caractéristique première et fondamentale de toute révolution. C’est tout particulièrement vrai concernant les femmes. Dans la révolution française, les femmes n’avaient pas du tout l’intention de laisser la politique aux hommes. A Paris, les Citoyennes Républicaines Révolutionnaires, vêtues de pantalons rouges et blancs et du bonnet rouge, organisaient des manifestations armées. Elles demandaient que les femmes aient le droit de vote et de siéger dans les plus hautes instances civiles et militaires de la République – c’est-à-dire l’égalité politique complète et le droit de se battre et de mourir pour la cause de la révolution.
Cependant, la révolution se caractérisait par une lutte constante entre différents partis et tendances, dont les plus radicaux devançaient et remplaçaient constamment les plus modérés, jusqu’à ce que la révolution ait épuisé son potentiel et commence à se dérouler en une spirale descendante menant au Bonapartisme et à Waterloo. Cette lutte entre les partis, au sommet, reflétait la lutte entre différentes classes. Les Girondins représentaient la section de la bourgeoisie qui avait peur des masses et cherchait à tout prix un accord avec le roi. Ces antagonismes de classe – qui prirent des formes particulièrement aiguës dans la révolution française – affectaient d’une façon fondamentale la question des femmes.
Les militantes girondines – dont certaines défendaient des positions très avancées sur la question formelle des droits des femmes – posaient la question d’une façon différente des femmes « sans-culottes », que les historiens hostiles appelaient ironiquement les « tricoteuses » à cause de leur habitude de tricoter en regardant les têtes aristocratiques tomber dans le panier de la guillotine. Les femmes des classes pauvres de Paris étaient animées d’un grand esprit révolutionnaire, d’une conscience de classe très nette – et d’une haine sans faille à l’égard des riches. Les Girondines venaient de familles privilégiées des classes moyennes ou de la bourgeoisie, et leurs intérêts immédiats n’étaient pas les mêmes que ceux des femmes des quartiers pauvres de Paris.
Les Girondines firent voter une loi sur le divorce qui était indiscutablement un progrès pour les femmes. Mais les Girondines insistaient beaucoup sur la question du droit des femmes à la propriété. Or, à l’époque de la révolution française, cette revendication n’était certainement pas une question brûlante pour la majorité des femmes, pour la simple raison que ni celles-ci, ni leur mari n’avaient la moindre propriété. Conformément à leur point de vue de classe, les femmes « sans-culottes » étaient opposées au « droit sacré à la propriété ». Hostiles aux femmes bourgeoises, même lorsque celles-ci portaient un bonnet rouge, elles luttaient instinctivement pour une République dans laquelle les hommes et les femmes seraient véritablement égaux – et non seulement égaux devant la Loi. Autrement dit, elles luttaient pour une société sans classes, sans riches et pauvres. Nous savons aujourd’hui que cet objectif était irréalisable, à l’époque. Les forces productives, qui constituent la base matérielle du socialisme, n’étaient pas suffisamment développées. La nature de classe de la révolution française était nécessairement bourgeoise. Mais cela n’apparaissait pas du tout clairement aux masses qui rallièrent la révolution avec un enthousiasme immense, et qui ont versé leur sang pour sa victoire. Ni les hommes, ni les femmes du peuple ne se battaient pour donner le pouvoir à la bourgeoisie ; ils se battaient pour défendre les intérêts de leur classe.
La lutte entre tendances révolutionnaires et modérées s’exprimait d’une façon très aiguë dans les rangs des femmes. Olympe de Gouges (1748-93) était le type même de la féministe girondine. Née Marie Gouges, fille illégitime d’un noble et de la femme d’un boucher de Montauban, dans le sud de la France, elle se rebella contre l’étroitesse de la vie provinciale et la façon dont son père traitait sa mère. Après un mariage malheureux, elle s’empressa d’aller à Paris, changea de nom et s’engagea dans le théâtre. Typique des femmes des classes moyennes que la révolution enthousiasmait, sans jamais vraiment en comprendre l’essence, elle écrivit des pièces de théâtre et des pamphlets, réclamait l’abolition du commerce d’esclaves, des ateliers publics pour les chômeurs (idée adoptée plus tard par le socialiste réformiste Louis Blanc) et un théâtre national pour les femmes. En 1791, elle écrivit une Déclaration des Droits de la Femme, en réponse à la Déclaration des Droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée.
Il y a des choses très intéressantes dans ce document, dont ce vibrant appel aux femmes : « Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n’est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l’usurpation. L’homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? »
Elle écrivit également une Forme de Contrat Social de l’Homme et de la Femme, dont elle voulait qu’il remplace les serments existants, et qui commençait par ces mots : « Nous, __ et __, mus par notre propre volonté, nous unissons pour le terme de notre vie, et pour la durée de nos penchants mutuels, aux conditions suivantes. Nous entendons et voulons mettre nos fortunes en communauté, en nous réservant cependant le droit de les séparer en faveur de nos enfants, et de ceux que nous pourrions avoir d’une inclination particulière, reconnaissant mutuellement que notre bien appartient directement à nos enfants, de quelque lit qu’ils sortent, et que tous indistinctement ont le droit de porter le nom des pères et mères qui les ont avoués, et nous imposons de souscrire à la loi qui punit l’abnégation de son propre sang. Nous nous obligeons également, au cas de séparation, de faire le partage de notre fortune, et de prélever la portion de nos enfants indiquée par la loi ; et, au cas d’union parfaite, celui qui viendrait à mourir se désisterait de la moitié de ses propriétés en faveur de ses enfants ; et si l’un mourait sans enfant, le survivant hériterait de droit, à moins que le mourant n’ait disposé de la moitié du bien commun en faveur de qui il jugerait à propos. »
Plus loin : « J’offre un moyen invincible d’élever l’âme des femmes ; c’est de les joindre à tous les exercices de l’homme : si l’homme s’obstine à trouver ce moyen impraticable, qu’il partage sa fortune avec la femme, non à son caprice, mais par la sagesse des lois. Le préjugé tombe, les mœurs s’épurent, et la nature reprend tous ses droits. Ajoutez-y le mariage des prêtres, le Roi raffermi sur son trône, et le gouvernement français ne saurait plus périr. »
Cependant, les idées d’Olympe de Gouges étaient celles d’une Girondine – c’est-à-dire d’une bourgeoise libérale. Notons que, dans le nouveau contrat de mariage, elle insiste surtout sur la question de la propriété. Et à la fin, elle parle de la nécessité de « raffermir le roi sur son trône ». C’est entièrement dans l’esprit girondin. Plus tard, elle publia un appel contre l’exécution du roi – ce qui scella son sort. Les Jacobins l’exécutèrent. Sur le chemin de la guillotine, elle fit un discours dans lequel elle disait, entre autres choses : « Echafauds et bourreaux – voilà donc les résultats d’une révolution qui devait être la gloire de la France, rayonnant sans distinction sur les deux sexes et servant de modèle à l’univers ? » Ces paroles montraient qu’elle ne comprenait pas la réalité de la révolution. L’exécution du roi était une ligne de démarcation nette séparant les deux phases de la révolution dans sa période ascendante. Elle fut un coup décisif porté au centre nerveux de la contre-révolution, d’où des complots étaient constamment organisés. Elle intimida l’aristocratie et envoya un message de défi à tous les trônes d’Europe. Surtout, elle permit de distinguer les éléments modérés et vacillants de ceux qui brûlaient de faire avancer la révolution.
Des philistins ont condamné la révolution française parce qu’elle a usé de la violence. La Terreur a été universellement condamnée en des termes qui rappellent les dernières paroles d’Olympe de Gouges. Mais sans la Terreur révolutionnaire, la révolution n’aurait pas survécu. Les masses devaient recourir à des mesures extrêmes pour se défendre contre la menace de la contre-révolution royaliste qui, si elle l’avait emporté, aurait noyé la révolution dans le sang. Toute l’histoire, à commencer par la révolte des esclaves dirigée par Spartacus, montre qu’il n’y a pas de limites à la cruauté d’une classe dirigeante qui prend sa revanche. Dans une premier temps, la Terreur dirigée contre l’aristocratie, les prêtres et la contre-révolution avait un caractère progressiste. Lorsque, plus tard, la Terreur fut dirigée contre les révolutionnaires, dans le but de consolider la réaction thermidorienne, elle était contre-révolutionnaire. Nous sommes navrés pour tous ceux qui ne voient pas la différence, mais ils ne peuvent pas être pris au sérieux.
Théroigne de Méricourt (1766-1817) était une autre personnalité féministe et girondine. Elle avait vécu comme une courtisane avant la révolution, et s’est saisie de la question des droits des femmes – là encore, d’un point de vue purement girondin. La malheureuse fut attaquée par des Jacobines alors qu’elle marchait dans le jardin des Tuileries, en juin 1793. Elle fut déshabillée et lapidée. Elle termina sa vie dans un asile de fous.
D’un point de vue humain, on peut éprouver de la sympathie pour cette femme qui, d’une certaine façon, voulait améliorer le sort des femmes – ou plus exactement des femmes bourgeoises. Mais ce que montre avant tout son destin, c’est qu’un abyme de classe séparait la féministe bourgeoise des femmes révolutionnaires des classes opprimées, et qu’une ligne de sang séparait les riches des pauvres, les Girondins des Jacobins. Les appels à l’unité de toutes les femmes, indépendamment de leurs classes sociales, ne rencontraient aucun écho parmi la masse des femmes du peuple qui se battaient aux côtés de leurs hommes pour une société plus juste.
Divisions de classe chez les Suffragettes
Les premières années de développement du mouvement ouvrier, en Grande-Bretagne, étaient une période d’agitation intense dans la classe ouvrière, et notamment parmi les femmes. Le syndicalisme de masse était né, à la fin de XIXe siècle, d’une série de grèves militantes qui mobilisèrent des travailleurs jusqu’alors passifs et inorganisés. Certaines de ces grèves impliquaient des ouvrières, comme par exemple la célèbre grève des vendeuses d’allumettes. Dans le même temps, parmi les femmes des classes moyennes, il y avait une agitation croissante en faveur du droit de vote. Cependant, les « Suffragettes » de la petite-bourgeoisie ne s’intéressaient qu’à l’égalité formelle, et se seraient contentées d’un droit de vote limité aux femmes propriétaires – c’est-à-dire aux femmes de leur classe. N’oublions pas qu’à l’époque, bien des hommes n’avaient pas le droit de vote. Et les événements démontrèrent rapidement la nature réactionnaire du féminisme bourgeois, qui était hostile à la cause des travailleurs – et des travailleuses.
Comme l’écrit Jen Pickard dans un article sur Sylvia Pankhurst : « La famille Pankhurst était associée à la lutte pour le droit de vote des femmes. Mais ce qui distinguait l’approche de Sylvia de celle de sa mère Emmeline et de sa sœur Christabel, c’est la question de classe. En conséquence, dans les années 20, au terme de près de 20 années de lutte, Emmeline fut candidate aux législatives pour les Tories (les Conservateurs), alors que Sylvia participait à la création du Parti Communiste Britannique. »
La fondation de l’Union Sociale et Politique des Femmes (WSUP), en 1903, était une conséquence des vacillations du Parti Travailliste Indépendant sur la question du droit de vote des femmes. Le WSUP grandit rapidement et, en 1907, comptait 3000 sections, composées notamment d’enseignantes, de vendeuses, d’employées de bureau, de couturières et d’ouvrières du textile. Son journal, Votes for Women, se vendait à 40 000 exemplaires par semaines. Le WSUP était capable de remplir la salle de l’Albert Hall et d’organiser une manifestation de 250 000 personnes, à Hyde Park.
En 1911, au moment où le gouvernement libéral d’Asquith promettait la « Home Rule » aux Irlandais, il ouvrait également la perspective d’un droit de vote des femmes (propriétaires). Mais les Libéraux renièrent ces deux engagements. Lorsque les Suffragettes recoururent à l’action directe, elles furent brutalement réprimées : tabassages, arrestations, alimentation forcée des grévistes de la faim, etc. La campagne des Suffragettes était essentiellement organisée par les femmes des classes moyennes. Mais la tactique consistant à briser les vitres des opposants au droit de vote, défendue par l’aile bourgeoise des Suffragettes, ne menait nulle part. La classe dirigeante demeurait implacablement opposée au droit de vote des femmes.
La seule voie, pour le mouvement des femmes, consistait à nouer des liens avec le mouvement ouvrier, qui à cette époque menait une lutte intense contre la classe capitaliste. C’était une période de montée en puissance de la lutte des classes, en Grande-Bretagne, avec des grèves massives des dockers et des travailleurs du transport. Le « Libéral » Asquith envoya l’armée briser la grève des mineurs, dans le sud du Pays de Galles. Une section du mouvement des femmes choisit de s’unir au mouvement ouvrier, avec un certain succès. Sylvia Pankhurst s’engagea dans une stratégie d’agitation et de propagande parmi les femmes de la classe ouvrière, dans l’Est de Londres. A Bermondsey, au sud de Londres, des femmes grévistes d’une usine d’alimentation ont été rejointes par 15 000 autres, venues d’usines et d’ateliers de la région, pour participer à un meeting de masse, à Southwark Park. Elles réclamaient une augmentation de salaire – et le droit de vote. C’était la bonne stratégie : utiliser le levier de la lutte des classes pour lier des revendications économiques aux revendications politiques, dont notamment le droit de vote.
Ces différences d’approches provoquèrent une scission dans le mouvement, suivant une ligne de classe – ainsi qu’une division dans la famille Pankhurst. En janvier 1914, quelques mois avant la guerre, Sylvia fut convoquée à Paris pour une réunion avec sa mère, Emmeline, et sa sœur, Christabel. Installée dans un confortable exil, à Paris, Christabel respirait la santé, alors que Sylvia était épuisée par la prison et les grèves de la faim. En opposition complète avec la position de classe défendue par Sylvia Pankhurst, sa sœur Christabel insistait sur l’indépendance du WSPU à l’égard de tous les partis politiques (les « partis des hommes »). Christabel exigeait l’exclusion de la Fédération de l’Est de Londres du WSPU. En d’autres termes, elle demandait l’exclusion des femmes de la classe ouvrière.
Cette arrogante petite-bourgeoise expliquait que la Fédération de l’Est de Londres reposait trop sur les ouvrières. Il semble que sa mère ait cherché un compromis, mais Christabel n’en voulait pas, et demandait « une coupe franche » dans le mouvement. En conséquence, la Fédération de l’Est de Londres dût rompre avec le WSPU et constituer une organisation distincte : la Fédération des Suffragettes de l’Est de Londres (ELFS). Cela illustre parfaitement l’attitude du féminisme petit-bourgeois à l’égard de la classe ouvrière. Comme l’écrit Jen Pickard, « la scission du WSPU reflétait la polarisation générale dans la société britannique. Entre 1911 et 1914, dès grèves ont éclaté dans toutes les sections décisives de la classe ouvrière (dockers, travailleurs des transport, cheminots, métallurgistes). Et parmi les membres du WSPU qui étaient emprisonnés et nourris de force, ce sont les femmes de la classe ouvrière qui subirent les pires traitements. »
Là encore, la question de classe est fondamentale. La scission des Suffragettes illustre l’attitude des féministes bourgeoises à l’égard des travailleuses, du socialisme et du mouvement ouvrier. En posant le problème en terme de lutte « des femmes contre les hommes », elles jouèrent un rôle négatif et finirent inévitablement par adopter une politique réactionnaire, comme on l’a vu quelques mois après la scission. En 1914, la première guerre mondiale brisa le développement de la lutte des classes en Grande-Bretagne. Et du jour au lendemain, les « rebelles » féministes Emmeline et Christabel Pankhurst se muèrent en véritables chauvines. Le journal du WSPU (Votes for Women) fut rebaptisé Britannia. Sa devise était : « Roi, Patrie, Liberté ».
Cette abjecte et honteuse trahison de la cause des femmes mettait à jour la véritable nature de classe du féminisme bourgeois, ainsi que le gouffre le séparant de la classe ouvrière et du socialisme. Malgré toute leur démagogie et tout leur radicalisme verbal, en dernière analyse, elles étaient prêtes à s’unir aux hommes de leur classe – la classe dirigeante – contre les hommes et les femmes du salariat, qui allaient devoir souffrir et mourir au combat pendant que, bien au chaud et bien nourries, elles agiteraient le drapeau national. C’est toujours la même histoire.
Sylvia Pankhurst, elle, s’opposa à la guerre – bien que d’un point de vue pacifiste confus – et organisa une campagne pour que les femmes qui remplaçaient les hommes – partis au front – dans les industries d’armement et de la métallurgie, reçoivent un salaire équivalent. Elle publia une journal, The Workers’ Deadnaught, puis rejoint le Parti Communiste, où elle adopta une position gauchiste. Elle avait une compréhension très limitée du marxisme, mais, au moins, elle essayait de défendre une position de classe.
En 1918, les femmes britanniques de plus de 30 ans obtenaient le droit de vote. Ce n’était pas le résultat des méthodes des Suffragettes, mais une conséquence indirecte de la révolution russe et de l’effervescence révolutionnaire qui suivit la première guerre mondiale. La classe dirigeante britannique était prise de panique et forcée de faire des concessions. Une fois de plus, la réforme dérivait de la révolution.
L’émancipation des femmes et le socialisme
Les révolutions bourgeoises du passé ont proclamé les « droits de l’homme » – mais, dans la pratique, n’ont jamais accompli l’égalité des hommes et des femmes. En fait, les progrès de la condition féminine, sous le capitalisme, ont été la conséquence, d’une part, de la lutte des classes, et d’autre part de l’évolution du rôle des femmes dans la production. Certains droits politiques ont été gagnés dans bon nombre de pays, mais il n’y a pas eu d’authentique émancipation des femmes, et il ne pourra jamais y en avoir sur la base du capitalisme.
Dès 1848, Marx et Engels soulevaient la revendication de l’abolition de la famille bourgeoise. Cependant, elle ne peut pas être abolie du jour au lendemain. Pour cela, il faut une base matérielle qui ne peut être réalisée que par le renversement du capitalisme et l’établissement d’une société nouvelle, fondée sur un plan de production harmonieux et démocratique, impliquant toute la population dans la tâche commune de l’administration. Dès lors que les forces productives seront libérées des chaînes de la propriété privée et de l’Etat-nation, il sera possible d’atteindre rapidement un très haut niveau de bien-être économique. La vieille psychologie faite de peur, de cupidité et de convoitise disparaîtra au fur et à mesure que seront abolies les conditions matérielles qui lui ont donné naissance.
La voie sera alors ouverte à une transformation radicale de la vie humaine, ainsi qu’à une transformation conséquence des rapports entre les hommes et les femmes, de leur façon de penser et d’agir. Sans de telles prémisses, tous les discours sur la nécessité de changer le caractère et la psychologie des gens ne mènent à rien. L’être social détermine la conscience.
Les femmes de la classe ouvrière ont joué un rôle déterminant dans la Russie de février 1917. Le tsar a été renversé par une révolution qui a commencé lors de la Journée Internationale de la Femme, les femmes russes ayant décidé de faire grève et de manifester, à Petrograd, contre l’avis des Bolcheviks locaux, qui craignaient un massacre. Guidées par leur instinct de classe, elles ont balayé toutes les objections et ont commencé la révolution. Nous verrons de nombreux exemples de ce type à l’avenir.
Une authentique émancipation de la femme n’est possible que si la classe ouvrière dans son ensemble est émancipée. Le socialisme permettra le développement de la personnalité humaine et l’établissement de rapports authentiquement humains entre l’homme et la femme, c’est-à-dire de rapports libres de toute pression externe, qu’elle soit sociale, économique ou religieuse. Cependant, une telle société présuppose un niveau de développement économique et culturel supérieur au plus développé des pays capitalistes. Dans la Russie arriérée d’octobre 1917, une telle base n’existait pas. Par conséquent, malgré les énormes avancées dues à la révolution, la condition des femmes régressa de nouveau, d’abord à cause du stalinisme, puis plus encore avec la restauration du capitalisme. Aujourd’hui, en Russie et en Europe de l’Est, la situation des femmes est plus mauvaise que jamais. Cela ne devrait surprendre personne. Il n’y a pas de progrès possible sur la base du capitalisme – en Russie moins encore que partout ailleurs.
Les femmes joueront un rôle essentiel dans le renversement du capitalisme et la construction du socialisme. Mais encore une fois, nous parlons ici des femmes de la classe ouvrière luttant pour leur propre émancipation – et celle de toute leur classe. Nous parlons de travailleuses acquérrant une conscience de classe et de la confiance en elles à travers leur participation à la lutte des classes – et non d’universitaires féministes « enseignant » aux femmes comment se battre pour la « cause des femmes ». Dans le processus de la lutte pour transformer la société, les hommes et les femmes se transformeront eux-mêmes. Nous pouvons voir comment, dans chaque grève, les travailleurs s’élèvent au rang de véritables êtres humains et se débarrassent de la mentalité d’esclave. Ce sera infiniment plus vrai dans le cas d’une révolution !
C’est la seule façon de parvenir à une authentique libération – non des femmes, mais des femmes et des hommes. En fait, l’une sans l’autre est impossible. Nous ne luttons pas pour la libération de tel ou tel groupe social, mais de l’humanité elle-même. Cela ne signifie nullement que les femmes doivent renoncer à la lutte pour des améliorations immédiates de leur condition. Au contraire. Sans la lutte quotidienne pour des avancées sous le capitalisme, la révolution socialiste serait impossible. Mais d’une part, il faut comprendre que sous le capitalisme, toute amélioration aura un caractère partiel, instable, et sera constamment menacée par la crise du système et la situation de déclin social, moral et culturel. D’autre part, il est nécessaire de lier fermement la lutte contre l’oppression des femmes à la lutte de la classe ouvrière contre le capitalisme. C’est la seul voie possible vers la victoire.
Bien sûr, même après le renversement du capitalisme, les cicatrices psychologiques de la barbarie de classe, avec son égoïsme calculateur et sa cupidité, ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Il faudra du temps avant que tout le vieux fatras ne disparaisse. Mais immédiatement, les rapports entre les hommes et les femmes commenceront à s’améliorer. Les terribles pressions économiques qui brisent des vies et enveniment tous les rapports humains seront abolis avec la provision d’emplois, d’une éducation et de logements décents pour tous. Un plan démocratique de production créera les conditions pour que tout le monde participe à l’administration de la société. Entre autres choses, cela permettra d’éliminer la vieille structure familiale introvertie et l’atomisation de l’individu, et créera les conditions de l’émergence d’une psychologie complètement différente, enracinée dans des rapports sociaux nouveaux, libres et véritablement humains.
L’élimination de la société de classe – et de la mentalité d’esclave qui en découle – débouchera sur la formation d’hommes et de femmes nouveaux : des êtres libres, capables de vivre ensemble en harmonie, entièrement libérés de la vieille psychologie égoïste. Après avoir libéré les hommes et les femmes de l’humiliante lutte pour leurs moyens matériels d’existence, il sera pour la première fois possible aux hommes et aux femmes d’agir les uns à l’égard des autres en être humains. Le rapport entre l’homme et la femme – ce rapport si beau et si naturel – sera libre de se développer à l’abri de toute coercition, de tout calcul égoïste et de toute dépendance humiliante.
Alan Woods et Ana Munoz(Juillet 2001)