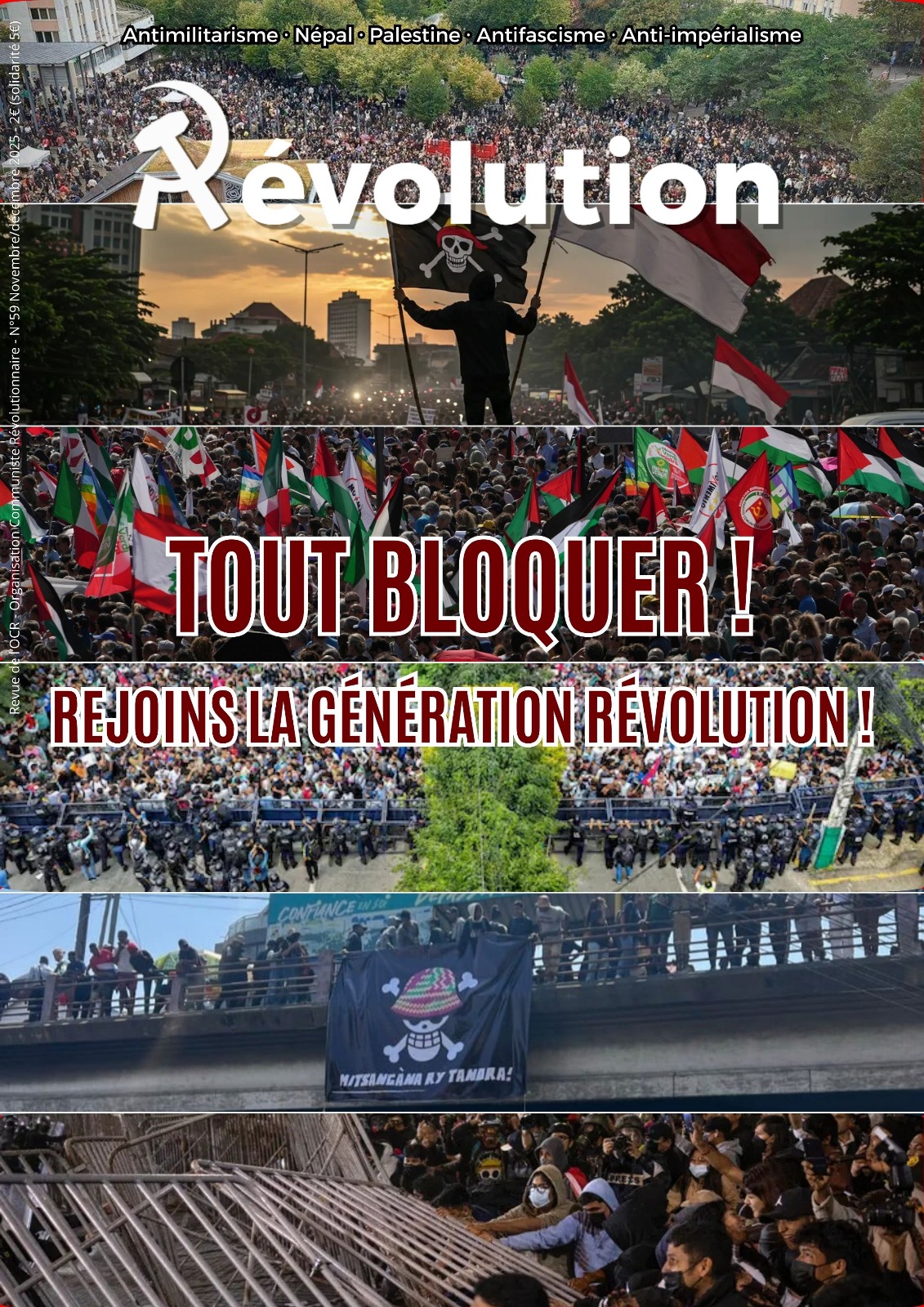Article écrit par nos camarades de la Tendance Marxiste Internationale au Québec.
Il y a 150 ans, Karl Marx, le fondateur du socialisme scientifique, publiait son opus magnum, Le Capital. Cet ouvrage colossal représente l’aboutissement des recherches de Marx sur les mécanismes fondamentaux du système capitaliste. Cent cinquante ans après Le Capital, à l’heure où les économistes libéraux échouent lamentablement à comprendre comment le développement du capital a pu mener l’économie capitaliste au bord du gouffre, les idées de Marx – qui étaient perçues jusqu’à récemment par bien des « intellectuels » bien-pensants comme désuètes, archaïques – ressurgissent et montrent toute leur actualité.
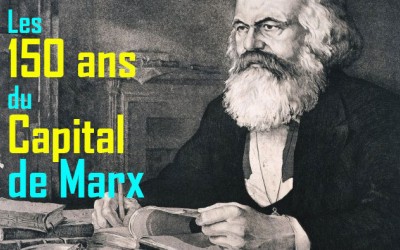 Nous nous proposons ici d’expliquer comment Marx en arrive à saisir l’essence du capital, à travers l’étude du processus d’accumulation du capital, de sa tendance à la concentration et l’étude de l’aliénation des travailleurs. En parvenant à expliquer la dynamique véritable de l’économie dominée par le capital, Marx a fourni au mouvement ouvrier les outils nécessaires pour lui permettre de jeter un regard éclairé sur l’époque de déclin économique dans laquelle nous sommes actuellement plongés.
Nous nous proposons ici d’expliquer comment Marx en arrive à saisir l’essence du capital, à travers l’étude du processus d’accumulation du capital, de sa tendance à la concentration et l’étude de l’aliénation des travailleurs. En parvenant à expliquer la dynamique véritable de l’économie dominée par le capital, Marx a fourni au mouvement ouvrier les outils nécessaires pour lui permettre de jeter un regard éclairé sur l’époque de déclin économique dans laquelle nous sommes actuellement plongés.
La crise du capital
Cela fait neuf ans qu’a eu lieu la crise économique mondiale de 2008, une crise qui a profondément déstabilisé le système capitaliste. À l’heure actuelle, la croissance mondiale reste faible et de nombreux indicateurs économiques montrent les faiblesses latentes de l’économie mondiale. Les dettes publiques des pays de l’OCDE se sont multipliées par huit depuis 2007, atteignant pas moins de 50 000 milliards de dollars. Les taux de chômage en Europe sont encore à des niveaux historiquement très élevés : 9,7 % en France, 16,4 % en Espagne, 20-23 % en Grèce.
Aux États-Unis, la dette de carte de crédit s’élève à 1000 milliards de dollars, un montant sensiblement égal aux prêts étudiants. Ici au Canada, la dette des ménages par rapport au revenu disponible est de 168 %, en hausse de 1 % depuis fin 2016. Le fardeau sur les ménages canadiens ne fait que s’accroître. La bulle immobilière, à Toronto, Vancouver et Victoria, ne fait qu’augmenter. À Toronto le prix moyen pour une maison est de 1,4 million de dollars. L’OCDE prévoit une croissance léthargique de 3 % par année à l’échelle planétaire jusqu’en 2060. C’est presque la moitié du rythme de croissance de l’économie mondiale pendant les trente glorieuses.
La crise de 2008 et ses conséquences ont clairement démontré que le système capitaliste n'a surmonté aucune de ses contradictions. Les économistes bourgeois n'ont pas pu prévoir la crise, et parviennent encore moins à y trouver des solutions. De plus en plus de gens sont forcés d'admettre que peut-être, après tout, Marx avait raison. C'est ce qu'a admis un économiste de la banque UBS, George Magnus, dans un article datant de 2011, lorsqu'il a dit que « l’économie globale d’aujourd’hui montre une ressemblance inquiétante avec ce que Marx avait anticipé. » 150 ans plus tard, les idées de Marx développées dans Le Capital sont plus pertinentes que jamais. Elles nous permettent de comprendre la crise actuelle du capitalisme, et pointent vers les possibilités de renverser ce système.
La quête sans fin du profit
Dans la société capitaliste, la classe dirigeante s’enrichit tous les jours grâce à l’extraction du surplus produit par l’immense classe des travailleurs salariés. Dans toute son œuvre, Marx martelait que la différence entre ces deux classes sociales ne peut être brouillée : le patronat possède les moyens de production, c’est-à-dire les machines, les entreprises et les outils de travail; tandis que les travailleurs n’ont que leur force de travail (leur capacité à travailler) qu’ils sont forcés de vendre en échange d’un salaire.
De manière plus précise, ce que les capitalistes possèdent, et que les travailleurs ne possèdent pas, c’est le capital. Le capital, c’est essentiellement la masse d’argent et de moyens de production que possède le capitaliste, et en vertu de laquelle il peut investir pour produire des marchandises, c’est-à-dire en salariant des travailleurs qui vont activer les moyens de production.
L’objectif du capitaliste n’est pas de produire pour le plaisir de produire, et encore moins de produire pour combler les besoins de la population. Si c’était le cas, nous ne jetterions pas le tiers des denrées alimentaires produites annuellement, alors qu’il y a pénuries et famines dans le soi-disant tiers-monde. Non, le capitaliste investit son capital dans la production, car il souhaite dégager un profit par la vente des marchandises. En ce sens, une des thèses les plus importantes développées dans Le Capital est que la production et la circulation des marchandises ne sont que des moyens pour l’accumulation du capital, et donc pour la création du profit pour la classe qui détient le capital.
Du moment qu’il ne voit pas de perspective de faire du profit, le capitaliste s’abstient d’investir ses avoirs. Actuellement, au Canada, les capitalistes n’ont tellement pas confiance dans leur possibilité de faire du profit qu’ils laissent dormir 700 milliards de dollars dans les coffres des banques, au lieu d’investir cet argent mort dans l’économie. Pendant ce temps, ces mêmes capitalistes forcent les gouvernements à prendre des mesures d’austérité pour que les travailleurs se serrent la ceinture et paient les frais de la crise.
Aux États-Unis, un rapport montrait qu’en 2012 il y avait cinq maisons vacantes pour chaque personne sans abri. Ce n’est pas exactement un bon exemple pour montrer comment la main invisible du marché permet de donner à tous selon leurs besoins.
Les capitalistes industriels, du moment que moins de profits peuvent être réalisés, ferment tout simplement des d’usines et mettent les travailleurs à la rue. En 2016 aux États-Unis, le taux d’utilisation des capacités de production était de 75 %. Cela signifie que 25 % des usines restent inutilisées. Si les capitalistes faisaient tourner les usines à leur pleine capacité, on aurait certainement assez de denrées pour répondre aux besoins de toute la population. Mais l’objectif du capitaliste ne se trouve pas là. Le capitaliste a besoin de consommateurs qui achètent, il lui faut accumuler de l’argent. Or les travailleurs ne gagnent pas d’assez bons salaires pour pouvoir racheter l’ensemble des marchandises produites. Et si les capitalistes donnaient aux travailleurs de meilleurs salaires, cela ferait augmenter leurs coûts de production, ce qui viendrait amputer leurs marges de profit.
La quête de profit sans fin des capitalistes est la force motrice qui dirige le développement économique. Marx expliquait qu’au fondement de tous les phénomènes économiques contemporains réside la tendance du capital à sans cesse s’accumuler.
Le processus d’accumulation du capital
Pour que le capitaliste se perpétue, c’est-à-dire qu’il reste compétitif et ne fasse pas faillite, il doit constamment retransformer le profit généré par le capital (investi dans la production) en capital supplémentaire. L’existence du capital prend la forme d’une boucle ou d’une spirale. Ce phénomène constitue ce que Marx appelle le processus d’accumulation du capital. Pour s’accumuler, le capital doit accomplir un circuit complet traversant la sphère de la production (en usine) puis la sphère de la circulation (sur le marché). Au début de ce circuit, le capital se présente d’abord sous la forme de l’argent. Mais ce ne peut être n’importe quelle somme d’argent. Il faut que ce soit une somme d’argent suffisamment grande pour acheter des moyens de production (machines, outils, etc.) et payer un salaire aux ouvriers.
Ce « capital-argent » investi dans la production sert essentiellement à l’achat, à l’entretien et au renouvellement des moyens de production et des forces de travail (achetées par les salaires). Une fois investi, le capital passe de la forme du capital-argent à la forme du « capital-productif » (moyens de production et salaires). Les ouvriers salariés actionnent les moyens de production et produisent les marchandises.
Les travailleurs, en transformant les matières premières et en créant les marchandises, incorporent leur travail à leur produit. Le capital initial qui fut investi sous forme de salaires et de machines se transpose, se déplace, à l’intérieur des marchandises. Comme Marx explique, le capital passe alors à la « forme-marchandise », devient « capital-marchandise ». Par la vente des marchandises, le capital-marchandise se transforme à nouveau en capital-argent, qui sera réinjecté dans la production.
Cependant, il s’est produit ici un phénomène bien particulier. Le capital ne s’est pas simplement transposé : il a généré une valeur supplémentaire pendant la production. L’ouvrier d’une usine peut produire quotidiennement jusqu’à 10 000 $ de pièces fabriquées, alors qu’il ne sera pas payé plus de 200 $ par jour. Tout ce travail que l’ouvrier investit dans les marchandises dépasse considérablement les frais de son salaire.
Le travailleur, comme Marx l’explique, n’est jamais rémunéré pour son travail, c’est-à-dire pour ce qu’il produit en valeur de marchandises. S’il recevait réellement en salaire l’équivalent de la valeur produite, le capitaliste ne pourrait dégager aucune marge de profit, et ferait faillite. Ce que le travailleur vend au capitaliste, et en échange de quoi il reçoit un salaire, c’est sa force de travail, soit sa capacité à travailler, son potentiel d’exercer un travail pendant un certain laps de temps.
Le salaire n’est qu’une masse d’argent que l’employeur donne au travailleur pour acheter sa force de travail (sa marchandise à lui), c’est-à-dire pour couvrir les frais de production de sa force de travail, soit les coûts requis pour qu’il soit capable de terminer chaque journée de travail et de revenir travailler le lendemain. L’ouvrier coûte au capitaliste un montant d’argent correspondant à ses moyens de subsistance, c’est-à-dire un loyer pour se loger, quelques vêtements, au moins quelques repas à bon marché, peut-être une voiture pour se déplacer et des enfants à nourrir.
Le capital investi dans le travail des ouvriers se réduit donc à la masse des salaires payés aux travailleurs. Or, dans la production de la marchandise, l’ouvrier a créé par son travail une valeur supérieure au capital investi au préalable. Cette valeur supplémentaire, que Marx appelle plus-value, est cristallisée dans la marchandise, puis sera réalisée sous forme d’argent grâce à sa vente. Cette plus-value créée par le travailleur permet au capitaliste d’obtenir, après la vente, un montant d’argent supérieur au capital-argent investi au début du circuit. Ce surplus constitue le profit du capitaliste qui sera ajouté à son capital-argent, retransformé en capital supplémentaire. Il apparait ainsi que le profit n’est rien d’autre qu’une quantité de travail que le travailleur est contraint de donner gratuitement à son employeur ; c’est du travail volé, accaparé par le capitaliste.
Approfondissant notre définition préliminaire, nous comprenons désormais que le capital est l’ensemble des moyens de production que possède le capitaliste, en vue de produire et d’extraire de la plus-value, par l’intermédiaire de l’exploitation du travail salarié. La plus-value sert ensuite de moyen pour le capital de se reproduire, en tant qu’elle sera transformée en davantage de capital-argent qui sera investi dans la production. La boucle de l’accumulation du capital est ainsi bouclée.
Marx nous dit : « la plus-value naît du capital et le capital naît de la plus-value. L'utilisation de la plus-value comme capital ou la retransformation de la plus-value en capital s'appelle accumulation du capital. » (Le Capital, chap. XXII, p. 649). Ainsi, la nature du capital est de se reproduire et de s’accumuler. Et comme nous le verrons, il est aussi de la nature du capital de se concentrer toujours plus dans des mains de moins en moins nombreuses, mais de plus en plus puissantes.
La concentration opulente du capital
Dans les sociétés de classe passées, que ce soient avec les esclavagistes romains ou les seigneurs féodaux, ceux-ci extrayaient également un surplus équivalent au profit du capitaliste, en volant l’esclave ou le paysan des fruits de son travail. Cependant, les membres de ces classes exploiteuses du passé consommaient pour eux-mêmes la plupart des surplus. Le sort des capitalistes est différent. La concurrence du marché force ceux-ci à constamment réinvestir dans la production les profits générés par la vente. Le réinvestissement est nécessaire au développement et à l’acquisition d’une machinerie toujours plus performante, qui permet de réduire à long terme les coûts de production (permettant par exemple de salarier moins de travailleurs pour le même travail), et d’ainsi vendre à bas prix pour rafler les parts du marché.
À l’époque où Marx écrit Le Capital, le capitalisme était encore dans une phase généralement ascendante. Le développement du système capitaliste a entraîné des avancées prodigieuses dans la science, la technique, l’agriculture, bref dans tout ce qui permet d’améliorer la qualité de vie des êtres humains. La concurrence stimulait ce développement.
L’un des apports fondamentaux de Marx fut d’expliquer le développement du capital à partir de la concurrence : celle-ci fait tendre à la faillite ceux qui ne parviennent pas à se tailler une place suffisante sur le marché, et amène les autres à s’approprier plus de parts de marché, et ainsi à concentrer la richesse entre leurs mains. De la libre concurrence elle-même, Marx entrevoit déjà l’inévitable tendance à la monopolisation, comme conséquence de la concentration du capital.
Depuis l’époque de Marx, la concentration des richesses n’a cessé de croître de manière fulgurante, voire exponentielle. Selon le plus récent rapport publié par Oxfam, les huit personnes les plus riches de la planète posséderaient autant que le 50 % le plus pauvre de la population (« Une économie au service des 99 % »). Au Canada, « les deux hommes d’affaires milliardaires David Thomson et Galen Weston possèdent ensemble l’équivalent de la richesse de 30 % des résidents les plus pauvres du Canada ». La concentration du capital a atteint des niveaux que même Marx n’aurait pas pu imaginer !
Marx écrivait dans Le Capital : « l’accumulation de richesse à un pôle signifie donc en même temps à l’autre pôle une accumulation de misère, de torture à la tâche, d’esclavage, d’ignorance, de brutalité et de dégradation morale pour la classe dont le produit propre est, d’emblée, capital » (Le Capital, chap. XXIII, p. 724-725). Cette phrase décrit avec précision ce qu'on voit aujourd'hui. Pendant que la poignée de parasites cache sa richesse toujours plus grande dans les paradis fiscaux, les travailleurs voient leurs conditions de vie et de travail diminuer davantage chaque année. La jeunesse en particulier est affectée : dans le monde entier, le chômage des jeunes atteint des niveaux inégalés. L’Organisation mondiale du travail affirme que « le taux de chômage de la jeunesse sur le globe est le double du taux de chômage normal ».
Bien que le capitalisme ait joué un rôle progressiste à ses débuts, il en est maintenant à un stade où, plus que jamais, le système retient l'humanité en arrière. Nous en sommes même arrivés à un point où les capitalistes n'ont plus réellement de rôle à jouer dans l'économie. Cela était déjà expliqué par Engels dans Anti-Dühring :
« Toutes les fonctions sociales du capitaliste sont maintenant assurées par des employés rémunérés. Le capitaliste n'a plus aucune activité sociale hormis celle d'empocher les revenus, de détacher les coupons et de jouer à la Bourse, où les divers capitalistes se dépouillent mutuellement de leur capital. »
Les capitalistes ont besoin des travailleurs pour faire du profit, mais les travailleurs n’ont pas besoin du capitaliste, simple parasite, pour faire fonctionner les usines et pour produire les richesses dont la société a besoin. Le capitalisme a créé les bases matérielles pour que s’érige une nouvelle société sur les cendres du capital, une société socialiste, où les travailleurs pourront démocratiquement planifier la production en fonction de leurs besoins.
L’aliénation du travail
En analysant le processus d’accumulation du capital (dans l’usine puis dans le marché) et en analysant sa tendance à se concentrer, Marx a montré que toute notre société contemporaine repose essentiellement sur un « vol » : la classe capitaliste extrait des profits par l’exploitation du travail des salariés qui ne reçoivent que des miettes. Les composantes matérielles du capital (les marchandises, les machines, l’argent) sont des objets inertes, produits par les ouvriers, mais qui ont acquis, dans la production capitaliste, le pouvoir de dominer les travailleurs. La machine n’est plus un instrument au service du travailleur ; c’est plutôt le travailleur qui constitue un instrument pour que la machine (le capital) génère les richesses qui seront accaparées pour le profit des capitalistes.
Il y a ici un retournement, un travestissement de la relation entre l’humain et ses outils de travail. Marx avait nommé ce phénomène « l’aliénation du travail », c’est-à-dire le fait que le travailleur est complètement dépossédé du produit de son travail, des outils de son travail, ainsi que dépossédé de la maîtrise de ses conditions de travail. Dans Le Capital, Marx nous disait :
« D’un côté, le procès de production ne cesse de transformer la richesse matérielle en capital, en moyens de valorisation et de jouissance pour le capitaliste. D’un autre côté, l’ouvrier ressort en permanence du procès comme il y était entré : source personnelle de richesse, mais dépouillé de tous les moyens de réaliser cette richesse pour lui-même. Étant donné qu’avant même qu’il entre dans le procès, son propre travail lui est rendu étranger, que le capitaliste se l’approprie et qu’il est incorporé au capital, ce travail s’objective constamment pendant le procès en un produit d’autrui, étranger. » (Le Capital, chap. XXI, p. 640)
L’aliénation du travail est une réalité vécue par tous les travailleurs. L’ouvrier sait qu’il ne possède jamais les fruits de son travail. Les marchandises produites demeurent la propriété tout entière du patron. Et lorsque le travailleur veut racheter les marchandises, disons sur les tablettes de l’épicerie du coin, c’est le désarroi qui s’empare de lui lorsqu’il constate qu’il n’a pas assez d’argent pour se payer de la nourriture convenable.
L’ouvrier sait également qu’il ne possède pas les moyens de son travail, qui appartiennent en totalité aux propriétaires des capitaux. Bien qu’un travailleur possède le savoir et l’expérience nécessaires pour faire fonctionner une machine de pointe, et bien que ce soit lui qui en assure le bon fonctionnement et l’efficacité, il ne lui viendrait certes jamais en tête de posséder lui-même un aussi onéreux outillage, si par chance le patron ne lui demande pas d’acheter lui-même son équipement.
De plus, l’ouvrier est constamment soumis à la cadence de la machine. Les travailleurs en restauration rapide vivent quotidiennement cette réalité. Lorsque la production ne répond pas aux exigences de productivité du patron, un compteur se met à sonner, et avertit le travailleur qu’il ne produit pas suffisamment de valeurs marchandes à la minute pour que le patron puisse dégager la marge de profit désirée.
Alors que le capitaliste s'enrichit toujours plus, le travailleur se voit complètement aliéné, coupé des fruits de son travail, coupé de la jouissance de sa propre production. La « liberté » si chère au capitalisme et son marché ne signifie concrètement qu’absence de liberté pour l’ouvrier, cet esclave moderne. La vie de l’ouvrier n’est qu’au service de l’accumulation toujours plus grande du capital, lequel devient une véritable force qui s’oppose à l’ouvrier et le domine.
C’est ce qui est résumé dans cette fameuse citation de Marx : « le capital a une unique pulsion vitale : se valoriser, créer de la plus-value, pomper avec sa partie constante, les moyens de production, la plus grande masse possible de surtravail. Le capital est du travail mort, qui ne s’anime qu’en suçant tel un vampire du travail vivant, et qui est d’autant plus vivant qu’il en suce davantage. » (Le Capital, chap. VIII, p. 259)
Marx nous dit que le capital est du « travail mort », au sens où les composantes matérielles du capital (marchandises, machines, outils, etc.) sont les produits du travail humain (le « travail vivant ») sont du travail qui a été matérialisé, fixé, cristallisé dans la matière (donc mort). Si nous vivions dans une société qui rend réellement possible la liberté et le bonheur des individus, les objets qu’on produit (le travail mort) seraient au service des humains (le travail vivant). Or dans la société capitaliste, les travailleurs sont forcés d’aller travailler pour les détenteurs des capitaux, s’ils veulent recevoir un salaire pour survivre. Les machines et les marchandises produites sont les armes matérielles des capitalistes qui maintiennent les travailleurs dans leur servitude.
À travers son analyse de l’aliénation du travail, Marx est arrivé à la conclusion que le capital n’est pas seulement un ensemble de choses inertes. Le capital n’est pas seulement l’ensemble des machines, des marchandises, des outils et de la masse d’argent que possède le capitaliste. Ces choses sont les instruments qui asservissent et exploitent l’ouvrier pour le profit du patron. Le capital n’est pas que du « travail mort » (du travail matérialisé), c’est la domination du travail mort sur le travail vivant, c’est la domination du capitaliste sur le travailleur.
Grâce à sa méthode dialectique, mobilisée dans son Capital, Marx a percé le voile apparent de la production capitaliste, pour saisir l’essence cachée derrière elle. Derrière les relations entre les choses inertes de la production, nous retrouvons les relations entre les humains vivants qui participent à la production. Dans chaque billet d’argent du banquier, dans chaque marchandise sur les tablettes, dans chaque machine maniée par l’ouvrier, le capital se présente toujours comme la matérialisation d’un rapport social, un rapport de pouvoir entre des humains.
Marx nous dit ainsi : le capital n’est pas « une chose, mais un rapport social entre des personnes médiatisé par des choses. » (Le Capital, chap. XXV, p. 859). Et ce rapport social est un rapport d’exploitation entre la classe capitaliste exploiteuse et la classe salariée exploitée. Au fondement du capital réside la lutte entre ces deux classes.
La lutte des classes
Notre société contemporaine tout entière repose sur cette contradiction fondamentale que les deux classes principales, la classe des capitalistes et celle des travailleurs, s’opposent irréductiblement dans leurs intérêts, alors qu’elles sont également mutuellement dépendantes. Bien que le capital exploite les travailleurs, il assure également leur subsistance. Le capital fournit à l’ouvrier son salaire qui lui permet de se reproduire physiquement, mais aussi de se reproduire en tant que classe, puisqu’il le dépossède continuellement et l’empêche de devenir propriétaire des moyens de production. Le capital reproduit le travailleur, mais en retour le travailleur reproduit lui-même le capital et le capitaliste, car chaque fois que l’ouvrier produit de ses mains une marchandise, celle-ci rapporte du profit au capitaliste (qui en a la propriété), augmentant ainsi son capital, et donc sa capacité d’exploiter plus de travail salarié. Le capital et le travail sont des opposés dialectiques : ils s’engendrent mutuellement, et en même temps ils se contredisent, s’opposent, car leurs intérêts sont diamétralement opposés.
Les tentatives du capitaliste d’augmenter son taux de profit, par la réduction des coûts de production, se manifestent à travers des attaques sur les salaires, les emplois et les conditions de vie des travailleurs. Les luttes des travailleurs pour l’amélioration de leurs conditions de vie constituent pour les patrons des attaques sur leur profit. Ultimement, la richesse produite par la classe ouvrière peut soit lui revenir sous forme de salaire et de services sociaux, soit revenir au capitaliste sous forme de profit. Les intérêts de ces deux classes sont irréconciliables.
Ce caractère irréconciliable ressort notamment dans la lutte actuelle au Québec pour l’augmentation du salaire minimum à 15 $ l’heure. Alors que cette lutte est nécessaire pour l’amélioration des conditions de vie des travailleurs (bien que le 15 $ ne soit pas suffisant pour enrayer la pauvreté), elle est attaquée de toutes parts par les politiciens et économistes de la classe dirigeante. Ces stratèges du capital ont compris la portée réelle des augmentations de salaire : c’est une attaque frontale au taux de profit des capitalistes. Même la lutte pour une petite augmentation de salaire est déjà l’expression de l’opposition fondamentale entre les intérêts des travailleurs et des patrons.
Ce n’est pas un hasard non plus si presque chaque lutte importante d’un secteur de la classe ouvrière au Québec ou au Canada se solde par une loi spéciale de retour au travail. Bien que le droit de grève soit reconnu, celui-ci est retiré par les gouvernements aussitôt que les travailleurs mettent sérieusement en danger les profits des patrons. La récente grève de la construction au Québec l’a encore une fois démontré.
Pendant des décennies, on nous disait que le capitalisme avait surmonté ses contradictions, que c’était possible de concilier les intérêts des patrons et des travailleurs, que la lutte des classes était une chose du passé, ou même encore que « la classe ouvrière n’existe pas ». La réalité d’aujourd’hui, en particulier depuis la crise de 2008 et l’austérité sévère qui l’a suivie, nous montre la fausseté de ces idées. Avec la crise du capitalisme qui s’approfondit et le fait qu’on en fait payer le prix aux travailleurs avant tout, nous assistons à un retour de la lutte des classes d’un bout à l’autre de la planète. De plus en plus de travailleurs et de jeunes sont conscients que le capitalisme ne peut plus rien leur apporter de positif, et ce, malgré les justifications que persistent à donner les intellectuels et théoriciens de la classe capitaliste.
La révolution scientifique de Marx
Les économistes libéraux, depuis même avant Marx, ont construit ce mythe que la « science économique », c’est-à-dire la théorie économique libérale, aurait découvert les « lois objectives et naturelles du marché capitaliste ». Les prédécesseurs de Marx, les économistes libéraux comme David Ricardo et Adam Smith, bien que d’honnêtes scientifiques, se sont bornés à ne saisir que l’apparence du mode de production capitaliste.
Par exemple, ils expliquaient la création du profit par l’échange des marchandises sur le marché : le profit proviendrait du fait de vendre une marchandise plus chère que le prix auquel on l’a préalablement acheté. Or comme Marx l’explique, si tous les vendeurs essayaient de faire du profit en vendant plus cher, ils finiraient tous par acheter également des marchandises au-delà de leur valeur réelle. Ainsi, si tous les vendeurs s’escroquaient mutuellement, à l’échelle de la société globale, aucun d’eux ne ferait de profit. Comme nous l’avons expliqué, le profit du capitaliste n’est pas généré par la vente, mais la vente ne fait que réaliser en argent une quantité de valeur qui a été produite par le salarié et volée par le capitaliste.
Les théoriciens libéraux d’avant Marx ont été capables de faire avancer notre compréhension de l’économie politique à une époque où la lutte des classes entre bourgeois et travailleurs n’était pas encore très développée. Mais c’est réellement Marx qui a été capable d’aller plus loin, et d’expliquer les lois de la production capitaliste dans son ensemble. C’est Marx qui a été capable de dépasser l’apparence des phénomènes économiques comme l’argent, la marchandise, le capital, le salaire, etc. Il a montré que l’économie est le terrain d’une lutte éminemment politique, où s’opposent des intérêts de classe diamétralement opposés. Aujourd’hui, les économistes libéraux, aveuglés par les intérêts de la classe capitaliste dirigeante, sont incapables de dépasser l’apparence des phénomènes économiques et de voir cette exploitation qui se trouve au cœur même du système capitaliste. Comme l’expliquait déjà Trotsky en 1939 :
« La doctrine économique qui est enseignée aujourd'hui dans les institutions officielles et prêchée dans la presse bourgeoise nous offre une importante documentation sur le travail, mais elle est complètement incapable de saisir le processus économique dans son ensemble et de découvrir ses lois et ses perspectives, et n'a d'ailleurs pas envie de le faire. L'économie politique officielle est morte. »
À l’heure actuelle, dans les universités, on enseigne encore ce cadavre qu’est « l’économie politique officielle », soit la théorie libérale. S’il est vrai que la théorie économique marxiste est parfois enseignée dans les universités, on ne l’enseigne qu’à la condition de la vider de toute sa substance révolutionnaire. Ce n’est pas accidentel : de la théorie de Marx découle la conclusion que le capitalisme doit disparaître, et qu’il faut s’organiser pour y arriver.
Les fossoyeurs du capital
Marx nous a montré que le capital ne survit qu’en se nourrissant de la force de travail des ouvriers, qu’il suce la force vitale de la classe ouvrière comme un vampire. Mais le parasite n’existe que grâce à son hôte. Marx avait compris que le processus de concentration du capital faisait tendre à la « prolétarisation » massive de la population, ce que nous constatons aujourd’hui alors que la paysannerie ne constitue plus qu’une petite fraction de la population mondiale et que bien des emplois associés aux professions dites « libérales » pratiquent dans les mêmes conditions que la majorité des travailleurs. Le capital a progressivement créé une classe ouvrière de plus en plus puissante, puisque de plus en plus nombreuse et à même de stopper la production sur les lieux de travail. Marx disait que « pas une ampoule ne brille, pas une roue ne tourne, sans la gentille permission de la classe ouvrière ».
Quand les travailleurs se refusent à produire, comme pendant les grèves, la circulation du capital est paralysée. C'est dans ces moments que la classe ouvrière commence à prendre conscience de son pouvoir et de sa capacité à transformer la société. Comme Marx et Engels l’affirmaient à la fin du Manifeste du Parti communiste : « la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs ». C’est à eux que revient le fait d’avoir expliqué que la classe ouvrière était la classe qui, par sa relation contradictoire avec le capital, était appelée à mettre fin à sa domination.
La croissance des mouvements de lutte sociale et de mouvements anti-austérité à l’échelle mondiale depuis 2008 ne constitue qu’un avant-goût de la période de lutte des classes dans laquelle nous sommes entrés. La classe ouvrière mondiale ne fait que commencer à s’étirer les muscles. Elle devra vivre plusieurs expériences de lutte avant d’arriver à la conclusion que c’est le capitalisme lui-même qui doit être aboli, en commençant par l’expropriation des grands industriels et des banquiers qui dominent actuellement nos vies.
La théorie révolutionnaire développée par Marx dans Le Capital fournit aux militants marxistes les armes conceptuelles qui vont nous permettre de convaincre les travailleurs salariés de reprendre leur destinée en main, de prendre le pouvoir politique pour entamer la transformation socialiste de la société. Pour les marxistes, la théorie est un guide pour l’action. Cela était d'autant plus vrai pour Marx lui-même. Tandis qu’il écrivait Le Capital, Marx était également activement impliqué dans la construction de l’Association internationale des travailleurs (la « Première Internationale »), soit la première tentative d’unir les travailleurs de tous les pays dans la lutte contre le capitalisme. Notre tâche aujourd’hui, en tant que révolutionnaires, est la même, soit de construire une organisation révolutionnaire basée sur les idées de Marx, et défendre auprès de la classe ouvrière un programme authentiquement socialiste, le seul pouvant réellement renverser la domination du capital.