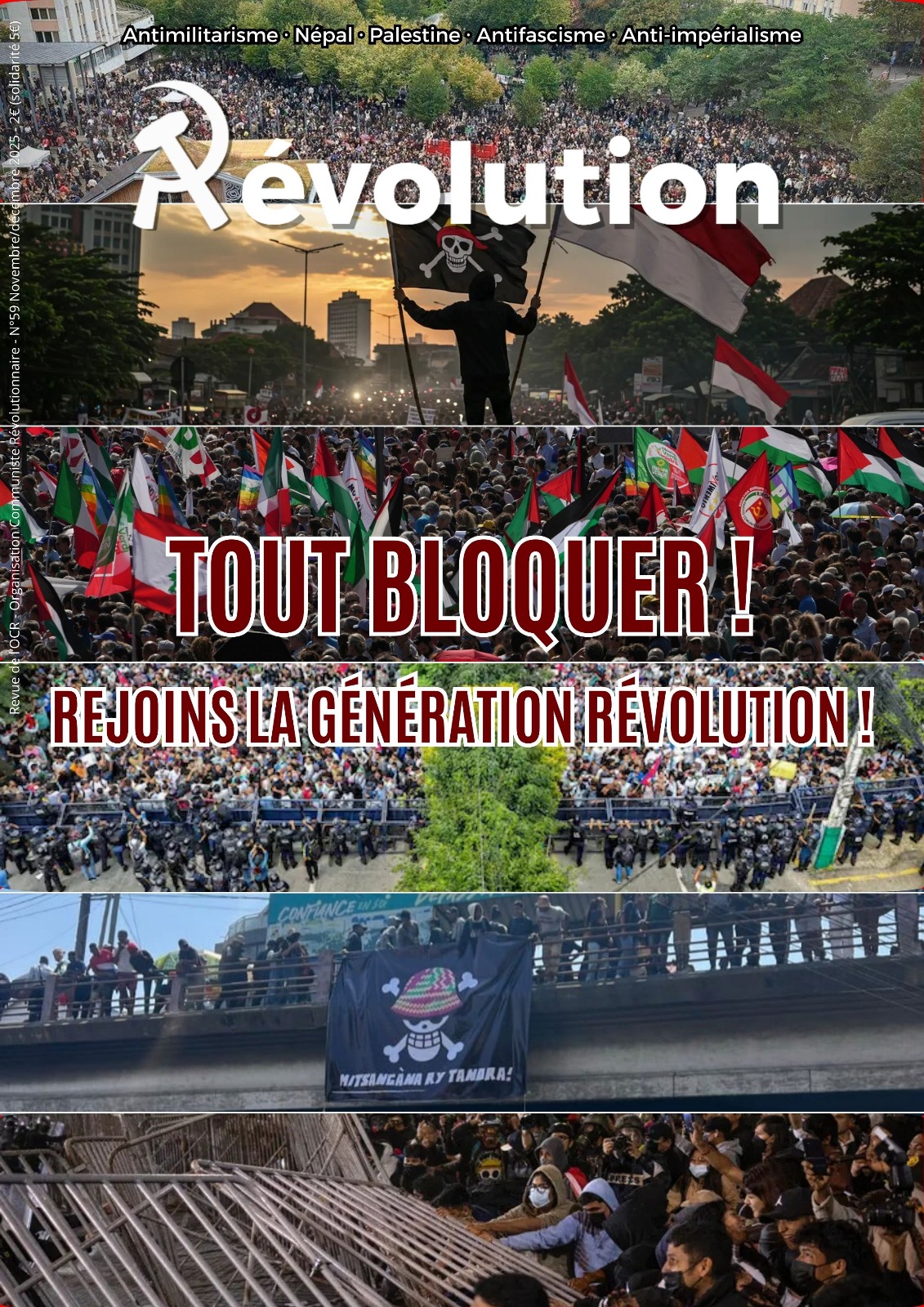L’Algérie vit des heures historiques. La mobilisation révolutionnaire de la population – et en particulier des jeunes – a fait tomber le président Abdelaziz Bouteflika, que l’armée avait hissé au pouvoir après la sanglante décennie de guerre civile des années 90. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les manifestations de masse continuent et visent désormais l’ensemble du régime, qui jusqu’alors se cachait derrière le vieux président infirme.
Commencé mi-février après l’annonce de la candidature de Bouteflika à sa propre succession, le mouvement a pris très vite des proportions colossales. Au cours du seul mois de mars, il y a eu quatre gigantesques journées d’action, avec des millions de personnes dans les rues et deux mouvements de grève très suivis, dont le dernier a paralysé une grande partie du secteur privé et des entreprises nationalisées. L’esprit révolutionnaire a balayé tous les garde-fous que le régime utilisait habituellement, face aux mouvements sociaux. Les menaces de l’armée et les références à la guerre civile des années 90 n’ont eu aucun effet.
En maint endroit, le puissant syndicat UGTA a échappé au contrôle de sa direction, qui est un soutien notoire du régime. Dans de nombreuses villes, ce sont les sections locales de l’UGTA qui ont organisé la grève générale. A Tizi-Ouzou, l’UGTA locale a même désavoué sa direction nationale, incarnée par son secrétaire général, Sidi Saïd, un indéfectible partisan de Bouteflika. A la fin du mois de mars, le slogan « A bas Sidi Saïd ! » est devenu presque aussi populaire que les slogans visant Bouteflika.
Les grèves ont frappé de terreur les piliers du régime, qui ont commencé à se détourner du président agonisant et de sa clique. De la fédération patronale à la direction de l’UGTA, en passant par l’association des moudjahidin (anciens combattants de la guerre d’indépendance), tous ont désavoué le régime et appelé à la démission de Bouteflika. Le 2 avril, privé de tout appui, Bouteflika a dû jeter l’éponge et annoncer sa démission. Abdelkader Bensalah, le président du Conseil constitutionnel, a été désigné pour assurer l’intérim jusqu’aux élections présidentielles, annoncées pour le 4 juillet.
Dans sa déclaration de démission, Bouteflika a dénoncé la pression qu’il avait subie de la part de l’armée. Elle a effectivement joué un rôle dans sa chute. Au début de la mobilisation, ses déclarations publiques, et notamment celles du chef d’Etat-major Ahmed Gaïd Salah, étaient très hostiles aux manifestants. L’armée agitait le spectre d’une nouvelle guerre civile et du terrorisme islamiste, si les manifestations devaient continuer. Mais à partir de la fin du mois de mars, face à la puissance de la vague révolutionnaire, le ton a changé. Gaïd Salah a soudainement découvert que Bouteflika était inapte à gouverner. Le 1er avril, il exigeait que ce dernier démissionne « immédiatement ».
L’armée tente de gérer la transition
Ce changement d’attitude de l’armée reflète les divisions au sein de la classe dirigeante. Une fraction, groupée derrière Bouteflika et aujourd’hui derrière le président par intérim Bensalah, est hostile à l’idée de faire la moindre concession aux masses révolutionnaires. Ils craignent – non sans raison – que de telles concessions encouragent le mouvement et le radicalisent davantage. C’est pour cela qu’ils ont momentanément essayé de repousser les élections du 4 juillet, avant d’être rappelés à l’ordre par l’armée. Celle-ci est bien consciente que si rien n’est fait, c’est l’ensemble du régime qui risque d’être balayé. Le ralliement de nombreux policiers aux manifestants, en février et mars, a montré que les forces de répression elles-mêmes étaient peu « fiables ». Au lieu de laisser traîner les choses et risquer un effondrement complet du système, les généraux tentent de détourner le mouvement vers une voie plus sûre, avec des élections le plus tôt possible, de façon à redonner un semblant de légitimité au régime.
Dans sa tentative de sortie « contrôlée » de la crise, l’armée peut compter sur le soutien discret – mais réel – de l’impérialisme français. Macron a d’abord été silencieux face aux manifestations. Puis, après l’annonce par Bouteflika du report (indéfini) des élections et de son renoncement à un nouveau mandat, le gouvernement français a apporté son soutien à cette « transition » de façade. Enfin, face à la poursuite des manifestations, Paris a décidé de soutenir l’intervention des sommets de l’armée.
Le gouvernement français n’a aucun intérêt à la démocratie pour le peuple algérien. Il ne cherche qu’à défendre les intérêts du capitalisme français. Les entreprises hexagonales sont très présentes en Algérie. Elles pillent copieusement ses richesses, avec la complicité de la classe dirigeante algérienne. Une remise en cause de cette domination impérialiste ferait perdre des milliards aux capitalistes français.
Arrestations d’oligarques
Depuis la chute de Bouteflika, l’armée multiplie les déclarations de fidélité au peuple et les gestes symboliques pour tenter de démontrer son ralliement à la révolution. Les généraux essaient de saper la confiance des masses en leur propre pouvoir, en se posant eux-mêmes en garants de la démocratie et en héros de la lutte anti-corruption.
Ainsi, l’oligarque Ali Haddad, président du Forum des Chefs d’Entreprises et proche de Bouteflika, a été arrêté alors qu’il tentait de fuir le pays avec un passeport britannique et de l’argent. Le 22 avril, c’était au tour d’Issad Rebrab, PDG du plus grand groupe privé du pays et première fortune d’Algérie, d’être arrêté pour fraude fiscale.
Ces arrestations ont pour objectif de prouver au peuple – pour le démobiliser – que le nouveau pouvoir veut purger le régime de la corruption. Dans le même temps, elles reflètent les luttes de fraction qui se déroulent, en coulisses, entre les différentes cliques qui se partagent les revenus de l’Etat et les subsides de l’impérialisme. Les généraux eux-mêmes sont corrompus et sont donc mal placés pour jouer aujourd’hui aux pourfendeurs de la corruption.
La mobilisation continue
En réalité, la démission de Bouteflika n’a rien changé de fondamental au système. Cette « transition » est une manœuvre du régime pour créer l’illusion d’un changement, sans toucher à la véritable organisation du pouvoir. Le président par intérim Abdelkader Bensalah et le chef d’Etat-major Gaïd Salah ont été des alliés fidèles de Bouteflika – jusqu’aux jours précédant sa chute. Les manifestants qui continuent de descendre dans les rues ont donc bien raison de dénoncer le fait que ceux qui sont aujourd’hui au pouvoir l’étaient en réalité déjà avant la chute de Bouteflika. Comment pourrait-on leur faire confiance pour mettre en place des élections démocratiques ?
Les élections du 4 juillet, entièrement organisées par des cadres de « l’ancien régime », ne seront qu’une mascarade organisée avec la complicité de l’opposition « modérée », qui espère glaner quelques miettes en récompense de ses services.
Les manifestations ont donc continué durant tout le mois d’avril contre le « système Bouteflika sans Bouteflika ». L’accroissement de la répression n’y a rien changé. L’envoi de la police antiémeute contre la manifestation des étudiants à Alger, le 16 avril, n’a pas entamé leur détermination. Le vendredi suivant, les masses sont descendues dans les rues de la plupart des grandes villes pour clamer leur opposition à la soi-disant « transition » organisée par le régime. A tel point que la police a dû se faire beaucoup plus discrète contre les étudiants, le mardi suivant.
De son côté, la direction de l’UGTA est plongée dans une crise profonde. Alors que son secrétaire national, Sidi Saïd, est de plus en plus contesté, la direction a dû avancer à fin juin son prochain congrès, qui était prévu pour 2020. Là aussi, il s’agit de jeter du lest, en la personne de Sidi Saïd, pour éviter que l’ensemble de la direction ne soit balayée par sa base.
Organiser les comités de grève
S’il veut vaincre, le mouvement doit s’organiser. C’est la leçon qui doit être tirée des révolutions de 2011 en Tunisie et en Egypte : des manifestations de masse peuvent faire tomber tel ou tel dirigeant ou gouvernement, mais elles ne peuvent pas – à elles seules – mettre en place un nouveau pouvoir défendant les intérêts du peuple. La place laissée vacante ne le reste jamais longtemps. En Egypte, c’est l’armée qui a fini par prendre le pouvoir sur le dos des manifestants qui ont renversé Moubarak, puis Morsi.
En Algérie, des comités de grève sont apparus au mois de mars. Dans des villes comme Tizi Ouzou et Bejaia, ils ont même eu brièvement le pouvoir en mains. Cette expérience doit être généralisée et ces comités liés entre eux à l’échelle régionale et nationale. C’est ainsi que la révolution peut faire jaillir les éléments embryonnaires d’un nouveau type de pouvoir, basé sur la classe ouvrière, la jeunesse et la population pauvre. Il va sans dire qu’ils seront bien plus compétents, pour administrer la société, que les parasites qui la dirigent actuellement.
Alors que le pays est riche en ressources naturelles, seule une minorité s’enrichit aujourd’hui en se vendant aux impérialistes. A l’autre pôle de la société, des dizaines de milliers de jeunes sont forcés de quitter le pays tous les ans. Ceux qui restent sont, pour la plupart, forcés de vivre dans des conditions précaires, sautant d’un emploi temporaire à l’autre, s’ils ont de la chance. La jeunesse, qui forme la majorité de la population, est confrontée à un taux de chômage de 30 %. Au moins 24 % de la population vit dans la pauvreté. Le pouvoir d’achat moyen a chuté de 60 % depuis 2014.
Seuls les travailleurs d’Algérie ont intérêt à véritablement développer le pays et mettre fin à la misère. Pour cela, il leur faudra s’attaquer, non seulement au régime pourrissant du capitalisme algérien, mais aussi aux rapaces impérialistes.
Leur lutte est la nôtre !
Vive la révolution algérienne !