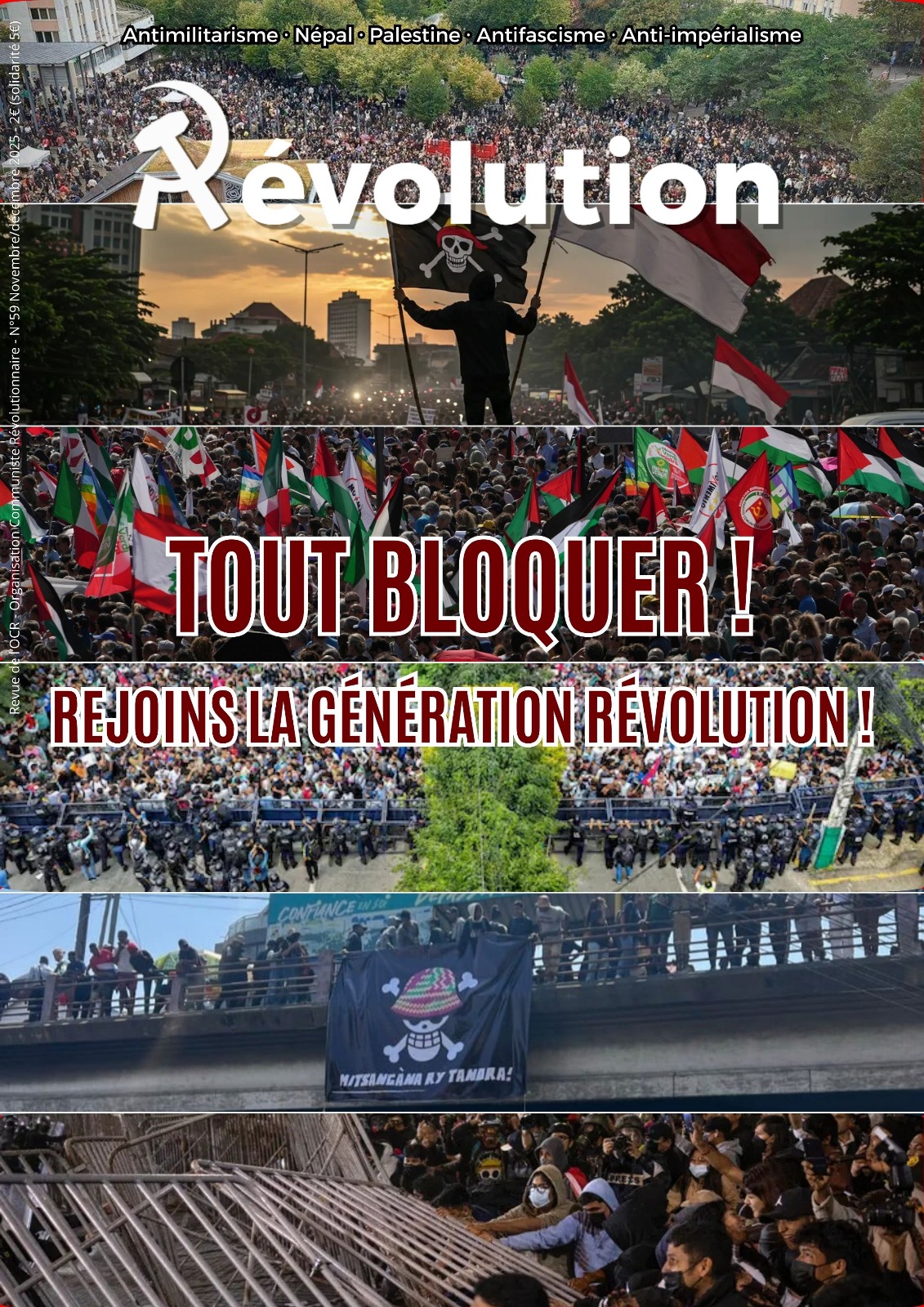Vendredi 25 novembre, le leader de la révolution cubaine, Fidel Castro, est décédé à l’âge de 90 ans. Son frère Raúl a annoncé la nouvelle au peuple cubain et au monde entier autour de minuit lors d’une allocution télévisée. Sa mort n’a pas été une surprise, puisqu’il était malade depuis de nombreuses années et avait déjà quitté ses fonctions politiques officielles, mais la nouvelle a tout de même causé une onde de choc parmi ses amis comme parmi ses ennemis.

Toute sa vie a été inextricablement liée à la révolution cubaine. Pour bien apprécier son rôle, il faut faire le bilan de la révolution cubaine, la première à avoir aboli le capitalisme dans l’hémisphère occidental, une révolution ayant résisté pendant un demi-siècle à l’assaut de l’impérialisme américain malgré seulement 150 kilomètres séparant les deux pays.
À propos de la mort du président du Venezuela et chef révolutionnaire Hugo Chavez, Castro faisait remarquer : « Vous voulez savoir qui était Hugo Chavez ? Regardez qui pleure sa mort et qui la célèbre ». La nouvelle de son décès a été reçue avec joie par les exilés cubains contre-révolutionnaires de Miami, par l’opposition réactionnaire au Venezuela et par les commentateurs des médias de droite et « libéraux » à travers le monde.
À l’inverse, la mort de Fidel a été un coup dur pour des millions de travailleurs et de travailleuses, de jeunes, de révolutionnaires et de militants de gauche en Amérique latine et à travers le monde, pour qui Castro constitue un symbole de la révolution cubaine, de la lutte contre l’impérialisme et d’une société garantissant à tous l’accès à des systèmes de santé et d’éducation de qualité.
Il existe de très bonnes raisons pour les classes dirigeantes à travers la planète de le détester autant, et pour l’impérialisme américain qui a tenté de l’assassiner plus de 600 fois. La révolution cubaine, en abolissant le capitalisme, a réussi à éradiquer l’analphabétisme, à attribuer un toit à tous ses citoyens, à bâtir un système de santé de première qualité capable de réduire la mortalité infantile et d’accroître l’espérance de vie à des niveaux similaires à ceux des pays capitalistes avancés, et à améliorer grandement le niveau d’éducation de son peuple. Tout cela dans un pays qui, avant la révolution, jouait le rôle de maison close et de casino pour les États-Unis, et ce, malgré des décennies d’attaques terroristes et de blocus commercial et d’embargo criminels imposés par Washington.
Nous prenons inconditionnellement parti pour la défense de la révolution cubaine, pour ces mêmes raisons. Voilà notre point de départ. Toute évaluation de la personne de Fidel Castro et de la révolution cubaine doit être objective et critique, si l’on veut en tirer les leçons appropriées. Mais pour cela, il faut commencer par reconnaître les progrès historiques accomplis par la révolution, qui ont été obtenus grâce à l’expropriation des capitalistes, des impérialistes et des propriétaires fonciers.
Pour ne citer que quelques exemples : la révolution cubaine a aboli l’analphabétisme, et a maintenant réussi à abolir la malnutrition des enfants. L’espérance de vie à Cuba est de 79,39 ans, soit plus que les 78,94 ans aux États-Unis et 16 ans de plus qu’à Haïti, pourtant juste à côté. Le taux de mortalité infantile (nombre d’enfants morts avant d’atteindre un an par 1000 naissances) à Cuba est de 4,5 alors qu’il est de 5,8 aux États-Unis et de 48,2 à Haïti.
Fidel est né en 1926 à Birán dans la province de Holguín, dans l’est de Cuba, d’une famille de propriétaires fonciers. Il a fréquenté des écoles religieuses privées à Santiago et ensuite à La Havane. Il a commencé à s’impliquer en politique durant ses études de droit à l’Université de La Havane.
Cuba fut le dernier pays d’Amérique latine à atteindre son indépendance formelle, mais sitôt libéré de l’impérialisme espagnol en décomposition par la lutte révolutionnaire, en 1898, le pays est tombé dans les griffes de l’impérialisme américain naissant. Le puissant voisin du Nord dominait l’économie cubaine presque complètement, ce qui lui permettait d’exercer son contrôle sur la politique du pays. Pendant un temps, l’amendement Platt formalisait cette domination humiliante sous la forme d’une clause dans la Constitution cubaine permettant l’intervention militaire des États-Unis dans le pays. Un brûlant sentiment d’injustice et un profond désir de souveraineté nationale ont provoqué plusieurs vagues de lutte révolutionnaire dans la première partie du XXe siècle. Fidel s’est familiarisé avec cette lutte, et a été inspiré par les plus importantes figures de la guerre d’indépendance cubaine.
Dans le même temps, l’île disposait aussi d’une large classe ouvrière ayant développé des traditions combatives, à commencer par une puissante tendance anarcho-syndicaliste, plus tard suivie par un parti communiste militant, une large opposition de gauche, une grève générale insurrectionnelle en 1933, etc. La libération nationale et la libération sociale sont devenues étroitement liées, comme en témoigne la pensée de Julio Antonio Mella, le fondateur du Parti communiste cubain, ou encore Antonio Guiteras, le fondateur du mouvement Joven Cuba, parmi d’autres.
En 1945, lorsque Fidel étudiait à l’université, la génération de jeunes de la classe moyenne qui commençait à s’intéresser à la politique radicale n’était pas du tout attirée par le Parti communiste cubain (connu sous le nom de PSP – Partido Socialista Popular), qui les dégoûtait. Le PSP, suivant la politique de « la démocratie contre le fascisme » du Komintern stalinien, avait participé au gouvernement de 1940-1944 du dictateur Fulgencio Batista.
Fidel était attiré par la lutte politique anti-impérialiste, ce qui l’amena à participer à une expédition militaire ratée en République dominicaine ayant pour but de renverser la dictature de Trujillo en 1947. En 1948, il fit partie d’une délégation d’un congrès étudiant latino-américain en Colombie, où il fut témoin du soulèvement de Bogotazo qui avait suivi l’assassinat du leader radical Jorge Eliécer Gaitán, le 9 avril.
Castro s’est aussi lié au Parti orthodoxe de Chibás, un sénateur populaire dénonçant la corruption du Parti Authentique auquel il avait adhéré par le passé, et qui s’est suicidé en 1951.
En 1952, Fulgencio Batista réussit un deuxième coup d’État. Fidel et un groupe de camarades (notamment son frère Raúl, Abel Santamaría, sa soeur Haydée et Melba Hernández) commencèrent à bâtir une organisation combattante, la plupart des membres du groupe étant issus de la jeunesse du Parti orthodoxe. Le 26 juillet 1953, ils lancèrent un assaut téméraire contre la caserne de Moncada à Santiago. Leur but était de s’emparer d’un grand nombre d’armes et d’en appeler à un soulèvement national contre la dictature de Batista. Leur tentative échoua, et près de la moitié des 120 jeunes hommes et femmes ayant participé furent assassinés après avoir été capturés.
La plaidoirie de Fidel lors de sa défense, dont il se servit pour expliquer son programme et qui finit par son fameux « Condamnez-moi ! L’histoire m’acquittera » le rendit célèbre. Le programme de ce qui devint par la suite connu sous le nom de Mouvement du 26 juillet (M-26-7) se résumait en cinq lois révolutionnaires qu’ils avaient eu l’intention de diffuser :
La restauration de la Constitution cubaine de 1940.
La réforme agraire.
Le droit pour les travailleurs industriels à bénéficier de 30 % des profits de leur entreprise.
Le droit pour les travailleurs du sucre de recevoir 55 % des profits de leur entreprise.
La confiscation des biens des personnes reconnues coupables de détournement de fonds dans les administrations précédentes.
Il s’agissait d’un programme national démocratique progressiste, qui contenait aussi certaines mesures visant à améliorer la condition des travailleurs. Le programme n’allait certainement pas au-delà des limites du système capitaliste, et il ne remettait pas en question la propriété privée. Après un moment en prison, Fidel fut gracié et partit au Mexique.
Autour du programme de Moncada, ils organisèrent un groupe d’hommes qui partirent vers Cuba sur le bateau Granma à la fin de 1956. Encore une fois, l’idée était que cela coïncide avec un soulèvement dans l’est du pays, autour de Santiago. À nouveau, leur plan échoua et la plupart des membres de l’expédition furent tués ou capturés dès les premières heures. Douze d’entre eux seulement s’en sortirent et durent se retirer dans les montagnes de la Sierra Maestra. Et pourtant, deux ans plus tard, le 1er janvier 1959, Batista se trouvait obligé de fuir le pays, et la révolution cubaine triomphait.
Leur victoire lors de la guerre révolutionnaire s’explique par une série de facteurs : l’extrême pourriture du régime, la guérilla dans les montagnes qui, grâce à des méthodes révolutionnaires de réforme agraire, réussit à gagner l’appui de la paysannerie et à démoraliser les soldats conscrits, l’opposition généralisée des classes moyennes des « llanos » (les plaines), mais aussi la participation significative du mouvement ouvrier (ce qui est moins connu). La grève générale insurrectionnelle déclenchée par le M-26-7 porta le coup de grâce au régime. Elle dura une semaine, jusqu’à l’arrivée des colonnes de la guérilla.
Les deux années suivantes furent les années de la radicalisation rapide de la révolution. La mise en œuvre du programme national démocratique de Moncada, et en particulier de la réforme agraire, provoqua la fureur de la classe dominante, le départ des éléments plus modérés des premiers gouvernements révolutionnaires, l’enthousiasme des masses de travailleurs et de paysans qui en demandaient encore plus ainsi que la réaction de l’impérialisme américain devant toutes ces mesures de plus en plus radicales de la révolution contre leur propriété sur l’île.
La mise en œuvre cohérente du programme national démocratique mena à l’expropriation des entreprises multinationales américaines et, puisqu’elles dominaient les secteurs clés de l’économie, à l’abolition de facto du capitalisme en 1961. Un jour, je demandai à un camarade cubain, qui avait été impliqué dans le mouvement révolutionnaire et syndical à Guantanamo depuis les années 1930, comment il caractérisait Fidel et la direction du M-26-7. Il me répondit qu’ils étaient des « revolucionarios pequeño-burgueses guapos » (des révolutionnaires petits-bourgeois courageux). Ici, le terme « petit-bourgeois » n’était pas utilisé comme une insulte, mais plutôt pour décrire l’origine de classe de plusieurs d’entre eux, et pour caractériser le programme pour lequel ils s’étaient battus. Le fait d’avoir appliqué courageusement leur programme poussa les révolutionnaires beaucoup plus loin que ce qu’ils avaient prévu. C’est tout à l’honneur de Fidel Castro d’avoir mené le processus jusqu’à la fin.
L’existence de l’URSS, à l’époque, a aussi joué un rôle dans le cours pris par les évènements après la victoire de la révolution. Cela ne veut pas dire que l’Union soviétique a encouragé Cuba à lutter contre le capitalisme. Au contraire, il a été démontré que l’Union soviétique a cherché à décourager les révolutionnaires et leur a conseillé d’avancer lentement et prudemment. Malgré cela, le fait que l’Union soviétique ait pu combler les besoins créés par l’hostilité grandissante des États-Unis (en leur vendant du pétrole, en leur achetant du sucre de canne et en brisant le blocus) a joué un rôle important.
Pendant une dizaine d’années, toutefois, la relation entre la révolution cubaine et l’URSS a été fragile. Le Parti communiste cubain (PSP) s’est seulement joint au mouvement révolutionnaire à la dernière minute et la direction cubaine était fière de son indépendance et du fait qu’il avait sa base propre sur laquelle s’appuyer. La première période de la révolution fut riche de larges discussions et de débats sur toutes les questions (politique économique et étrangère, l’art et la culture, le marxisme) durant lesquels les staliniens tentaient, bien souvent sans succès, d’imposer leur volonté.
Fidel et les autres étaient très méfiants vis-à-vis de l’URSS, particulièrement après que Khrouchtchev en soit venu à un accord avec les États-Unis sans même les consulter au moment de la crise des missiles de 1962. De plus, particulièrement sous l’instance de Che Guevara, ils tentèrent d’étendre la révolution aux autres pays d’Amérique latine et au-delà, ce qui allait à l’encontre de la politique de « coexistence pacifique » menée par l’Union soviétique et de la vision profondément conservatrice de la plupart des partis communistes d’Amérique latine.
Ces tentatives d’exporter la révolution échouèrent, en partie à cause de la façon grossière dont l’expérience de la révolution cubaine fut généralisée. L’idée qu’un petit groupe d’hommes retranché dans les montagnes pourrait, dans un court laps de temps, mener au renversement des régimes réactionnaires (ce qui représentait une simplification excessive des conditions ayant permis la victoire cubaine) a été démentie par la pratique. L’exemple le plus extrême serait possiblement celui de la Bolivie, un pays qui avait vécu une réforme agraire partielle et ayant un prolétariat minier très combatif et avancé politiquement, où la tentative de guérilla de Che Guevara mena à sa mort en 1967 aux mains de l’impérialisme américain (qui avait lui aussi tiré des leçons de l’expérience cubaine).
Au fil du temps, la révolution cubaine s’est retrouvée isolée et donc dépendante de l’Union soviétique. L’échec de la tentative de récolter 10 millions de tonnes de sucre de canne en 1970 et la dislocation économique que cet échec provoqua ne fit qu’augmenter cette dépendance. Les rapports étroits avec l’URSS ont permis à la révolution cubaine de survivre pendant trois décennies, mais ont aussi favorisé l’émergence de forts éléments de stalinisme. Le Quinquenio Gris (le quinquennat gris) de 1971-1975 a vu l’utilisation de mesures de répression pour imposer la pensée stalinienne aux domaines des arts, des sciences sociales et autres. C’est aussi à cette époque que l’homophobie et la discrimination et le harcèlement contre les homosexuels (qui existaient déjà et qui étaient hérités du régime précédent) se sont institutionnalisés.
La manière dont la révolution avait triomphé, grâce à la direction d’une armée de guérilla, a aussi constitué un facteur expliquant la nature bureaucratique de l’État révolutionnaire. Comme Fidel lui-même l’a expliqué : « Une guerre ne se mène pas à l’aide de méthodes collectives, démocratiques, mais se fonde sur la responsabilité du commandement. » Après la victoire de la révolution, la direction bénéficiait d’une grande autorité et d’un vaste soutien. Des centaines de millions de Cubains prirent les armes sur-le-champ en 1961 pour vaincre l’invasion de la Baie des Cochons. Un million de personnes se rassemblèrent sur la Place de la Révolution en 1962 pour ratifier la Deuxième Déclaration de La Havane.
Toutefois, il n’existait pas de mécanismes démocratiques révolutionnaires par lesquels les idées pouvaient être discutées et débattues et, par-dessus tout, grâce auxquels les masses de travailleurs et de paysans auraient pu exercer leur propre pouvoir et tenir leurs dirigeants responsables.
Le Parti communiste cubain, par exemple, qui est né de la fusion du PSP stalinien, du M-27-6 et du Directoire révolutionnaire, a été fondé en 1965, mais son premier congrès n’a pas eu lieu avant 1975. Et ce n’est qu’en 1976 qu’une constitution a été adoptée. Une économie planifiée a besoin de la démocratie ouvrière tout comme le corps humain a besoin d’oxygène, étant donné qu’il s’agit de la seule façon d’exercer un suivi et un contrôle sur la production.
Ce processus de bureaucratisation a aussi eu une incidence sur la politique étrangère du pays. Cuba est la championne du monde en matière de solidarité internationale, le pays envoyant de l’aide à travers la planète, notamment sous la forme d’aide médicale. Cuba a aussi joué un rôle crucial dans la défaite du régime sud-africain en Angola, une lutte dans laquelle des centaines de milliers de Cubains ont participé pendant de nombreuses années.
Toutefois, dans des révolutions comme celle au Nicaragua en 1979-1989 et au Venezuela plus récemment, malgré le soutien pratique et matériel et la solidarité inestimables, les conseils politiques offerts par les dirigeants cubains ont été de ne pas suivre le même chemin que la révolution cubaine et de ne pas abolir le capitalisme. Cela a eu des conséquences désastreuses dans les deux pays. Au Nicaragua, l’URSS a appliqué une pression énorme pour que la direction sandiniste maintienne une « économie mixte » – c’est-à-dire une économie capitaliste – et qu’il participe aux négociations de Contadora qui ont abouti à l’étranglement de la révolution. La direction sandiniste était très proche de la révolution cubaine et avait beaucoup de respect pour elle. Le conseil de Fidel, cependant, fut le même que celui de l’Union soviétique : n’expropriez pas les capitalistes, ce que vous faites est le maximum qui peut être accompli au Nicaragua aujourd’hui. Ce conseil fut fatal.
Au Venezuela également, tandis que la révolution cubaine offrait une solidarité et un soutien précieux (en particulier avec les médecins cubains), le conseil politique qui fut donné fut encore une fois de ne pas suivre la voie qu’avait prise la révolution cubaine 40 ans plus tôt. Les conséquences du fait de ne faire qu’une demi-révolution sont tout à fait claires aujourd’hui : la dislocation des forces productives et la rébellion du capitalisme contre toute tentative de le réguler. Ce conseil a non seulement eu une incidence négative sur les révolutions nicaraguayenne et vénézuélienne, mais a aussi empiré le problème de l’isolement de la révolution cubaine elle-même.
La résistance héroïque de la révolution cubaine après la chute de l’URSS est vraiment impressionnante. Tandis que les dirigeants du Parti « communiste » de l’Union soviétique ont pris rapidement et sans effort la voie du retour au capitalisme et du pillage de la propriété d’État, Fidel et les autres dirigeants à Cuba ont défendu les acquis de la révolution. La période connue sous le nom de « Période spéciale » fut un témoignage de la vitalité de la révolution cubaine. Une génération toujours vivante se souvenait de ce qu’était la vie avant la révolution et les autres pouvaient comparer leur niveau de vie avec celui des pays capitalistes environnants.
Les dirigeants ont résisté, et le peuple cubain a trouvé de manière collective des moyens de surmonter les difficultés économiques. Complètement isolée face à l’embargo américain, Cuba a dû faire d’importantes concessions au capitalisme, tout en s’assurant que la majeure partie de l’économie demeure dans les mains de l’État. Le tourisme est devenu l’une des principales sources de revenu de l’île, avec tous les maux qui viennent avec.
Dix ans plus tard, le développement de la révolution vénézuélienne, particulièrement suivant le coup d’État manqué en 2002, a fourni une autre bouée de sauvetage pour Cuba. La révolution a permis non seulement l’échange de médecins cubains contre le pétrole vénézuélien, mais a également ravivé l’enthousiasme des masses cubaines voyant à nouveau la révolution se développer en Amérique latine. Les difficultés économiques et l’épuisement de la révolution au Venezuela – précisément dus au fait qu’elle n’a pas été jusqu’au bout pour exproprier les oligarques et les impérialistes comme Cuba l’avait fait – signifient que ce processus est en train de prendre fin.
L’impasse dans laquelle la révolution cubaine se trouve a poussé des secteurs importants de la direction vers des réformes du marché et des concessions au capitalisme inspirées de la Chine et du Vietnam. Plusieurs étapes ont déjà été franchies dans cette direction. Les dirigeants cubains espèrent que ces mesures vont au moins amener la croissance économique. C’est une illusion. Aujourd’hui, le système capitaliste est en crise et il est permis de douter du désir des capitalistes d’investir à Cuba. Cuba ne possède pas les énormes réserves de main d’œuvre bon marché qui furent un des facteurs clés du « succès » économique chinois. Mais même si tout ceci se révélait faux, il ne faut pas oublier que la restauration du capitalisme en Chine a été accompagnée d’une polarisation de la richesse, de l’exploitation brutale de la classe ouvrière et de la destruction des gains de la révolution chinoise.
C’est dans ce contexte qu’Obama a tenté de modifier la tactique des États-Unis sur la question cubaine. La stratégie demeure cependant la même : la restauration du capitalisme à Cuba et la destruction des acquis de la révolution. Plutôt que de poursuivre la tactique de la confrontation directe, celle-ci ayant échoué, les États-Unis ont décidé qu’il serait sans doute plus intelligent de détruire la révolution de l’intérieur en s’appuyant sur la domination du marché mondial sur cette petite île dépourvue de ressources et ayant un niveau de productivité du travail très bas.
Il est clair que, même après son retrait formel de toute fonction politique officielle, les impérialistes voyaient en Fidel un obstacle à ce processus. Il dénonçait publiquement le bureaucratisme et les inégalités montantes et mettait en garde contre le danger de la révolution se détruisant de l’intérieur. Dans un discours célèbre prononcé à l’Université de La Havane en novembre 2005, il a parlé de « nos faiblesses, nos erreurs, nos inégalités, notre injustice » et a prévenu que la révolution n’était pas irréversible et pourrait finir comme en Union soviétique. « Ce pays peut s’autodétruire ; cette révolution peut se détruire elle-même, mais ils ne pourront jamais nous détruire ; nous pouvons nous détruire nous-mêmes, et ce serait de notre faute », a-t-il dit, ajoutant que « soit nous surmontons ces déviations et renforçons notre révolution, soit nous mourrons. »
Cependant, le bureaucratisme n’est pas qu’une déviation, ou le problème de quelques individus. C’est un problème qui découle de l’absence de démocratie ouvrière pour la gestion de l’économie et de l’État, un problème renforcé par l’isolement de la révolution. Ceci étant dit, il est clair que les stratèges du capitalisme croyaient qu’aussi longtemps que Fidel serait en vie, peu de progrès serait fait dans la direction du capitalisme à Cuba.
Avec son décès, ils espèrent que le processus va s’accélérer. Déjà, des contradictions majeures apparaissent et un processus croissant de différenciation sociale a commencé dans le pays. Les facteurs principaux de ce processus sont : la stagnation de l’économie planifiée bureaucratiquement et la position d’extrême faiblesse de Cuba dans l’économie mondiale, résultat de l’isolement de la révolution. Il est encore une fois prouvé que le « socialisme dans un seul pays » est impossible.
Il en découle que la seule voie pour la révolution cubaine est de lutter pour le contrôle démocratique de l’économie par les travailleurs et pour une révolution socialiste tout autour du globe. C’est la seule façon de défendre les gains de la révolution cubaine.
Aujourd’hui, les impérialistes vont déblatérer contre Cuba et le non-respect des « droits humains » sur l’île. Ce sont ces mêmes personnes qui ferment les yeux sur le régime saoudien et qui mettent le drapeau en berne lorsque son dictateur semi-féodal meurt. Ce sont ces mêmes personnes qui n’ont vu aucun inconvénient dans le fait d’installer au pouvoir et de soutenir les régimes les plus brutaux au Chili, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, en Bolivie, au Venezuela, au Guatemala, en République dominicaine, au Mexique, au Nicaragua, au Salvador, au Honduras… la liste est interminable.
Nous ne parlons pas ici d’un passé lointain. Il n’y a pas si longtemps, des coups d’État financés par les États-Unis furent tentés au Venezuela, au Honduras, en Équateur et en Bolivie. Non, lorsqu’Obama et Clinton parlent de « droits humains », ils parlent du droit des capitalistes d’exploiter les travailleurs et les travailleuses, le droit des propriétaires terriens d’évincer leurs occupants, le droit des riches touristes d’acheter les femmes et les enfants.
Aujourd’hui plus que jamais, nous disons : défendons la révolution cubaine, non à la restauration capitaliste, luttons contre le capitalisme partout sur la planète !