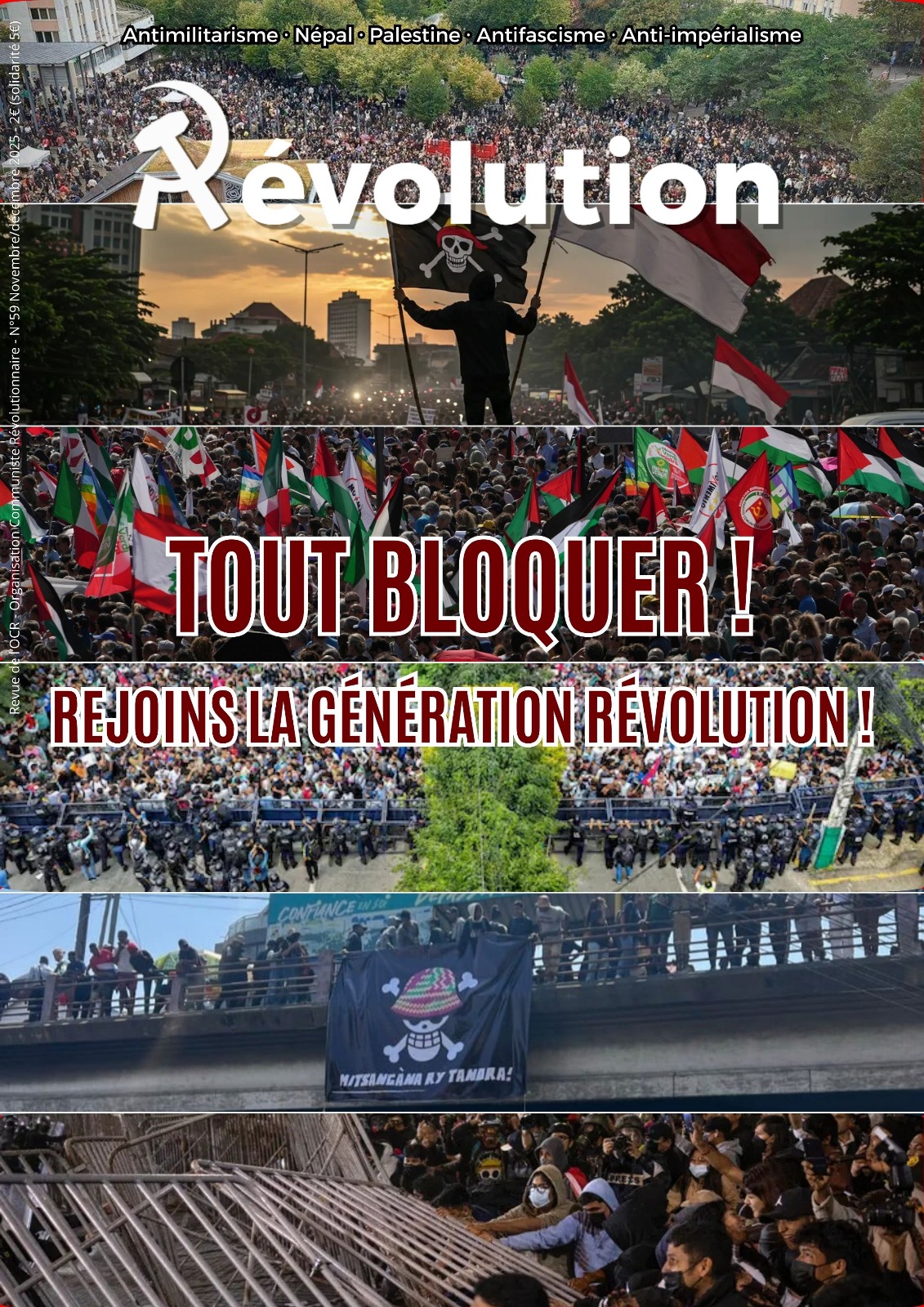Dans la nuit du 14 au 15 juillet, le parlement grec a adopté un paquet législatif contenant toutes les « mesures préalables » exigées par la troïka. Ce vote a provoqué des grèves, des manifestations, la rébellion de 38 députés de Syriza et l’opposition de la majorité des membres du Comité Central. Tsipras y a survécu mais a dû s’appuyer, au parlement, sur les voix des partis qui avaient mis en œuvre les précédents Mémorandums – auxquels Syriza s’était opposé.

La grève de 24 heures était organisée par le syndicat des fonctionnaires ADEDY, par le syndicat POE-OTA (travailleurs municipaux), par les salariés du métro d’Athènes et par les cheminots. Le soir, la manifestation était importante, mais nettement moins que l’immense rassemblement, dix jours plus tôt, en faveur du « non » au référendum. Il y avait des milliers de personnes devant le parlement – et des dizaines de milliers qui défilaient avec le PAME, le front syndical du Parti Communiste grec (KKE).
La manifestation était encadrée par un « dispositif de sécurité » semblable à ceux mis en place par les précédents gouvernements, lorsqu’ils faisaient adopter des contre-réformes draconiennes. La station de métro de la place Syntagma a été fermée à 18 heures. La police anti-émeute – détestée, et que Tsipras avait promis de dissoudre – a été déployée. Les gaz lacrymogènes ont été utilisés contre les manifestants, sous prétexte qu’un petit groupe d’anarchistes jetaient des cocktails molotov.
Dans les rangs de Syriza, l’opposition à l’accord s’est développée. De nombreuses structures locales et nationales du parti ont publié des déclarations contre l’accord, appelant le gouvernement à corriger le tir et les députés de Syriza à le rejeter. L’organisation de jeunesse de Syriza s’est prononcée contre l’accord, de même que la « Plateforme de gauche », le KOE (une autre tendance de gauche au sein de Syriza) et nos camarades de la Tendance communiste de Syriza. Aucune structure locale de Syriza ne s’est prononcée pour l’accord, à notre connaissance.
La pression s’est exprimée jusque dans le Secrétariat politique de Syriza (11 personnes). La majorité du Secrétariat a estimé que l’accord est « politiquement ingérable, socialement insoutenable », et qu’il ne doit pas être mis en œuvre. Le Secrétariat a également demandé la convocation d’un Comité Central du parti – et rejette l’idée d’exclure ou de pousser à la démission les camarades qui s’opposent à l’accord.
Encore plus significatif, l’opposition à l’accord s’est cristallisée dans une déclaration signée par 110 des 201 membres du Comité Central de Syriza, soit une majorité. C’est la première fois, depuis janvier, que la direction du parti en perd le contrôle.
Lors du débat parlementaire, la présidente du parlement, Zoe Konstantopoulou, a fait un discours très hostile à l’accord. Elle l’a qualifié de « coup » dont l’impact se solderait par un « génocide social ». Elle a déclaré que le parlement n’avait pas le droit de transformer le « non » du peuple en « oui ». « Nous n’avons pas conquis le pouvoir pour le pouvoir, camarades, mais pour le rendre au peuple », a-t-elle déclaré.
Même l’ancien ministre des Finances, Yanis Varoufakis, qui avait été un pilier de la stratégie de négociation avec la troïka, s’est prononcé contre l’accord. Il l’a comparé au traité de Versailles et a prévenu qu’il ne règlerait rien. Il a également publié une critique détaillée de l’accord sur son blog. Il y écrit : « La troïka riposte et exige du gouvernement grec qu’elle puisse revenir à Athènes en Conquérante. C’est une paix carthaginoise ».
A l’origine, Tsipras avait annoncé qu’il ne prendrait pas la parole au cours du débat parlementaire, car il avait déjà défendu l’accord lors d’une interview télévisée, la nuit précédente. C’est donc Tsakalotos, le ministre des Finances, qui a défendu l’accord au parlement, ce qu’il a fait sans enthousiasme : « Je ne sais pas si ce que nous faisons est juste. Mais je sais qu’on avait le sentiment de n’avoir pas le choix. Nous n’avons jamais dit qu’il s’agissait d’un bon accord ». Plus tôt, il avait déclaré qu’il ne savait pas si l’accord allait fonctionner.
Finalement, Tsipras lui-même a pris la parole devant le parlement, à la demande des dirigeants du PASOK et de Nouvelle Démocratie (droite), qui exigeaient du Premier ministre qu’il assume la responsabilité de l’accord. Tsipras l’a défendu sans enthousiasme, lui aussi : « Je reconnais que ces mesures sont douloureuses. Je ne suis pas d’accord avec leur contenu. Elles n’aideront pas l’économie grecque ; je le dis ouvertement. Mais je dis aussi qu’il faut les mettre en œuvre. » En substance, son seul argument en faveur de l’accord est qu’il n’y aurait pas d’alternative : « J’avais le choix entre un accord que je désapprouve – et une faillite désordonnée, l’option d’une sortie de la zone euro défendue par Schäuble ».
Au final, 229 députés ont voté pour l’accord, 64 ont voté contre et 6 se sont abstenus. Parmi les députés de Syriza, 32 ont voté contre, 6 se sont abstenus et un n’était pas présent. Varoufakis a voté contre, de même que Lafazanis, le ministre de l’Energie, Thanasis Petrakos, le porte-parole du groupe parlementaire de Syriza – et deux ministres : Stratoulis et Isichos. Après avoir démissionné, l’ex-secrétaire d’Etat aux finances, Nadia Valavani, a également voté contre. Les députés d’ANEL, l’autre parti de la coalition gouvernementale, ont tous voté pour l’accord. Cela signe probablement la fin de cette formation, qui était née d’une scission « anti-mémorandum » de Nouvelle Démocratie.
Le gouvernement n’a plus de majorité parlementaire dans ses propres rangs : l’accord n’a été validé que grâce aux voix des députés de Nouvelle Démocratie, du PASOK et de To Potami. Au total, 39 députés de Syriza ne l’ont pas voté. Vendredi dernier, ils n’étaient que 17.
L’ampleur de la fronde, dans la fraction parlementaire de Syriza, est d’autant plus significative que les députés étaient soumis à d’énormes pressions. Le groupe dirigeant de Syriza a fait campagne pour pousser à la démission des députés qui voteraient contre l’accord. L’argument suivant a été avancé (notamment par Tsipras lui-même) : dans la mesure où les dirigeants allemands complotent pour renverser le gouvernement de Syriza (ce qui est vrai), tout vote contre les « propositions » ferait le jeu de Merkel et Schläube.
Les « mesures préalables » exigées par la troïka ont donc été adoptées. Y figurent une augmentation de la TVA (de 13 à 23 %, par exemple, sur des biens alimentaires), des coupes franches et des contre-réformes dans le domaine des retraites, ainsi que « l’introduction de coupes budgétaires quasi automatiques en cas de manquement aux objectifs en matière d’excédent primaire ».
Ceci étant dit, il n’est pas garanti qu’il y aura un accord, au final. La situation peut très vite évoluer pour des raisons économiques et politiques – à Athènes, à Bruxelles et à Berlin. Les « mesures préalables » ouvrent la voie à des discussions sur un nouveau prêt à la Grèce, mais il n’est pas certain que ces discussions aboutiront effectivement à un prêt.
Un rapport du FMI – qui a « fuité », mardi – explique que l’accord se soldera par une flambée de la dette grecque, à plus de 200 % du PIB, ce qui la rendra absolument insoutenable, de sorte que les Européens doivent accorder à la Grèce un allègement substantiel de cette dette. Ceci laisse entendre qu’en l’absence d’un tel allègement, le FMI ne s’engagera pas dans un nouveau prêt à la Grèce.
Dans le même temps, le ministre des Finances allemand, Schäuble, continue d’expliquer que la meilleure option serait un Grexit « temporaire » (de 5 ans). Il dit que dans la mesure où un allègement substantiel de la dette grecque serait illégal dans la zone euro, un Grexit serait préférable.
Ainsi, la Grèce et l’Allemagne ont signé un accord auquel le Premier ministre grec dit ne pas croire – et auquel le ministre des finances allemand dit préférer un Grexit. Mais indépendamment des intentions politiques de Tsipras et Schäuble, le nouveau Mémorandum va faire face à bien d’autres obstacles. Premièrement, l’économie grecque est à l’arrêt – et l’introduction de nouvelles mesures récessives ne peut qu’aggraver la situation, comme tout le monde le reconnait. Cela ruinera les projections économiques sur lesquelles l’accord lui-même a été fondé. L’objectif de dégager un excédent primaire de 1 % n’est pas le même sur la base d’une légère croissance ou sur la base d’une sévère contraction (qui pourrait être de 5 à 10 %, selon certains économistes).
C’est une chose, pour Tsipras, de faire passer des contre-réformes au parlement (grâce aux voix de l’opposition) ; c’en est une autre de les mettre effectivement en œuvre contre la volonté de son propre parti. A cela s’ajoute l’épineux problème du prêt de 82 milliards d’euros, qui sera discuté dans les mois à venir et devra être approuvé par de nombreux acteurs qui ne sont pas franchement convaincus.
Au final, l’accord voté au parlement grec n’a fait que retarder – de quelques jours ou de quelques mois : nul ne le sait – l’issue pratiquement inévitable de cette crise, à savoir la sortie de la Grèce de la zone euro, avec toutes les conséquences que cela aura sur des économies européenne et mondiale déjà fragiles.
Les travailleurs de Grèce et d’Europe sont en train de tirer des conclusions politiques de cette débâcle d’un gouvernement qui, six mois après son élection sur un programme anti-austéritaire, a été poussé à une humiliante capitulation. Oui, cela s’est fait sous la pression d’un chantage et d’une asphyxie financière orchestrée. Mais au final, Tsipras a rendu les armes. Et comme lui-même l’a admis, la raison fondamentale de cette capitulation, c’est qu’il ne voyait pas d’alternative. Pour dire les choses autrement, il a limité son action au cadre du capitalisme en crise. Koutsoumbas, le secrétaire du KKE, a dit à Tsipras : « vous dites que vous avez fait tout votre possible pour combattre le chantage de la troïka. Vous mentez. Vous n’avez pas présenté d’alternative. » C’est exact.
Il n’y a pas d’alternative dans les limites du capitalisme. Autrement dit, la seule alternative consiste à rompre avec le capitalisme, à répudier unilatéralement la dette, à nationaliser les banques et les grandes entreprises – et à commencer à réorganiser l’économie dans le cadre d’une planification démocratique de la production, sous le contrôle des travailleurs et dans l’intérêt de la majorité de la population.