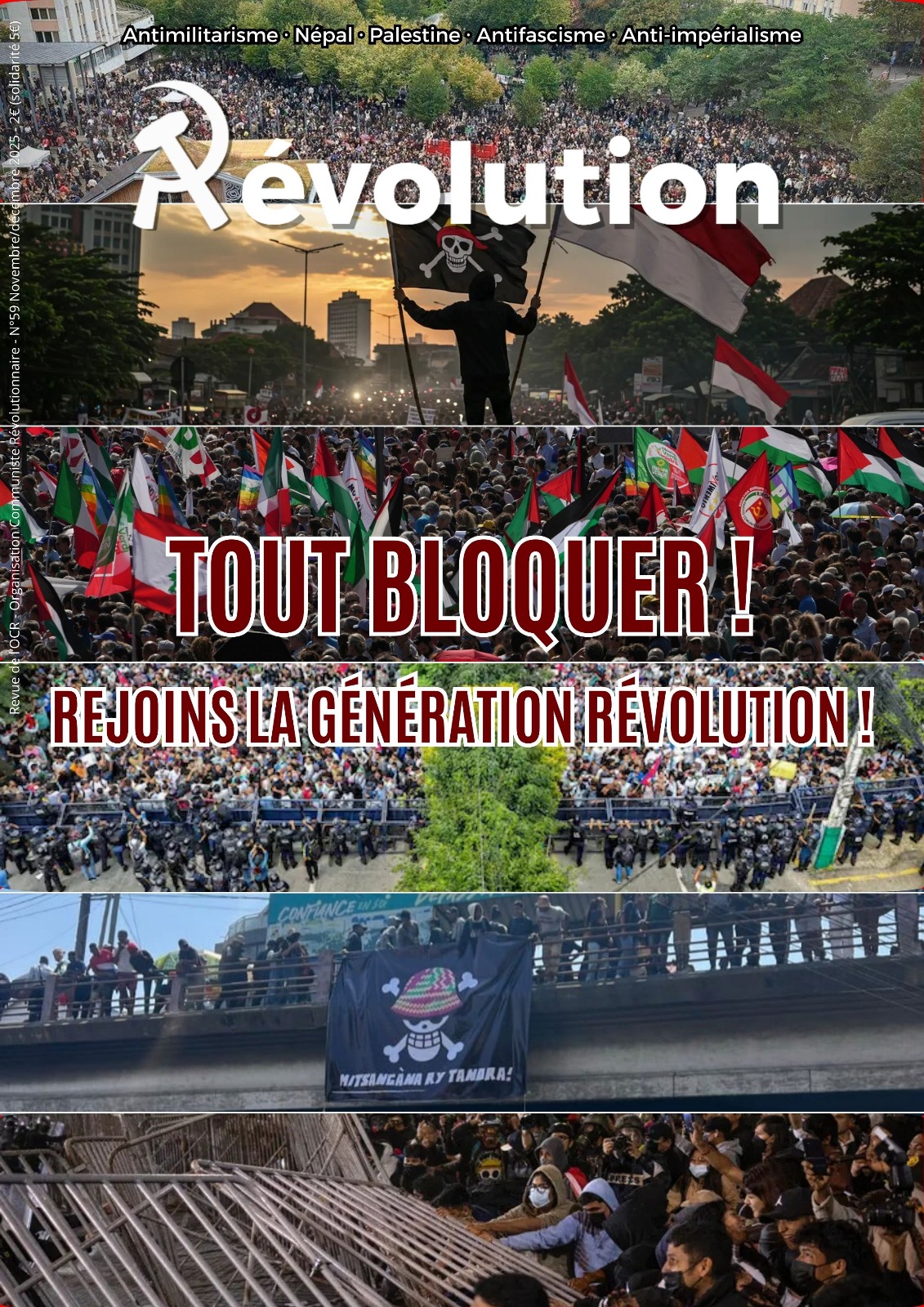L’arrivée de Syriza au pouvoir a suscité un immense espoir – en Grèce bien sûr, mais aussi dans toute l’Europe. Pour la première fois depuis le début de la crise, un parti se déclarant opposé à l’austérité a remporté les élections. Le programme électoral de Syriza – le « programme de Thessalonique » – comprenait toute une série de mesures sociales d’urgence visant à soulager les souffrances des Grecs les plus pauvres et à revenir sur les mesures réactionnaires des gouvernements précédents : augmentation du salaire minimum, restauration des conventions collectives, embauches massives de fonctionnaires, etc.

L’accord du 20 février
A peine élue, la direction de Syriza s’est lancée dans une tournée des capitales européennes, dans le but d’obtenir un compromis entre les souffrances du peuple grec et la rapacité des classes dirigeantes. Ces « négociations » reposaient sur l’illusion, dans l’esprit de Tsipras, qu’il aurait été possible de faire financer tout ou partie du programme de Thessalonique par la « troïka » (UE, FMI, BCE), à condition de lâcher du lest, notamment sur la question du remboursement de la dette. Comme c’était prévisible, du lest a bien été lâché, mais sans contreparties sérieuses de la part de la troïka.
Dans l’accord « de principe » signé le 20 février, le gouvernement s’est engagé à rembourser la dette, à faire de nouvelles coupes budgétaires et à poursuivre les privatisations déjà entamées. L’accord évoque même la possibilité de nouvelles privatisations. Il prévoit par ailleurs que la troïka aura son mot à dire sur toutes les mesures progressistes que le gouvernement de Tspiras voudra mettre en œuvre. Le rétablissement du salaire minimum à 751 euros (contre 586 aujourd’hui) et des conventions collectives sont ainsi suspendus à l’approbation de ceux qui ont dicté les contre-réformes dans ce domaine, ces dernières années. Pour compliquer encore les choses, l’accord prévoit que les « mesures d’urgence » (ou « humanitaires ») pour les plus pauvres devront être « fiscalement neutres », c’est-à-dire n’engager aucune nouvelle dépense publique.
Cet accord mettait aussi l’accent sur la lutte contre la fraude fiscale et la corruption, censée rapporter au moins 3,5 milliards d’euros (une goutte d’eau dans l’océan). Mais en fait, même ces mesures ont été plus ou moins abandonnées pour ne pas risquer de s’attaquer aux véritables profiteurs du système, les oligarques et les grands patrons qui bénéficient de mesures fiscales outrageusement favorables. La lutte contre la fraude fiscale se concentrerait donc maintenant sur les fraudes à la TVA, c’est-à-dire sur les petits commerces et les petites entreprises. Cela ne rapportera que peu d’argent au gouvernement, mais risque de rejeter vers les néo-fascistes de l’Aube Dorée toute une couche de la petite bourgeoisie grecque, qui pourtant pourrait soutenir Syriza si celui-ci s’attaquait vraiment à la Troïka et au grand patronat grec.
Une des pires erreurs que l’on peut faire en politique, c’est d’essayer de faire passer une défaite pour une victoire. C’est ce qu’ont fait Tsipras et Varoufakis, son ministre de l’économie. Pour eux, l’accord du 20 février est une bataille « gagnée » qui devrait assurer le financement des mesures progressistes. L’humiliation permanente du peuple grec par la troïka n’aurait plus cours, car on ne parle plus de « la troïka », mais des « institutions » et parce que les représentants de ces institutions ne devraient plus venir inspecter les ministères grecs pour y dicter leurs politiques. Or, changer le nom de la troïka ne change pas les « institutions » en question, ni leurs rapacités. Et leurs représentants ont bien l’intention de venir vérifier l’application des accords sur le terrain, si la troïka prête à nouveau de l’argent au pays.
Cette « victoire » rhétorique a rencontré une certaine opposition au sein de Syriza, où nos camarades de la Tendance Communiste de Syriza l’ont dénoncée comme un « sérieux recul ». D’autres dirigeants connus ont aussi critiqué cet accord, dont le ministre de l’Energie Lafazanis – ou encore Manolis Glezos, qui s’est rendu célèbre en 1941 en arrachant le drapeau nazi qui flottait sur l’acropole. De façon significative, lors du vote au Comité Central de Syriza, 41 % des voix se sont prononcées contre l’accord avec la troïka.
Le fardeau de la dette
Pendant ce temps, les remboursements des emprunts contractés par la Grèce se poursuivent, comme ceux au FMI le 9 avril dernier. A cette occasion, la crainte d’un « défaut », c’est-à-dire d’une incapacité du gouvernement grec à payer ses créances, a plané pendant plusieurs semaines. Varoufakis, qui se définit lui-même comme un marxiste « erratique » voulant « sauver le capitalisme malgré lui », a rassuré plusieurs fois les créanciers : la Grèce paiera. Mais, en pratique, les difficultés vont se reproduire à chaque versement, la Grèce étant à court de liquidités alors que les versements à venir sont de plus en plus gros. Après avoir payé 400 millions d’euros au FMI en avril, la Grèce doit en payer 879 millions en mai.
Tsipras tente d’utiliser cette crainte d’un défaut pour faire pression sur le gouvernement de Merkel. De même, les déclarations au sujet des réparations de guerre que l’Allemagne devrait encore payer à la Grèce sont des moyens de pression que le gouvernement grec utilise dans le cadre des négociations d’un nouvel accord. Mais c’est peine perdue : les capitalistes allemands, comme le Shylock de Shakespeare, veulent leur « livre de chair » – et rien de moins.
Les capitalistes allemands figurent parmi les premiers créanciers de la Grèce, ce qui explique qu’ils exercent une pression sensible sur Merkel, accusée dans son propre parti d’être trop souple face aux Grecs « fainéants » et « fraudeurs ». Berlin, comme l’ensemble des classes dirigeantes européennes, craint par ailleurs que des concessions à la Grèce ne donnent un « mauvais exemple » aux autres pays vacillant sous le coup de la crise : le Portugal, l’Irlande ou encore l’Espagne.
Le gouvernement de Syriza essaie de s’appuyer sur les rivalités et les divergences d’intérêts entre les puissances impérialistes pour trouver de nouvelles aides financières. C’est le sens du récent voyage de Tsipras à Moscou. Il espérait y trouver une oreille compatissante et une aide financière. Mais la Russie, elle aussi frappée par la crise économique, n’a ni la volonté, ni les moyens d’aider la Grèce autrement que par des mesures symboliques, telles que la levée de l’embargo sur les produits alimentaires grecs. Cette mesure, qui visait tous les pays de l’UE, avait été prise en réponse aux sanctions de l’UE contre la Russie, en lien avec la crise ukrainienne. Elle avait particulièrement affecté les exportations agricoles grecques. Mais sa levée, aussi importante soit-elle pour les entreprises agricoles grecques, ne sera pas suffisante pour relancer l’économie hellénique – et surtout renflouer ses finances publiques.
De fait, le gouvernement grec risque de se retrouver à court de liquidités. Or, les capitalistes européens conditionnent leur « aide » à plus de « clarté » dans les mesures d’austérité. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la Commission Européenne a fixé un ultimatum au 20 avril pour présenter une liste de réformes « acceptables », c’est-à-dire en fait l’abandon définitif par Syriza du programme de Thessalonique et la mise en œuvre de mesures d’austérité draconiennes telles que de nouvelles baisses des salaires et des retraites. Faute de quoi, la prochaine tranche « d’aide » à la Grèce ne sera pas versée. Cela montre que l’espoir de sortir de la crise par des « concessions mutuelles » était vain. Pendant ce temps, le peuple grec continue de souffrir cruellement des mesures drastiques imposées sous les précédents gouvernements.
Le gouvernement de Syriza n’a que deux options : soit il prolonge l’accord de février et accepte, non seulement de renoncer à toute mesure progressiste, mais aussi de mettre en œuvre de nouvelles mesures d’austérité ; soit il décide d’affronter la troïka et ses alliés en Grèce. Pour Syriza, la seule façon de réellement appliquer le programme pour lequel il a été élu, c’est de s’attaquer au capitalisme et d’aller chercher l’argent là où il est. Il lui faut immédiatement répudier la dette et nationaliser les propriétés de l’Eglise et des grands capitalistes (grecs et étrangers). Cela suppose de mobiliser la classe ouvrière grecque et de faire appel à la solidarité des travailleurs d’Europe. Car en Grèce comme ailleurs, pour rompre avec l’austérité, il faut renverser le capitalisme !