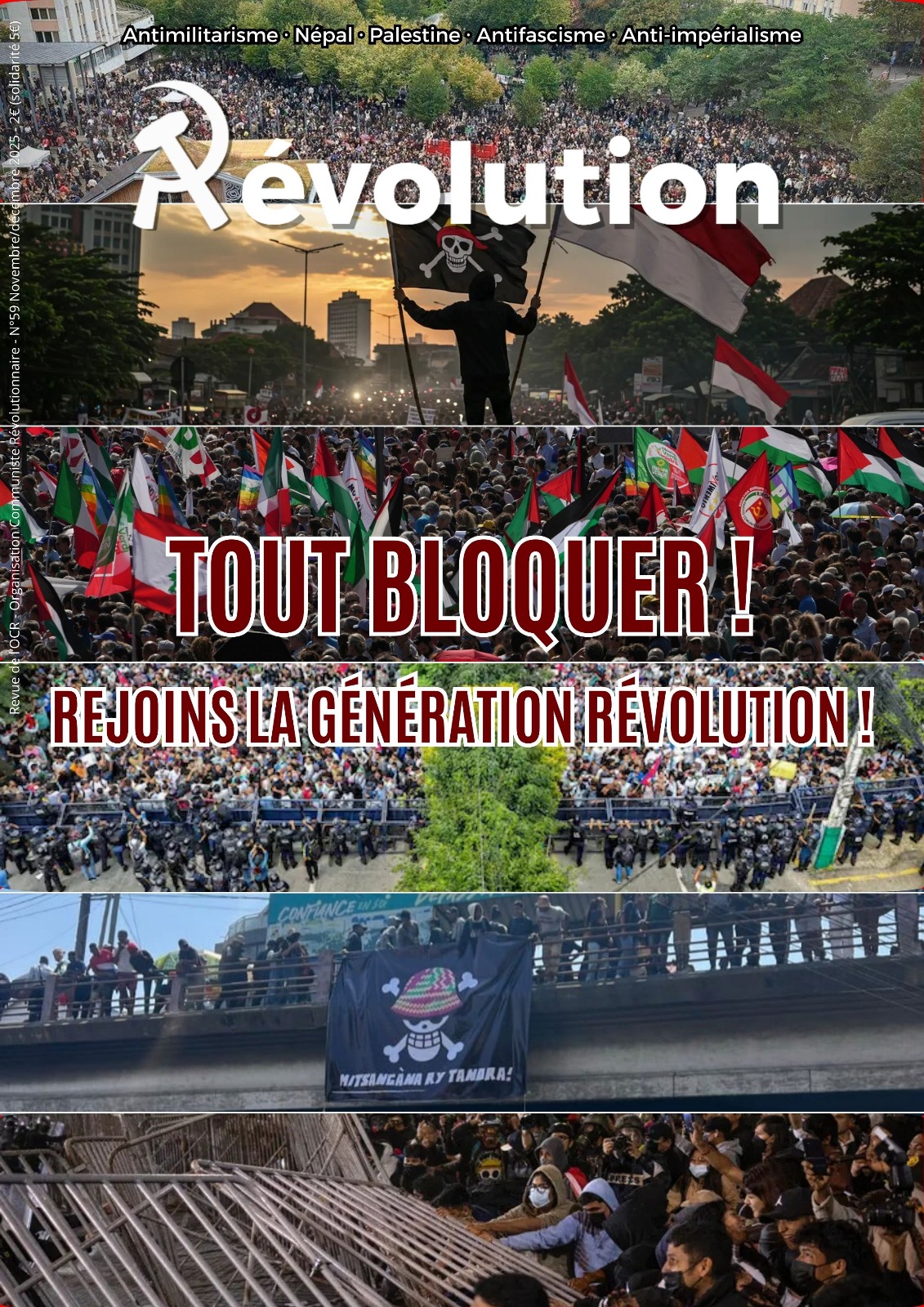Aujourd’hui, le choc économique et social de la crise renforce et rapproche cette perspective. Et parmi les pays candidats à une explosion de la lutte des classes, l’Italie figure en bonne position – aux côtés de la France et de la Grèce.
La crise de l’industrie italienne est d’une gravité sans précédent. Un seul chiffre suffit à illustrer le désastre : sur l’année 2008, quelque 900 000 emplois ont été supprimés, en particulier parmi les travailleurs précaires. Le chômage partiel a été imposé, pendant 10 à 15 semaines, à plusieurs millions de travailleurs, qui ont été sommés de survivre avec 600 à 700 euros par mois.
Le groupe automobile FIAT, qui compte pour 12% dans le PIB italien, a licencié 58 000 salariés. Deux de ses cinq unités de production, dans le pays, sont menacées de fermeture : à Pomigliano d’Arco, dans la province de Naples, et à Termini Imerese, en Sicile. Malgré les 3 milliards d’euros de profits réalisés par FIAT, en 2008, les patrons refusent de dépenser un seul euro dans la sécurisation des emplois et des salaires. Pire : tout en prenant des mesures de chômage partiel, la direction de FIAT impose des heures supplémentaires aux salariés qui – pour le moment – restent en poste.
Face à cette écoeurante rapacité patronale, les travailleurs de FIAT ne sont pas restés passifs. Le 27 février, une grève a éclaté à l’usine FIAT de Pomigliano. Des travailleurs de toute la région, et pas seulement de FIAT, ont participé à la grève et à la manifestation. Ce jour-là, pas une école, pas une usine et pas un magasin de Pomigliano n’a ouvert ses portes. C’était une authentique mobilisation de masse. Même l’Eglise locale était présente – nonnes, enfants de chœur, évêque. Du haut de la plate-forme syndicale, l’évêque a critiqué « ceux qui protègent leurs profits et veulent faire payer la crise aux travailleurs » !
Divisions syndicales
La mobilisation chez FIAT se développe sur fond de profondes divisions entre les grandes confédérations syndicales du pays. Trois syndicats – la CISL, l’UIL et l’UGL – ont signé avec l’organisation patronale (la Confidustria) un accord qui revient à briser le système de conventions collectives nationales. La CGIL , syndicat plus à gauche, a refusé de signer cet accord et appelé à une mobilisation nationale, le 4 avril, qui a été un grand succès.
Les dirigeants de la CISL, de l’UIL et de l’UGL ont également accepté le principe d’une loi limitant le droit de grève. Si cette loi est approuvée, cela créerait une situation semblable à ce que connaissent les travailleurs de Grande-Bretagne, où 90% des grèves sont, de facto, illégales.
Tout en s’opposant à ces mesures réactionnaires, la direction de la CGIL est elle-même divisée. D’un côté, son Secrétaire Général, Epifani, essaye désespérément – et sans succès – de trouver un accord avec le patronat. D’un autre côté, une aile dirigée par Rinaldini (Métallurgie) et Podda (Fonction publique) cherche à pousser la CGIL vers la gauche. Comme nous l’avions prévu de longue date, la polarisation de classe commence à trouver une expression dans les sommets du mouvement syndical. De fait, il n’y a plus de base matérielle pour une politique de « partenariat social » avec la classe capitaliste. Et la pression de la base se fait toujours plus forte.
Un espace pour la gauche
Le Parti Démocrate (PD), qui est issu d’une fusion de l’ex-Parti Social-Démocrate et de divers partis de droite, est désormais un parti bourgeois, dans son essence. Récemment, il a été secoué par deux défaites majeures, lors d’élections régionales, qui ont forcé son Secrétaire Général, Veltroni, à démissionner. Son successeur, Dario Franceschini, est issu du vieux Parti Chrétien-Démocrate (droite). Quant aux dirigeants issus de l’ancien Parti Social-Démocrate, ils n’ont même pas postulé à la tête du parti.
Le PD italien – que l’aile droite du PS, en France, prend pour modèle – ne se distingue en rien de la politique menée par le gouvernement ultra-réactionnaire de Berlusconi. Ses dirigeants refusent de soutenir les mobilisations organisées par la CGIL, depuis le mois d’octobre. Pire encore, ils cherchent à doubler Berlusconi sur sa droite en matière de « lutte contre l’immigration » – c’est-à-dire de politique raciste. Le PD bénéficie du soutien de nombreux banquiers et industriels. Ses responsables locaux sont empêtrés dans d’innombrables affaires de corruption.
Dans ce contexte, la gauche italienne apparaît très affaiblie. N’oublions pas qu’elle a été complètement éliminée du Parlement, en avril 2008, du fait de la dissolution des Sociaux-démocrates, d’une part, et d’autre part de la faillite de la ligne droitière de Bertinotti, à la tête de Refondation Communiste (PRC). Cependant, ce rapport de forces électoral ne doit pas nous aveugler sur la situation réelle et les grandes perspectives qui s’ouvrent, pour la gauche italienne. Depuis son Congrès de juillet 2008, le PRC a viré vers la gauche. Bertinotti et les siens ont perdu la direction du parti.
La situation sociale est explosive, en Italie. Dès lors, le PRC fait face à un défi majeur. Il doit plonger profondément ses racines dans le salariat, donner une voix et une organisation à la lutte des classes qui se développe, dans tout le pays, et redevenir un point de référence pour les travailleurs – à commencer par cette nouvelle couche de militants de la CGIL qui cherchent une alternative au système capitaliste. Au sein du PRC, les marxistes de Falce Martello militent pour une politique et un programme authentiquement communistes. De leur succès dépendra, dans une large mesure, la victoire de la prochaine révolution italienne !
Alessandro Giardiello (Coordinateur national du PRC dans les entreprises)