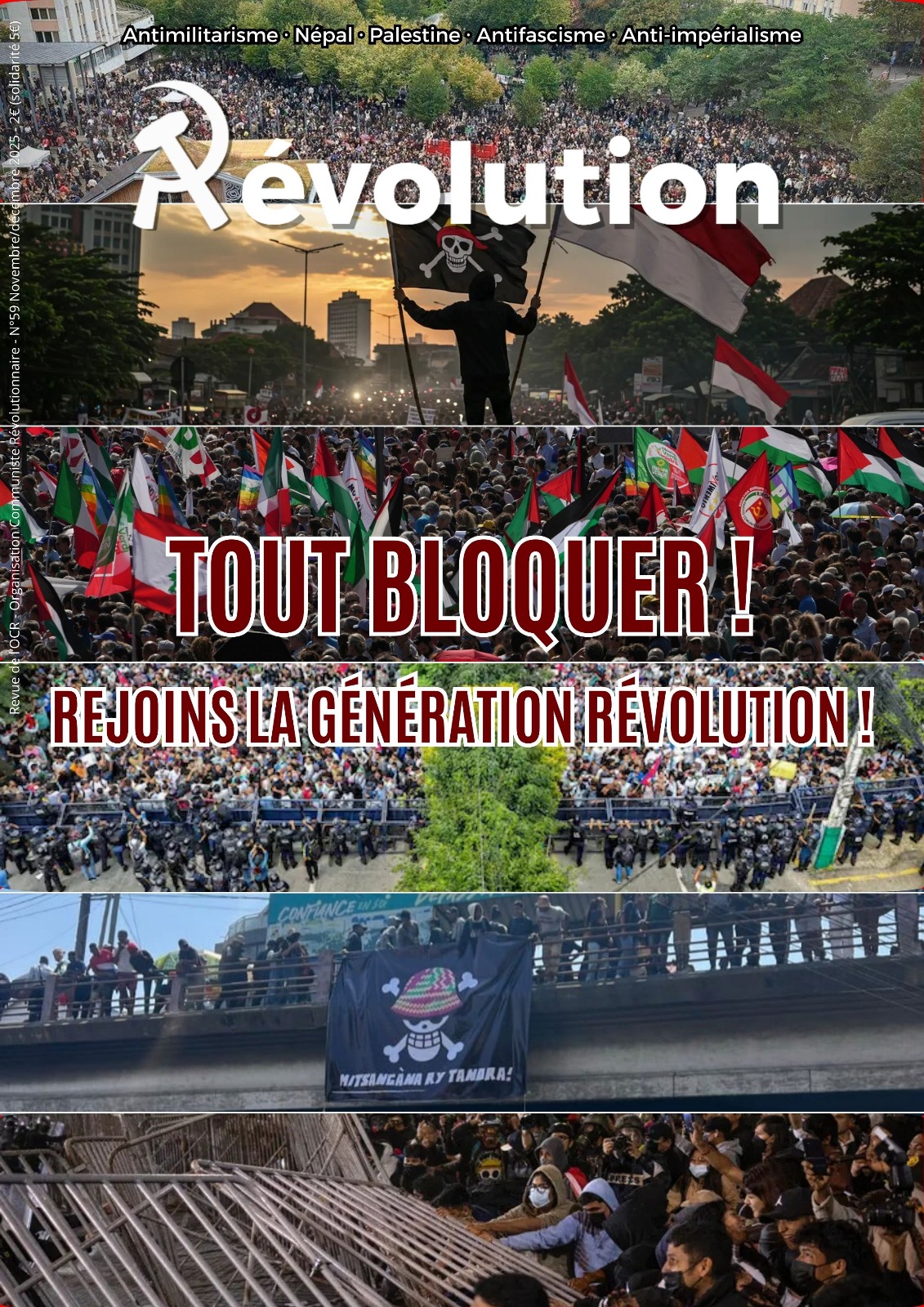La raison en est évidente : la classe dirigeante est toujours hantée par Mai 68. Elle craint mortellement que « ça recommence ». Les capitalistes les plus intelligents – ceux qui observent les agissements de Sarkozy avec angoisse – comprennent bien que les conditions d’une nouvelle explosion révolutionnaire de la jeunesse et des travailleurs ont mûri, au cours des dernières années. L’anniversaire de Mai 68 est pour eux l’occasion de « conjurer le sort », pour ainsi dire, en expliquant sur tous registres que « c’est du passé », qu’un tel mouvement n’est plus possible, que désormais le marxisme et le socialisme sont morts, les révolutions impossibles – et ainsi de suite. Bien sûr, il ne manque pas d’« ex-soixante-huitards » renégats pour « témoigner » du fait que, décidément, les temps ont bien changé. Daniel Cohn-Bendit, chef de file des renégats, publie un livre au titre évocateur : Oubliez 68. Mieux vaut oublier Cohn-Bendit.
A longueur d’articles, de livres et d’émissions, on nous explique que Mai 68 fut le douloureux accouchement d’un nouvel ordre moral ou « civilisationnel ». Autrement dit, tout cela n’avait rien à voir avec l’oppression capitaliste. Et comme le nouvel « ordre moral » est advenu, les causes de la crise sont supposées avoir disparu. L’accent est mis sur certaines revendications de la jeunesse étudiante. La grève générale n’est souvent mentionnée qu’en passant, comme la force d’appoint d’une « révolution culturelle » qui ne serait pas sortie du Quartier Latin. Apparemment, 10 millions de travailleurs ont fait grève et occupé leurs lieux de travail pour qu’enfin les garçons puissent aller rendre visite aux filles, dans les résidences universitaires !
En réalité, Mai 68 fut avant tout la plus grande grève générale de l’histoire. Ce fut une magnifique expression des traditions révolutionnaires de la classe ouvrière française. Tous ceux qui, aujourd’hui, luttent contre le capitalisme, y puiseront de précieuses leçons. Quelles en ont été les causes ? Quelle fut l’attitude des dirigeants des partis de gauche et des syndicats ? Pourquoi le capitalisme n’a-t-il pas été renversé ? Pourquoi les élections législatives de juin 1968 ont-elles donné une large majorité à la droite ?
Surprise ?
Mai 68 a éclaté vers la fin de la longue phase d’expansion capitaliste qui a suivi la seconde guerre mondiale (les « trente glorieuses »). L’économie française se développait alors au rythme moyen de 6% par an. Les capitalistes français accumulaient d’immenses profits et se félicitaient d’en avoir fini avec la lutte des classes et les révolutions. Ils ont été complètement pris de court par l’explosion révolutionnaire. « Quand la France s’ennuie », titrait un éditorialiste du Monde, le 15 mars 1968. Les dirigeants du PCF et de la gauche socialiste n’ont rien vu venir, eux non plus. C’était encore pire du côté des intellectuels et des organisations prétendument « marxistes » qui grouillaient aux marges des grands partis de gauche.
Le « théoricien marxiste » André Gorz, par exemple, écrivait à la veille de la grève générale : « Dans un avenir prévisible, il n’y aura pas de crise du capitalisme suffisamment grave pour pousser la masse des travailleurs dans des grèves générales et des insurrections armées en défense de leurs intérêts vitaux. » (Réforme et révolution, 1968). Gorz n’était pas le seul à considérer que la classe ouvrière n’était plus une force révolutionnaire (« dans un avenir prévisible »). Les dirigeants de la LCR, eux aussi, expliquaient que les travailleurs s’étaient « embourgeoisés », « américanisés », et que le salut viendrait des étudiants. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont continué à défendre cette théorie pendant la grève générale, en demandant aux travailleurs de bien vouloir se soumettre à la « direction révolutionnaire » des étudiants. Inutile de dire qu’ils ont été froidement accueillis par les grévistes.
En réalité, la longue phase d’expansion capitaliste des « trente glorieuses » avait considérablement renforcé le poids social de la classe ouvrière, dans le pays. Longtemps, la classe dirigeante française, traumatisée par la Commune de Paris, avait volontairement freiné le développement de l’industrie, et donc du salariat. Elle avait développé une économie largement basée sur le capital financier et les colonies. Elle avait artificiellement entretenu une paysannerie massive, comme contre-poids aux travailleurs des villes. Cependant, au lendemain de la seconde guerre, le développement rapide de l’industrie modifia le rapport de force à l’avantage de la classe ouvrière. L’exode rural s’accéléra. En 1936, la moitié de la population vivait encore de l’agriculture, contre seulement 15% en 1968 (et 5% aujourd’hui). Non seulement le salariat constituait la grande majorité de la population active, mais il était, plus que par le passé, concentré dans de vastes unités industrielles. Les usines Renault et Citroën, par exemple, employaient des milliers de travailleurs. Près de 30 000 ouvriers étaient concentrés dans la seule usine de Renault Billancourt.
Dans les années 50 et 60, le niveau de vie d’une couche de la classe ouvrière avait augmenté. Entre 1958 et 1968, le nombre de propriétaires de voitures avait doublé. Il y avait également deux fois plus de machines à laver, dans les foyers, et trois fois plus de réfrigérateurs. Plus d’un million de maisons secondaires avaient été achetées. Mais ce n’était là qu’une face de la pièce. La croissance industrielle reposait sur une exploitation sévère de la force de travail. Alors que la grève de juin 1936 avait arraché – temporairement – la semaine de 40 heures, le temps de travail moyen, en 1968, était de 45 heures. Un grand nombre de salariés travaillaient jusqu’à 48, voire 50 heures. La tyrannie patronale et les cadences infernales régnaient dans bien des entreprises. Sur les chaînes de production, les travailleurs immigrés étaient placés de façon à ne pas pouvoir communiquer avec leurs voisins. Des millions de travailleurs touchaient des salaires misérables. Six millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté. Trois millions de travailleurs logeaient dans de véritables bidonvilles, aux frontières de Paris. Entre 1960 et 1968, le chômage avait augmenté de 70%, portant le nombre officiel de chômeurs à 500 000 (700 000, selon les syndicats). Tous ces éléments contribuaient à créer une situation explosive.
Les années précédant Mai 68 avaient été marquées par toute une série de signes avant-coureurs. En 1963, une longue grève des mineurs avait secoué le gouvernement de Gaulle et abouti à une victoire partielle. En 1967 et début 1968, les débrayages se multipliaient. En juin 1967, des violents affrontements ont opposé la police et les travailleurs en grève de Peugeot. Deux ouvriers ont été tués. Quelques semaines plus tard, 14 000 travailleurs de Rhodiaceta, à Lyon, ont fait grève pendant 23 jours. En janvier 1968, à Caen, les ouvriers de Saviem se battaient contre la police sur les piquets de grève et dans les rues de la ville. Entre mars et mai 1968, pas moins de 80 actions syndicales ont été recensées à Renault Billancourt. Début mai 1968, les travailleurs de Sud Aviation, dont les patrons voulaient réduire les salaires, cessèrent le travail plusieurs fois par jour. On pourrait multiplier les exemples. De manière générale, une grande effervescence se développait, dans la classe ouvrière. Les dirigeants syndicaux, comme le patronat, ne pouvaient pas l’ignorer. Mais nul n’imaginait où cela conduirait.
La mobilisation étudiante
Les étudiants sont toujours un baromètre sensible des tensions qui s’accumulent dans la société. Sur fond de mobilisation contre la guerre du Vietnam, la contestation ne cessait de se développer, sur la faculté de Nanterre, depuis le début de l’année 68. L’activité et les « coups d’éclat » d’une poignée de militants qui, en d’autres circonstances, auraient rencontré l’indifférence de la masse des étudiants, sont parvenues à cristalliser la sympathie et le soutien de centaines, puis des milliers de leurs camarades.
Le 2 mai, la direction de la faculté de Nanterre décide de suspendre les cours. Mais le lendemain, le 3 mai, le mouvement se transporte à la Sorbonne, au cœur du Quartier Latin. Dans la cour de l’université, un meeting de solidarité avec les étudiants de Nanterre est organisé. A l’extérieur, des « militants » du groupe d’extrême droite Occident – auquel appartenait l’actuel secrétaire général de l’UMP, Patrick Devedjian – menacent de « donner une leçon » aux étudiants mobilisés. Dans l’après-midi, la police intervient, évacue la Sorbonne et, sous l’œil indigné d’une foule croissante d’étudiants et de passants, embarque 400 étudiants dans ses fourgons. L’ambiance est électrique, les forces de l’ordre sont conspuées, et les témoins de la scène ne tardent pas à passer à l’action. Vers 17 heures, les premiers affrontements éclatent. Les coups pleuvent, des barricades sont érigées. Le « calme » ne revient qu’aux alentours de 21 heures.
Le lendemain, toute la presse de droite condamne la violence… des étudiants. Elle est secondée par L’Humanité, qui écrit : « On voit clairement aujourd’hui à quoi aboutissent les agissements aventuriers des groupes gauchistes, anarchistes, trotskistes et autres qui, objectivement, font le jeu du gouvernement ». Les jeunes qui, d’heure en heure, sont toujours plus nombreux et audacieux, accueillent d’un haussement d’épaule ce type de sermon. La direction du PCF est à côté de la plaque. La mobilisation étudiante dépasse largement l’influence habituelle des groupes « gauchistes ».
Loin d’intimider le mouvement, les arrestations et l’occupation policière de la Sorbonne ne font que le radicaliser et lui apporter un soutien plus massif. Tout s’enchaîne alors très vite. Le 6 mai, une manifestation de 60 000 personnes réclame la libération des étudiants emprisonnés, la réouverture de la Sorbonne et le retrait des forces de l’ordre du Quartier Latin. En fin d’après midi, les manifestants affrontent la police. De nouveau, des barricades sont érigées, plus nombreuses que le 3 mai. Bilan : 600 blessés et 422 interpellations. Puis, après quatre jours marqués par des manifestations et une extension du mouvement aux universités de province, la violence policière atteint des niveaux extrêmes le 10 mai au soir – la « nuit des barricades ». Pas moins de 60 barricades sont érigées aux alentours de la Sorbonne. Toute la soirée et une bonne partie de la nuit, les CRS et la police municipale chargent sans la moindre retenue, inondent le quartier de gaz lacrymogènes, tapent sur tout ce qui bouge et n’hésitent pas à pénétrer de force chez les gens pour y traquer leurs proies. Lorsqu’ils arrêtent un jeune, il arrive qu’ils l’embarquent dans un fourgon, le rouent de coups, puis le jètent à l’entrée d’un hôpital. D’autres policiers pénètrent dans les hôpitaux et embarquent des blessés pour « finir le travail ».
Cette nuit de violence policière suscite une immense vague d’indignation, dans la population. Symptôme caractéristique d’un début d’une crise révolutionnaire, le gouvernement se divise en deux camps : les partisans de la « fermeté » (autour du général de Gaulle) et ceux qui suggèrent de faire des concessions (Pompidou). Face à l’indignation générale et sous la pression d’une classe ouvrière qui, elle aussi, veut en découdre avec le pouvoir, les dirigeants des grandes organisations syndicales – CGT, CFDT, FO et FEN (enseignants) – appellent à une grève générale de 24 heures pour le 13 mai. Les travailleurs entrent alors massivement dans l’arène.
La grève générale
La grève générale du 13 mai est un énorme succès. La manifestation parisienne est monumentale : 1 million d’étudiants et de travailleurs y participent. Les salariés de pratiquement tous les secteurs sont représentés : métallurgistes, postiers, routiers, cheminots, gaziers, électriciens, fonctionnaires, travailleurs des banques, des assurances, de la distribution, de la chimie, du bâtiment, etc. Tout au long du parcours, des employés des bureaux et magasins sortent pour se joindre aux manifestants. En référence à la nuit du 10 mai, les employés des hôpitaux brandissent des pancartes : « Où sont les disparus des hôpitaux » ? En ce jour anniversaire du pouvoir gaulliste, de nombreux manifestants clament : « Dix ans, ça suffit ! ».
A aucun moment les dirigeants syndicaux ne songent à poursuivre la grève générale au-delà de 24 heures. Pour eux, l’objectif du 13 mai est d’ouvrir les vannes du mécontentement et, ainsi, de faire retomber la pression. Ils savent que, face aux mobilisations ouvrières, le gouvernement va faire des concessions aux étudiants. Tout devrait donc rentrer dans l’ordre, le 14 mai : les travailleurs reprendront le travail, les étudiants retrouveront leurs universités – et la routine reprendra ses droits. D’ailleurs, de Gaulle croit lui aussi pouvoir quitter la France, le 14 mai, pour un voyage diplomatique en Roumanie, comme si rien de sérieux ne se passait dans le pays.
Cependant, dans les entreprises et la base syndicale, le mot circule : « il faut poursuivre ». Au vu du succès de la mobilisation, chacun sent bien qu’il est possible d’aller plus loin. Les travailleurs ont pu mesurer et ressentir leur force, leur nombre, leur détermination. Une fois lancé, le mouvement acquiert une vie propre, indépendante, qui échappe aux directions syndicales. Celles-ci ne peuvent pas toujours mobiliser et démobiliser la classe ouvrière comme un robinet qu’on ouvre et qu’on ferme. Malgré l’énorme autorité dont elles jouissent, en 1968, les directions syndicales vont être rapidement et complètement débordées.
Le 14 mai, les travailleurs de Sud-Aviation se mettent en grève et occupent leur usine. Ils sont très vite suivis par les salariés de Renault à Flins, Le Mans et Boulogne, puis par les cheminots, les gaziers, les électriciens et les mineurs. En l’espace de quelques jours, la grève se répand comme une traînée de poudre, gagnant un secteur après l’autre. Le 18 mai, il y a 6 millions de grévistes ; le 21 mai, ils sont 10 millions. Le pays est complètement paralysé. Le gouvernement est suspendu en l’air.
Les étudiants occupent les universités, transformées en d’immenses forums de discussion où l’on débat jour et nuit des maux du capitalisme et du système qui doit le remplacer. Les lycéens occupent les lycées. Le théâtre de l’Odéon est également occupé. Face à la puissance de la mobilisation ouvrière, toutes les couches intermédiaires de la société sont contaminées par la fièvre révolutionnaire. Les paysans, les scientifiques, les artistes, les architectes, les sportifs, les médecins, les journalistes, les avocats, etc. : tous prennent part au mouvement, remettent en cause la routine de leur métier et son asservissement au système capitaliste. Les paysans organisent le ravitaillement, de concert avec les grévistes. Les docteurs occupent les bâtiments de l’Association Médicale. Les écrivains occupent la Société des Gens de Lettres, à l’hôtel de Massa. Les astronomes occupent les observatoires. Une grève éclate parmi les 10 000 ingénieurs, techniciens et chercheurs du centre de recherche nucléaire Saclay. Les danseuses des Folies Bergères se mobilisent et demandent davantage de considération. Même l’Eglise est affectée. Dans le Quartier Latin, de jeunes catholiques occupent une église et exigent que la messe soit remplacée par un débat. Bien sûr, une partie de la petite-bourgeoisie reste à l’écart du mouvement ou lui est foncièrement hostile. Mais une large section des classes moyennes est affectée. C’est une expression limpide de l’extrême profondeur de la crise.
Le 24 mai, de Gaulle tente de désamorcer la crise en annonçant qu’il organisera un référendum – en fait, un plébiscite : pour ou contre de Gaulle ? La réponse lui vient immédiatement de manifestants réunis pour écouter, à la radio, l’allocution présidentielle : « Adieu de Gaulle ! ». De toute façon, les travailleurs des imprimeries refusent d’imprimer les bulletins de vote. Sollicités par le gouvernement français, leurs camarades belges refusent de jouer les briseurs de grève. Ce ne sera pas la seule manifestation de solidarité internationale. Les cheminots allemands arrêtent les trains à la frontière. Des travailleurs britanniques travaillant dans des entreprises françaises organisent des actions de solidarité. En Italie et au Pays-Bas, les dockers refusent de décharger les bateaux en provenance de France.
Révolution ou « vaste mouvement revendicatif » ?
« La situation n’est pas révolutionnaire » : tel est, du début à la fin de Mai 68, le credo des dirigeants du PCF et de la CGT, qui à l’époque exercent une énorme influence sur les secteurs décisifs de la classe ouvrière française. Le PCF compte plus de 400 000 adhérents et une très large couche de sympathisants. La CGT, qui est contrôlée par le PCF, organise 2,5 millions de travailleurs. Dans le contexte d’une grève générale indéfinie, la puissance potentielle de ces deux organisations est décuplée. C’est vers elles que tous les regards se portent – y compris, bien sûr, ceux de la bourgeoisie. Que vont faire leurs dirigeants ? S’ils décident de prendre le pouvoir, ils n’ont qu’à le ramasser. Le gouvernement ne contrôle plus rien. L’Assemblée Nationale s’épuise en bavardages impuissants. Le véritable pouvoir est dans les entreprises et dans la rue.
Au début de la grève, de Gaulle rassure l’amiral Flohic : les communistes veilleront sur « l’ordre ». Plus tard, de Gaulle doutera de son propre diagnostic. Il dira à l’ambassadeur des Etats-Unis : « C’est fichu. Dans quelques jours, les communistes seront au pouvoir. » Mais non, les dirigeants communistes insistent : « la situation n’est pas révolutionnaire ». Il s’agit, selon eux, d’un « vaste mouvement revendicatif » qui doit déboucher sur des négociations avec le gouvernement et le patronat. Seuls de dangereux « aventuriers gauchistes » peuvent avancer la perspective d’une conquête du pouvoir.
Les militants du PCF et de la CGT constituent la colonne vertébrale de Mai 68. Mais leurs dirigeants freinent des quatre fers. Comment l’expliquer ? A l’époque, la direction du PCF n’a pas encore officiellement abandonné l’objectif du socialisme. Mais dans les faits, elle mène déjà une politique purement réformiste. Elle prétend que l’objectif immédiat, en France, n’est pas le socialisme, mais la réalisation d’une « authentique démocratie » (capitaliste). Le socialisme fait figure de « deuxième étape », qui est ainsi renvoyée aux calendes grecques. Toutes les « forces anti-monopolistiques » doivent d’abord lutter contre les tendances dictatoriales du régime gaulliste, dans le seul cadre de la « légalité républicaine », avant de songer à la transformation socialiste de la société. Tel est, en résumé, le charabia « démocratique » que les dirigeants communistes servent à la classe ouvrière.
L’un des principaux éléments de l’équation est l’attitude de la bureaucratie soviétique, à laquelle les dirigeants du PCF sont étroitement liés. La bureaucratie de Moscou ne veut pas d’un régime socialiste en France, car elle craint mortellement l’impact d’une telle révolution sur la classe ouvrière de Russie et des autres pays du bloc de l’Est. Le renversement du capitalisme, en France, ne déboucherait pas sur un régime de type stalinien : les travailleurs français n’accepteraient pas d’étouffer sous une chape de plomb bureaucratique. L’exemple d’une authentique démocratie ouvrière, en France, aurait un impact immédiat sur les classes ouvrières du bloc soviétique – sans parler des travailleurs du reste de l’Europe. Cela signerait l’arrêt de mort des bureaucraties « socialistes », déjà en butte à la révolte de la jeunesse et des travailleurs, notamment à Prague. La Pravda n’évoquera pas la grève générale des travailleurs français avant le 5 juin, lorsque les salariés commencent à reprendre le travail.
En Mai 68, non seulement la situation est révolutionnaire, mais il serait difficile d’imaginer un contexte plus favorable au renversement du capitalisme. Qu’est-ce qu’une révolution ? C’est une situation dans laquelle les masses – d’habitude passives – font irruption dans l’arène politique, prennent conscience de leur propre force et se mobilisent pour tenter de transformer la société. C’est exactement ce qui se passe, en mai 68, à une échelle colossale.
Une grève générale comme celle de Mai 68 ne peut pas être réduite à un « mouvement revendicatif », même « vaste ». Elle diffère d’une grève normale en ceci qu’elle pose la question du pouvoir. La question qui est posée n’est pas telle ou telle augmentation de salaire, mais : qui contrôle la société ? Bien sûr, le mouvement commence par toute une série des « revendications immédiates ». Mais au cours d’une lutte de cette nature, la conscience des travailleurs évolue à une vitesse vertigineuse. Ils comprennent qu’ils ont affaire à quelque chose de beaucoup plus grand qu’une grève pour de meilleures conditions de travail ou de meilleurs salaires. Ils prennent conscience de leur propre pouvoir et – fait décisif – constatent l’impuissance de ceux qui représentent l’Etat, qui perd alors son caractère « sacré », tout-puissant et intimidant.
En Mai 68, une situation de « double pouvoir » se développe. Il y a, face à l’Etat capitaliste, un Etat embryonnaire des travailleurs, sous la forme des comités de grève. C’est dans la région de Nantes que les choses sont allées le plus loin. Un comité de grève central coordonne, à l’échelon local, l’activité des comités d’entreprise. Par ce levier, les travailleurs organisent le ravitaillement en essence et en nourriture. Ils délivrent les autorisations de vendre des marchandises. « Ce magasin a le droit d’ouvrir. Les prix sont sous le contrôle permanent des syndicats », peut-on lire sur les devantures. L’autorisation est signée : CGT, CFDT, FO. Le prix du litre de lait passe de 80 à 50 centimes, le kilo de pommes de terre est ramené de 70 à 12 centimes – et ainsi de suite. Le comité de grève organise la vie économique et sociale. Les syndicalistes célèbrent même les mariages !
La grève générale pose la question du pouvoir – mais, en elle-même, elle ne peut pas y répondre. Pour trancher cette question, il faut que la direction du mouvement prenne des mesures décisives pour balayer l’Etat capitaliste agonisant et constituer un nouvel Etat reposant sur les organes de démocratie ouvrière qui ont émergé au cours de la lutte : les comités de grève. Il aurait fallu relier ces comités aux plans local et national en élisant, dans toutes les entreprises, des délégués réunis dans un Comité National qui aurait pris le pouvoir en main et rejeté le vieil appareil d’Etat dans la poubelle de l’histoire. Si le PCF et la CGT avaient mobilisé toute leur force colossale pour orienter la grève dans cette direction, les travailleurs auraient répondu avec enthousiasme. Mais pour les dirigeants du PCF et de la CGT – comme pour ceux de la CFDT et de la gauche non-communiste – il n’en était pas question. Aussi, lorsque le gouvernement et le patronat proposent d’organiser des négociations, les dirigeants de la CGT (George Séguy, Benoît Frachon et Henri Krasucki), de la CFDT (Eugènes Descamp) et de FO (André Bergeron) s’y précipitent, le 25 mai.
L’échec des accords de Grenelle
Face au risque de tout perdre – à savoir son contrôle de l’économie et de l’Etat – la classe dirigeante est disposée à faire d’énormes concessions. Elle est prête à céder sur bien des revendications, du moment qu’on ne la pousse pas dans le précipice ouvert par la grève générale. Son calcul est simple : reculer dans l’immédiat, mais conserver le pouvoir et reprendre ce qui a été donné une fois l’orage passé. C’est exactement ce qui se produira.
Le 27 mai, les dirigeants syndicaux ressortent des négociations avec, en main, un « protocole d’accord » comprenant de larges augmentations de salaire pour tous les travailleurs, la légalisation de la section syndicale d’entreprise, une augmentation des petites retraites, une réduction du ticket modérateur et des engagements sur une réduction du temps de travail. Dans la fournaise de la grève générale, les dirigeants syndicaux ont obtenu en 36 heures bien plus que ce qu’ils réclamaient, en vain, depuis des années.
Pourtant, lorsque George Séguy, secrétaire général de la CGT, présente les termes de l’accord devant des milliers de travailleurs de Renault Billancourt, ceux-ci commencent à le huer, puis se mettent à crier : « Gouvernement populaire ! ». Le même scénario se déroule dans le reste du pays. En des circonstances « normales », les grévistes auraient accueilli les accords de Grenelle comme une grande victoire. Mais la situation, en Mai 68, n’est pas « normale » : elle est révolutionnaire. La classe ouvrière rejette l’accord. Toutes ces concessions, c’est beaucoup, oui – mais c’est infiniment moins que ce à quoi aspire alors la masse des travailleurs. Ils ne veulent pas seulement des augmentations de salaires, même importantes, mais la fin du gouvernement de Gaulle et de l’esclavage capitaliste. La légalisation de la section syndicale ? Mais les travailleurs occupent les entreprises ! Ils y font la loi, et c’est les patrons qui y sont désormais illégaux.
La débâcle des accords de Grenelle est une réédition, à un niveau supérieur, de ce qui s’était produit lors des accords de Matignon, pendant la grève générale de juin 1936. A l’époque, les accords de Matignon n’avaient pas immédiatement arrêté la grève, et des entreprises avaient même rejoint le mouvement gréviste après la signature. Le dirigeant du PCF Maurice Thorez avait alors tapé du poing sur la table et lancé sa célèbre formule : « il faut savoir terminer une grève ». Au lendemain du 27 mai 1968, les dirigeants du PCF et de la CGT ne peuvent pas en appeler à la reprise du travail. Ils sont obligés de « prendre acte » du refus de la base, et se cachent derrière le fait qu’ils n’ont rien signé, formellement, car il s’agissait seulement d’un « protocole d’accord » soumis au vote des salariés. Par la suite, Seguy expliquera que ce sont les propositions du patronat – et non son discours – qui ont été huées, à Billancourt. Mais en réalité, même si les travailleurs n’en étaient pas forcément conscients, ils huaient à la fois les directions syndicales et le patronat, qui formaient un seul et même bloc opposé à la conquête du pouvoir par la classe ouvrière.
Le fiasco des accords de Grenelle envoie une onde de choc dans tout le pays. Le 27 mai au soir, la gauche non-communiste – PSU, Unef, CFDT, etc. – organise un meeting de 30 000 personnes au stade Charlety. A la tribune, André Barjonet, qui vient de rompre avec la CGT, lance : « Tout est possible ! » Oui, mais comment ? La réponse ne viendra jamais. Les dirigeants de la CFDT, du PSU et de la SFIO ne présentent aucune perspective sérieuse. Dans le même temps, une pression monumentale s’exerce sur les dirigeants du PCF et de la CGT, qui, le 29 mai, organisent une manifestation de plus de 500 000 travailleurs sous le mot d’ordre de « gouvernement populaire ». Encore une fois, leur objectif est de lâcher un peu de pression et de canaliser un mouvement qui leur échappe de plus en plus. Le mot d’ordre de « gouvernement populaire » est interprété différemment par la base et les dirigeants. Ces derniers ne lui donnent aucun contenu concret et ne prennent aucune mesure pour qu’un gouvernement ouvrier se saisisse effectivement du pouvoir. Ils s’accrochent désespérément à la « légalité républicaine », selon leur formule. Aussi, lorsque le général de Gaulle prend la parole, le 30 mai, pour annoncer la dissolution de l’Assemblée Nationale et la tenue d’élections législatives pour la fin du mois de juin, les dirigeants communistes se déclarent satisfaits. Le « gouvernement populaire » devra passer par les urnes. A partir de ce moment là, les dirigeants syndicaux appellent à négocier les « meilleurs accords possibles », dans les entreprises, puis à reprendre le travail.
Une intervention militaire ?
L’un des principaux arguments de la direction du PCF était le suivant : « si nous tentons de prendre le pouvoir, de Gaulle mobilisera l’armée. Cela finira dans un bain de sang et une dictature fasciste. » Qu’en était-il vraiment ?
De fait, dès le début de la grève générale, de Gaulle a étudié la possibilité d’une intervention militaire. Des plans ont été élaborés pour arrêter 20 000 militants de gauche et les enfermer dans le Vélodrome d’hiver, où ils auraient connu le même sort que les militants chiliens, cinq ans plus tard, après le coup d’Etat de Pinochet. Cependant, ce plan n’a jamais été exécuté, car le gouvernement craignait la réaction des masses. Loin de mettre un terme à la grève générale, ce plan risquait de pousser le mouvement sur une voie ouvertement insurrectionnelle.
Sur le papier, de Gaulle disposait d’une puissante machine militaire : 144 000 policiers – dont 13 500 CRS – et 261 000 soldats. Si on approche la question d’un point de vue strictement quantitatif, il faudrait non seulement exclure la possibilité d’une transformation pacifique de la société, mais également la possibilité d’une révolution en général – dans la France de Mai 68 comme ailleurs. De ce point de vue, aucune révolution n’aurait jamais pu être victorieuse, au cours de l’histoire. Mais en fait, on ne doit pas poser la question ainsi.
Dans toutes les révolutions, des voix s’élèvent pour tenter d’effrayer la classe opprimée avec le spectre de la violence. C’était exactement l’attitude de Kamenev et Zinoviev, à la veille d’Octobre 1917. Mais au premier choc, les forces « considérables » à la disposition des ennemis des bolcheviks se sont littéralement évanouies. Il est clair qu’il en aurait été de même, en Mai 68.
Complètement démoralisé, de Gaulle a quitté Paris, le 29 mai, pour Baden-Baden, où il s’est entretenu avec le général Massu, commandant des troupes françaises en Allemagne. Il n’est pas difficile d’imaginer ce que de Gaulle a demandé à Massu : « Peut-on se fier à l’armée ? ». On ne trouve la réponse dans aucune source officielle, pour des raisons évidentes. Cependant, le journal britannique The Times a envoyé un correspondant à Baden-Baden. Le journaliste demanda à un soldat s’il tirerait sur des grévistes. Réponse : « Jamais ! Je trouve leurs méthodes un peu rudes, mais je suis moi-même un fils de travailleur. » Dans son éditorial, The Times posait la question clé : « de Gaulle peut-il utiliser l’armée ? », et y répondait en disant que de Gaulle pourrait l’utiliser – une seule et dernière fois. En d’autres termes, un seul affrontement sanglant aurait suffit à briser l’armée. Tel était le point de vue de la plupart des plus fidèles stratèges du capitalisme, à l’époque. Sur ce point, nous n’avons aucune raison de mettre en doute leur opinion.
La situation au sein de l’armée, en Mai 68, a été soigneusement cachée. Mais différentes anecdotes en disent long sur le moral des soldats et le degré de contamination révolutionnaire de l’armée. Par exemple, le 14 juin, le journal Action – qui fut immédiatement saisi par les autorités – publia un dossier sur une mutinerie qui avait éclaté, en mai, sur le porte-avions Clemenceau. Plusieurs marins avaient été déclarés « perdus en mer ».
Un tract publié par les soldats du RIMECA (infanterie), à Mutzig, près de Strasbourg, déclarait : « Comme tous les conscrits, nous sommes confinés dans les casernes. On se prépare à nous faire intervenir comme force répressive. Les jeunes et les travailleurs doivent savoir que les soldats du contingent NE TIRERONT JAMAIS SUR LES TRAVAILLEURS. Nous sommes absolument opposés à l’encerclement militaire des usines. […] Nous devons fraterniser. Soldats du contingent, formez vos comités ! » (Cité dans Revolutionary Rehearsals, de Colin Barker)
Même la police – qui est toujours plus réactionnaire que l’armée – était dans un état de grande agitation. Les responsables de la police ont prévenu le gouvernement de la possibilité qu’une grève y éclate. De fait, à une certain stade, nombre de policiers refusèrent de faire leur « travail ». Vers la fin du mois de mai, la police semblait avoir déserté les rues. Même les services de renseignement refusèrent de donner des informations au gouvernement !
Ce n’est pas l’armée qui a sauvé le capitalisme français, en Mai 68 : ce sont les dirigeants de la gauche et des syndicats. Les marxistes ne sont pas les seuls à parvenir à cette conclusion. Tous les historiens bourgeois un tant soit peu sérieux le reconnaissent.
Le reflux
Le soir du 30 mai, juste après l’annonce de la dissolution de l’Assemblée Nationale, des centaines de milliers de manifestants hostiles à la grève manifestent, à Paris, de la Concorde à l’Etoile. D’autres manifestations de ce type ont lieu dans le pays. Organisées de longue date par les Comités pour la Défense de la République, à l’initiative de l’extrême droite, ces manifestations rassemblent tout ce que le pays compte de réactionnaire et de décadent. Les petit-bourgeois hystériques y côtoient les notables ulcérés, les bourgeois bedonnants (venus en famille), les retraités effarouchés, les jeunes croisés de l’anticommunisme, les nostalgiques de l’Algérie française, etc. D’un point de vue arithmétique, ces cortèges sinistres semblent imposants. Mais le poids social de ces éléments est dérisoire. C’est la poussière de la société française.
Cependant, dans les jours qui suivent, un reflux de la grève générale s’amorce. La classe ouvrière ne peut pas être maintenue indéfiniment dans un état d’extrême tension révolutionnaire. Au début du mouvement, les travailleurs sont remplis d’enthousiasme. Ils sont prêts à se battre et faire des sacrifices. Mais lorsqu’une grève se prolonge sans conclusion en vue, l’humeur finit nécessairement par changer, à un certain stade. Les éléments les moins combatifs, d’abord, sont gagnés par la lassitude. Les doutes et la fatigue s’installent. Alors, la reprise du travail s’amorce.
En l’absence de toute autre perspective, beaucoup de travailleurs acceptent ce que les dirigeants syndicaux présentent comme une grande victoire : les « accords » de Grenelle et la dissolution de l’Assemblée nationale. Nombreux, cependant, sont ceux qui reprennent le travail la rage au ventre, avec le sentiment qu’un immense espoir vient de leur glisser des mains. C’est ce que montre très bien le film Reprise, sur la fin de la grève à l’usine de piles Wonder, à Saint-Ouen. On y voit notamment des cadres de la CGT pousser les salariés à la reprise au travail.
Engagée début juin, la reprise s’étend sur tout le mois. Les travailleurs poursuivent parfois la grève jusqu’à la signature d’un accord supérieur au « protocole de Grenelle ». Les travailleurs de Renault tiendront jusqu’au 14 juin, suivis, quelques jours plus tard, par ceux de Citroën. Les ouvriers de Peugeot ne reprendront pas le travail avant le 24 juin. Mi-juin, on compte encore plus de 4 millions de grévistes. Face à cette résistance, l’Etat déchaîne une répression brutale. De véritables batailles rangées se déroulent aux portes de plusieurs usines. Dans certains cas, l’intervention des CRS provoque de nouvelles grèves et manifestations. La répression, dans son ensemble, fait quatre morts et de très nombreux blessés. Plus d’une centaine de journalistes de l’ORTF sont licenciés. Des centaines d’étudiants et de travailleurs étrangers sont expulsés du territoire français. Dans les entreprises, le patronat prend sa revanche en ciblant les militants. Dans les seules usines de Citroën, 925 travailleurs sont licenciés.
Les élections législatives des 23 et 30 juin donnent une large majorité aux partis de droite. La gauche socialiste perd 61 sièges et le PCF 39. Dans Les enseignements de mai-juin 1968, une brochure publiée au lendemain des élections, le secrétaire général du PCF, Waldeck Rochet, explique que les principaux responsables de la défaite de la gauche sont – comme toujours ! – les « aventuriers gauchistes » et leurs maudites barricades. Waldeck Rochet célèbre ad nauseum la « ligne juste du PCF » et lance aux communistes qui oseraient en douter un avertissement limpide : « nul n’est obligé de rester au parti. » Des milliers de militants critiques en seront exclus.
En réalité, le résultat des élections législatives était une conséquence de la fatigue, des doutes et de la désorientation consécutifs au reflux de la grève générale. Après être allé très loin vers la gauche, le balancier repartait à droite, temporairement. Un élément décisif de l’équation fut la campagne électorale menée par la direction du PCF sous la bannière de « l’ordre » et de « la loi ». Dans ce domaine, de nombreux travailleurs ont préféré l’original – « l’ordre » gaulliste – à la copie communiste.
Dans sa brochure, Waldeck Rochet célèbre la « grande victoire » de Mai 68, en référence aux différents « acquis » concédés par la classe dirigeante : augmentations de salaires, etc. Cependant, il ne faudrait pas oublier que la plupart des « acquis » de Mai 68 ont été rapidement liquidés – exactement comme ceux de juin 36 –, notamment par le mécanisme de l’inflation, qui a été volontairement stimulée par la classe dirigeante et qui a rongé les augmentations de salaires et les retraites. Cinq ans plus tard, la récession mondiale frappait de plein fouet l’économie française. Le chômage de masse se développait de façon vertigineuse, et pour longtemps. L’idée que les conquêtes de Mai 68 ont été définitivement acquises relève de la mythologie réformiste. Surtout, ces conquêtes doivent être mises en regard de la possibilité – qui a été gâchée – d’en finir définitivement avec le capitalisme français, ce qui aurait complètement bouleversé le cours de l’histoire mondiale.
L’histoire n’est cependant pas terminée. Les magnifiques traditions de Mai 68 sont toujours vivantes, dans l’esprit des travailleurs français et du monde entier. Tôt ou tard, il y aura d’autres Mai 68. Quel pays est le candidat le plus probable ? Ce pourrait bien être la France, mais aussi l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce et d’autres pays encore – y compris en dehors de l’Europe. Les mêmes causes produiront les mêmes effets, à une échelle encore plus vaste. Le capitalisme mondial travers une crise profonde. Partout, il constitue un obstacle absolu au progrès social. De plus en plus de gens parviennent à la conclusion que ce système malade et dégénéré doit être balayé pour laisser place à une organisation rationnelle et harmonieuse des rapports économiques et sociaux. Aujourd’hui comme hier, le socialisme est la seule alternative. En ce glorieux anniversaire de Mai 68, nous devons en saisir le flambeau et nous engager à ne pas le lâcher avant d’avoir terminé la tâche entreprise par nos aînés.
Jérôme Métellus (Paris)
Pour voir le reportage:http://www.lariposte.com/La-revolution-de-Mai-68-1021.html