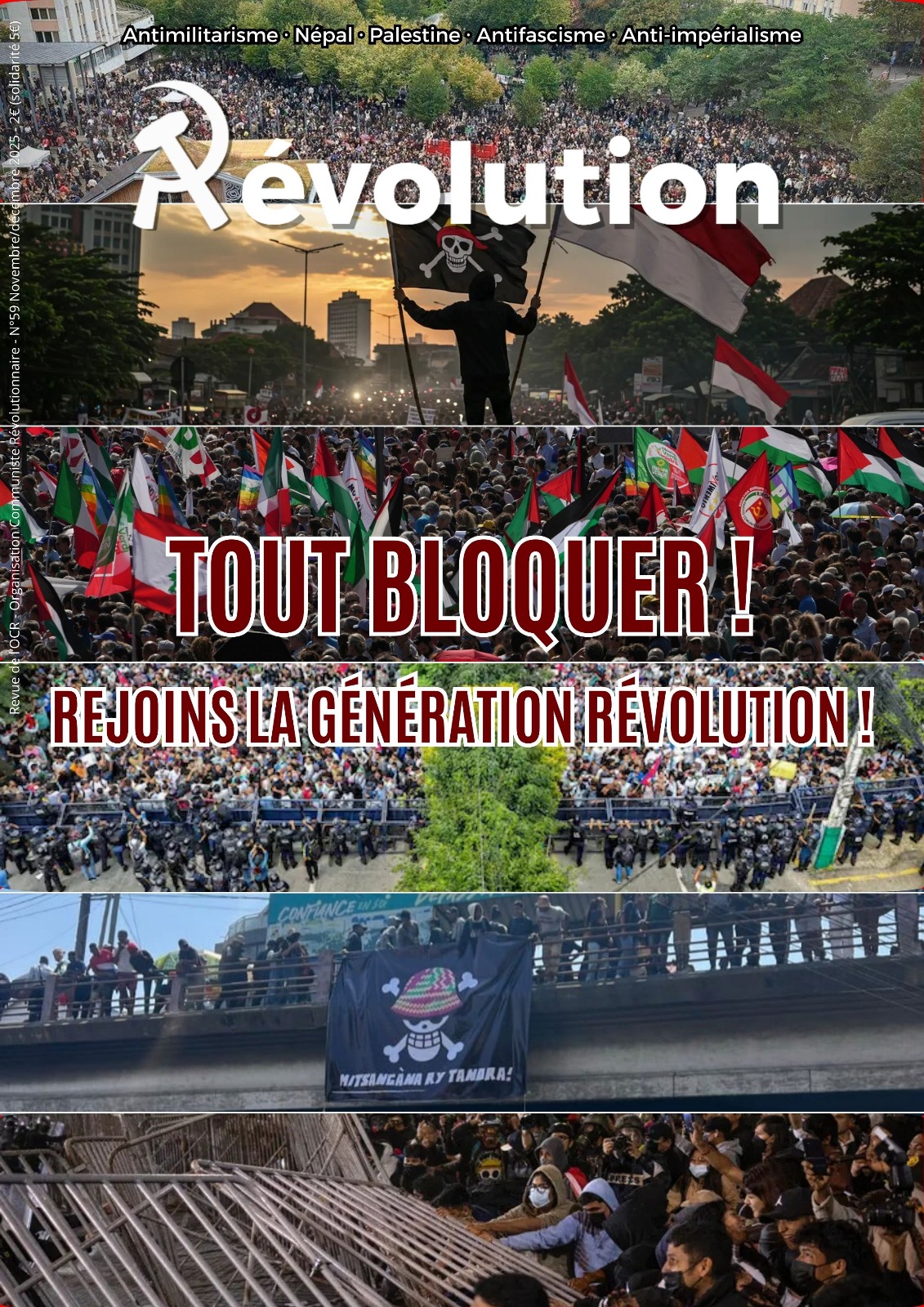Mais à présent que le mouvement a grandi et gagné de nombreuses villes, la condescendance a laissé place à la peur et la haine. Les manifestants sont dépeints comme une bande de marginaux dénués de toute conscience politique : des « clowns », des « fainéants » et des « parasites » à la recherche de sensations fortes. Ces insultes ne peuvent qu’alimenter la légitime colère des centaines de milliers de jeunes et des travailleurs qui se sont mobilisés contre un système injuste et pourrissant.
D’autres commentateurs bourgeois font preuve d’un peu plus de subtilité. Ils disent « comprendre » le mouvement, mais ne se lassent pas d’en souligner l’hétérogénéité politique. Quel est son programme ? Quelles sont ses idées ? Et d’en conclure que tout ceci est bien sympathique, mais soyons sérieux : il faut laisser aux professionnels de la politique le soin de régler les problèmes. C’est notamment le discours de nombreux dirigeants démocrates, qui pensent aux élections de 2012.
Il est vrai que toutes sortes d’idées circulent sur les places occupées des grandes villes américaines. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Il n’y a pas d’organisation de masse, aux Etats-Unis, qui propose un programme et des idées claires pour combattre le capitalisme. Les Démocrates mènent la politique de rigueur que les indignés contestent. Les dirigeants syndicaux soutiennent les démocrates. D’où les manifestants pourraient-ils tirer un programme révolutionnaire cohérent ? Soit dit en passant, cette remarque s’applique également aux indignés grecs et espagnols, qui se méfient à juste titre des dirigeants réformistes.
A ce stade, le mouvement est nécessairement hétérogène. Mais il n’en est pas moins potentiellement explosif. Au fond, le slogan « nous sommes les 99 % » exprime la conscience du fait que la richesse et le pouvoir sont concentrés en un tout petit nombre de mains, c’est-à-dire celles des 1 % restant. Et la conclusion logique de ce slogan, c’est que les 99 % doivent prendre le contrôle de ce pouvoir et de ces richesses.
La fin du rêve américain
Pendant des décennies, les Etats-Unis ont semblé immunisés contre une intensification de la lutte des classes. Cette situation avait une solide base économique. La Deuxième Guerre mondiale n’avait pratiquement pas entamé les ressources économiques de ce gigantesque pays. Au contraire, elle avait ouvert au capitalisme américain d’immenses marchés, dont la « reconstruction » de l’Europe et du Japon. Il a émergé de la guerre dans la position de premier créditeur au monde. Ses coffres abritaient 60 % des réserves d’or de la planète. L’impérialisme américain ne cessait d’accroître sa « sphère d’influence ». Il tirait d’énormes profits de l’exploitation brutale des ressources et des peuples des quatre coins du globe. Par la suite, l’effondrement de l’URSS, la restauration du capitalisme en Chine et l’ouverture de l’économie indienne lui ont ouverts de vastes marchés.
Tels étaient les fondements matériels du « rêve américain ». Et ce n’était pas qu’un rêve. Le niveau de vie de la grande majorité des travailleurs s’améliorait d’une génération sur l’autre. Malgré la croissance des inégalités (les plus riches s’enrichissant plus vite), il y avait une progression absolue du niveau de vie des masses. Bien sûr, tout n’était pas rose. Le racisme, l’exploitation et la grande misère sévissaient, fléaux naturels du capitalisme. Mais il y avait un sentiment général que la société avançait, ce qui générait un certain optimisme et une confiance relative dans le système.
Tout ceci est terminé. La société américaine est en déclin. Prenons par exemple le problème du chômage. Le nombre d’Américains ayant un travail a chuté de 5,2 millions entre 2007 et 2010. A cela s’ajoutent les 4,5 millions d’emplois qui auraient dû être créés pour absorber la croissance démographique du pays, pendant ces quatre années. Au total, cela fait près de 10 millions de chômeurs supplémentaires, sur cette période. Le taux de chômage des jeunes de 16 à 19 ans est de 25 %. Il est de 45 % chez les afro-américains de la même tranche d’âge. Et pendant ce temps, les dirigeants républicains et démocrates affirment qu’il faut encore tailler dans les effectifs du secteur public, pour faire des dizaines de milliards d’économies !
Le malaise remonte bien avant la crise de 2008. Les manifestations de Seattle contre l’OMC, en 1999, furent les premiers symptômes d’une fermentation sociale croissante. Les attentats du 11 septembre ont temporairement noyé ce mécontentement dans une vague patriotique. Mais il a refait surface à l’occasion de grandes luttes, par exemple lors de l’occupation de l’usine de Republic Windows and Doors, à Chicago. L’écrasante victoire de Barrack Obama, en 2008, était elle aussi une manifestation d’une immense colère sous-jacente, malgré les profondes désillusions qu’elle réservait. Enfin, quelques semaines après le renversement d’Hosni Moubarak en Egypte, début 2011, les travailleurs du Wisconsin se sont mobilisés à une échelle inédite contre les attaques du gouverneur fédéral, rebaptisé « Hosni » Walker.
Soutien massif
Le magnifique mouvement des indignés américains n’est donc pas tombé du ciel. Et il ne fait aucun doute qu’il annonce des mobilisations encore plus puissantes. La jeunesse est un baromètre très sensible des tensions de classe qui s’accumulent dans les profondeurs du pays. Le 5 octobre, les travailleurs américains ont déjà manifesté leur soutien au mouvement par dizaines de milliers, à l’appel d’une quarantaine de syndicats. Et ce n’est qu’un début. Des luttes massives sont à l’ordre du jour dans la première puissance mondiale : telle est la signification la plus évidente de ces événements. Des millions d’Américains sympathisent avec le mouvement. Un sondage rapporte que 70 % des New-Yorkais « déclarent comprendre et partager le point de vue des manifestants anti-Wall Street ». Un autre sondage, commandé par le Times, établit que 54 % de la population américaine sympathise avec eux. 79 % des Américains jugent que l’écart entre les riches et les pauvres est trop important et 75 % que les millionnaires devraient être beaucoup plus lourdement taxés. Lors d’une récente interview télévisée, le réalisateur Michael Moore – un autre baromètre sensible de la société américaine – a récemment affirmé que « le capitalisme doit être éradiqué ». On ne saurait mieux dire !
Pour un Parti des Travailleurs !
Le 5 octobre, à New York, des dizaines de syndicats – d’enseignants, de fonctionnaires, de l’industrie automobile, etc. – ont appelé leurs membres à rallier la manifestation des indignés. Cela représente une force potentielle colossale. Ce qui est nécessaire, à présent, c’est un parti qui organise, unisse et galvanise les aspirations des masses et leur donne un outil pour en finir avec l’ordre établi et reconstruire la société sur de nouvelles bases. Il est temps que le mouvement syndical américain brise ses liens avec le Parti Démocrate, qui n’est que le pied gauche de la classe dirigeante. Il est temps de construire un parti des travailleurs – un parti « de gauche », en somme – sur la base des syndicats. Il attirerait sous son drapeau les meilleurs éléments de la jeunesse et de la classe ouvrière, par centaines de milliers.
L’universitaire Hector R. Cordero-Guzman a récemment publié une étude sur les indignés américains. On y trouve notamment la statistique suivante : 23 % des manifestants se considèrent Démocrates, 2,4 % Républicains et 70,3 % « Indépendants » – c’est-à-dire ni l’un ni l’autre. Le professeur souligne qu’il y a dans la société américaine « un puissant courant de mécontentement sous-terrain à l’égard des partis traditionnels, ainsi qu’un soutien massif à l’égard d’une perspective de changement radical dans le pays. » Précisément ! Et les dirigeants démocrates ont beau s’efforcer d’exploiter le mouvement, il est clair qu’il vise à la fois les Républicains et les Démocrates. Trois ans après l’élection de Barack Obama, il ne reste plus grand-chose des espoirs qu’il avait suscités.
Nos camarades américains de Socialist Appeal, qui animent la « Campagne pour un Parti de Masse des Travailleurs », soulignent que cette idée progresse sans cesse parmi les travailleurs et les syndicalistes. Il faut qu’elle se concrétise à court terme, par exemple à l’occasion de l’élection présidentielle de 2012. Les conditions sont plus que jamais réunies pour donner une expression politique massive et organisée aux revendications des jeunes et des travailleurs américains.