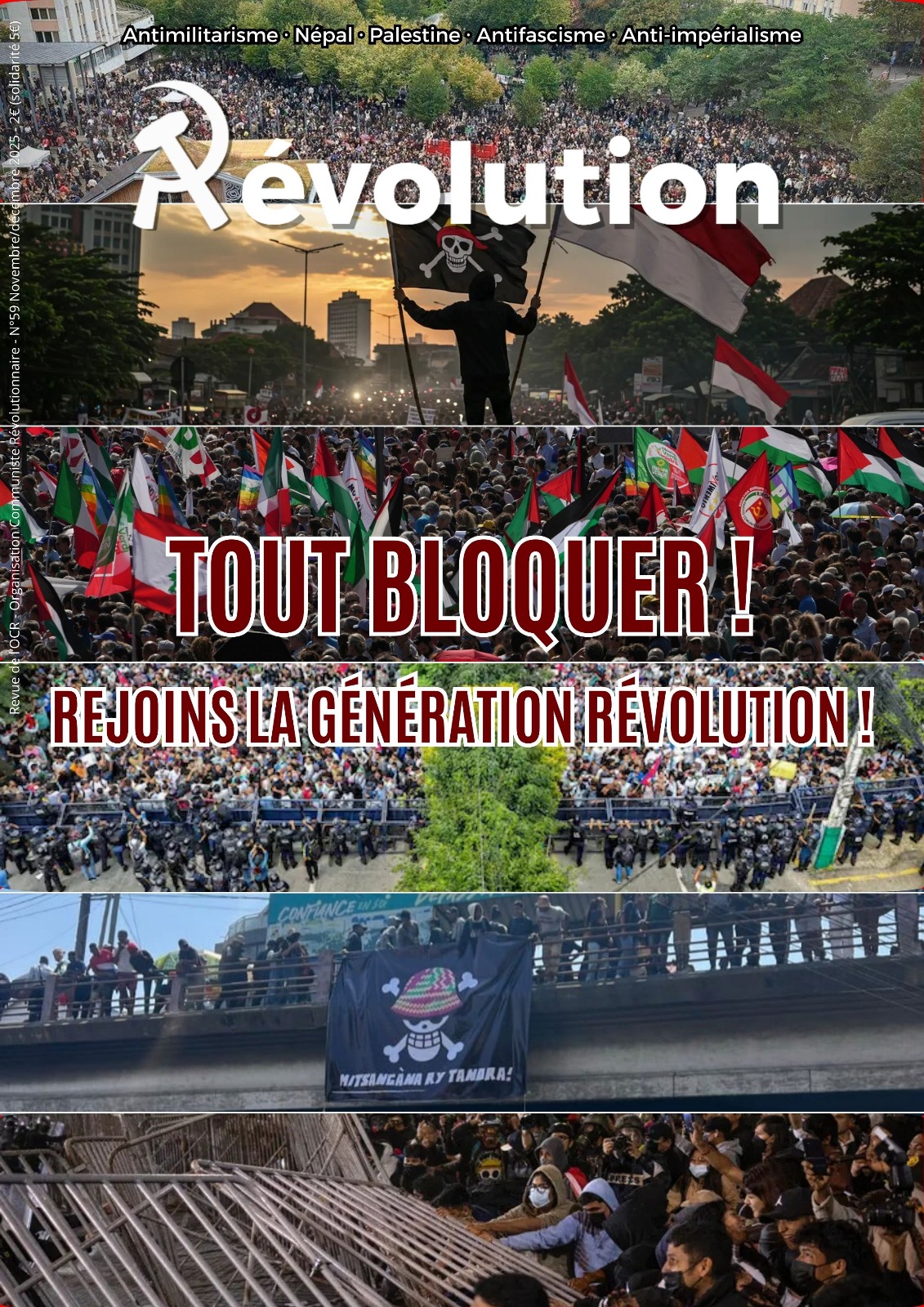L'un des épisodes les plus méconnus et les plus ignorés de l'histoire est celui de la révolte des soldats américains pendant la guerre du Vietnam, de 1964 à 1973. Venue de la base, les soldats insurgés ont écrit l'une des plus belles pages de la lutte des classes aux États-Unis. La révolte dans l'armée américaine a en effet entraîné un conflit violent entre la masse des soldats ordinaires, issus pour la plupart de familles ouvrières et paysannes, et les officiers, surtout issus de la bourgeoisie.
La révolte des soldats était le prolongement d'une double radicalisation aux États-Unis: d' une part, la radicalisation de la classe ouvrière noire (les Black Panthers, le mouvement des droits civiques avec Martin Luther King et Malcolm X), et d’autre part, l'émergence d’un grand mouvement anti-guerre. Cependant, les unités militaires au Vietnam n'ont pas connu de manifestations de masse et d'actions de protestation à caractère politique ouvert comme celles qui ont eu lieu sur le front intérieur (en dehors de l’armée dans le camp américain). Mais cela n'a pas rendu le mouvement des soldats moins subversif, bien au contraire. La révolte des GI s'est avérée être un élément crucial du mouvement anti-guerre. C'est le facteur par excellence sur le front intérieur de la désintégration de l'armée américaine. Un rapport militaire interne pose le diagnostic suivant : « Au sein des forces armées américaines au Vietnam, il existe des conditions qui, au cours de ce siècle, n'ont été surpassées que par l'effondrement des armées tsaristes en 1916 et 1917 » (extrait de l'Armed Forces Journal, juin 1971).
La motivation première des soldats s'est avérée moins politique que sur les campus universitaires où les étudiants s’opposaient au caractère impérialiste de la guerre. Pour beaucoup, il s'agissait de sauver leur propre vie. Cette réaction est devenue connue sous les initiales CYA ou « Cover Your Ass » (couvre ton cul). Cela a conduit à une véritable guerre dans la guerre qui a fini par saper et détruire l'efficacité militaire des troupes américaines. Le sabotage par des simples soldats des tristement célèbres opérations « search and destroy » (cherche et détruit) , les mutineries ouvertes, les meurtres d'officiers et la fraternisation avec l'armée de libération vietnamienne peuvent être considérés comme le meilleur moment de l'histoire de l'armée américaine.
Une révolte marquée par la lutte des classes
Avant de répondre à cette question, nous devons examiner de plus près la composition sociale de l'armée. Sur les dix années de guerre (1964-1974), 27 millions de jeunes hommes ont été appelés sous les drapeaux. Seule une petite minorité d’entre eux, environ 2,5 millions, est partie au Vietnam. Les soldats, qui représentaient 85 % des troupes, étaient presque tous des ouvriers. Les 15 % restants étaient composés d'officiers qui n'ont jamais combattu. Les enfants de l'élite, issus des grandes universités, ne se retrouvaient pas au Vietnam.
Parmi les Noirs, la discrimination était encore plus flagrante. Les Noirs représentaient 12 % de l'armée, mais constituaient un quart des soldats des unités de combat. L'armée américaine regorgeait d'officiers. Le ratio était d’1 officier pour 6 soldats. Cela ralentissait considérablement les possibilités de promotion. En 1960, il fallait en moyenne 33 ans pour passer du grade de lieutenant à celui de colonel.
La guerre du Vietnam a changé la donne de manière perverse. En 1970, le même parcours d'officier pouvait être accompli en 13 ans en moyenne. La nomination à la tête d'une unité de combat au Vietnam était la meilleure garantie d'une carrière rapide, au détriment de la sécurité des GI. Les promotions étaient en effet accordées en fonction du nombre de « charlies » tués (c'est ainsi que l'on désignait les soldats vietnamiens du Front National de Libération (FNL). Plus un officier pouvait inscrire à son palmarès d'opérations « search and destroy » réussies, plus il pouvait gravir rapidement les échelons de la hiérarchie militaire. Lors de ces opérations dans la jungle, les officiers supérieurs, restaient souvent au-dessus de la zone de conflit, la survolant par hélicoptère. Ce sont ces opérations qui ont causé le plus grand nombre de blessés et de morts du côté américain. La décision du commandant en chef, le général Westmoreland, de limiter à six mois le service des officiers au Vietnam, alors que les soldats ordinaires devaient y rester douze mois, a jeté de l'huile sur le feu de l'indignation. Toute la carrière d'un officier dépendait alors de ces six mois passés au Vietnam, où, à la tête d'une unité de combat, il pouvait remplir le quota imposé de « charlies » morts (soldats ou civils). Si un officier ne parvenait pas à obtenir de bons résultats, il était rapidement remplacé. Les opérations de « search and destroy» étaient les plus « productives » pour la carrière d'un officier. Mais, c'était aussi les opérations les plus risquées pour les soldats d'infanterie ordinaires.
De ce point de vue, les opérations « search and destroy » constituaient une amplification extrême des relations de classe dans la société. Aucune armée n'échappe aux relations sociales inégalitaires qui existent dans la société. L'expérience concrète et cruelle des unités de combat au Vietnam a fait prendre conscience à des dizaines de milliers de soldats de l'injustice de la société de classes.
La guerre dans la guerre
L'offensive du Têt de 1968 a renforcé la remise en cause de l'agression américaine contre le Vietnam. Les rapports militaires des troupes américaines ont montré que les Vietnamiens soutenaient massivement le Front National Libération. La prise de conscience qu'il s'agissait d'une guerre pour la domination capitaliste s'est rapidement répandue parmi les soldats ordinaires. Les GI ne pouvaient plus s'identifier aux objectifs de guerre du haut commandement et de Washington.
S’ils refusaient rarement des ordres avant 1968, cette année-là fut un tournant qui changea radicalement la situation. Les mutineries ouvertes, refus collectif des soldats d'obéir aux ordres de combat, se multiplièrent d’année en année. En 1968, 68 cas de mutinerie sont signalés. Un an plus tard, la première division de cavalerie aérienne signala 35 cas de mutinerie dans son unité. Il est frappant de constater que ces mutineries ne sont pratiquement pas sanctionnées. En 1969, quinze rébellions de GI à grande échelle sont enregistrées par l'état-major général. En 1970, certaines unités à la frontière cambodgienne refusent de combattre. La même chose se produit un an plus tard sur le front avec le Laos. De plus en plus d'officiers doivent « négocier avec les soldats » pour faire respecter les ordres. On appelle cela « working out orders » ou tester la faisabilité des ordres. Un autre phénomène apparaît. Le « fragging », un mot d'argot désignant le fait de faire exploser des officiers avec des grenades à fragmentation. Cela devient rapidement une épidémie parmi les officiers qui traitent leurs soldats comme de la chair à canon. En 1968, l'armée recense 126 cas de « fragging », en 1970, ce chiffre passe à 271 et en 1971, il atteint 333. L'armée cesse ensuite de tenir des statistiques.
Certaines sources militaires internes estiment que 20 à 25 % des officiers au Vietnam ont été tués par leurs propres soldats. Il faut noter que cette guerre dans la guerre a également été menée dans l'autre sens. 20 % des cas de« fragging » auraient été le fait d'officiers contre leurs propres soldats.
La désintégration de la discipline militaire et l'effondrement de la hiérarchie prennent de nouvelles proportions vers la fin de la guerre. Les opérations « search and destroy » (cherche et détruit) deviennent en pratique des opérations « search and evade » (cherche et fuir), dans lesquelles les soldats prétendent s'enfoncer dans la jungle, mais refusent simplement d'affronter les unités vietnamiennes. Sur plusieurs fronts, le commandement américain propose des traités de paix ou des accords de cessez-le-feu entre les GI et les soldats vietnamiens. Ce fut le cas, par exemple, à Pace, près du front cambodgien. Le NLF comprenait très bien la situation de l'armée américaine et donna l'ordre de ne pas tirer sur les GI portant des signes de paix sur leur uniforme ou sur les soldats qui pointaient leur fusil vers le sol.
De la révolte à la révolution ?
La révolte multiforme des soldats a également permis de réduire considérablement le nombre de morts au combat dans l'armée américaine, de 70% entre 1967 et 1970.
Un véritable esprit révolutionnaire s'était emparé des GI's au Vietnam pendant ces années. Aux États-Unis également, la radicalisation des jeunes et de la classe ouvrière était très forte. Cependant, la révolte des soldats cache une tragédie. C'était une révolte sans organisation révolutionnaire. Les nombreux journaux clandestins des GI, dont le plus connu était le « Vietnam GI » étaient leur seule forme d'organisation. Une organisation révolutionnaire active dans l'armée à cette époque aurait pu aider à coordonner, centraliser et surtout politiser les nombreuses mutineries par une explication et une formation patiente mais systématique. L'une des raisons était la politique menée par le Socialist Workers Party, un parti de gauche qui se réclamait alors encore du trotskisme, mais qui, au lieu d'envoyer ses militants et ses cadres dans l'armée, menait une campagne de draftdodging, c'est-à-dire d'évasion du service militaire. Une centaine de cadres marxistes formés, actifs au sein de l’armée, auraient pu faire la différence au Vietnam.
Depuis le Vietnam, la bourgeoisie américaine vit avec l'obsession qu’une telle révolte similaire se répète en cas d'engagement long et prolongé de troupes terrestres, où que ce soit dans le monde. Car la preuve en est faite : la jeunesse américaine en uniforme est bien capable de soulèvements, de révoltes et même de révolutions.
Cet article a été rédigé sur la base d'un article très documenté de Joel Geier, « Vietnam : The soldiers rebellion », publié dans International Socialist Review en 1999.
Regarder aussi cette vidéo sur la révolte des soldats américains :