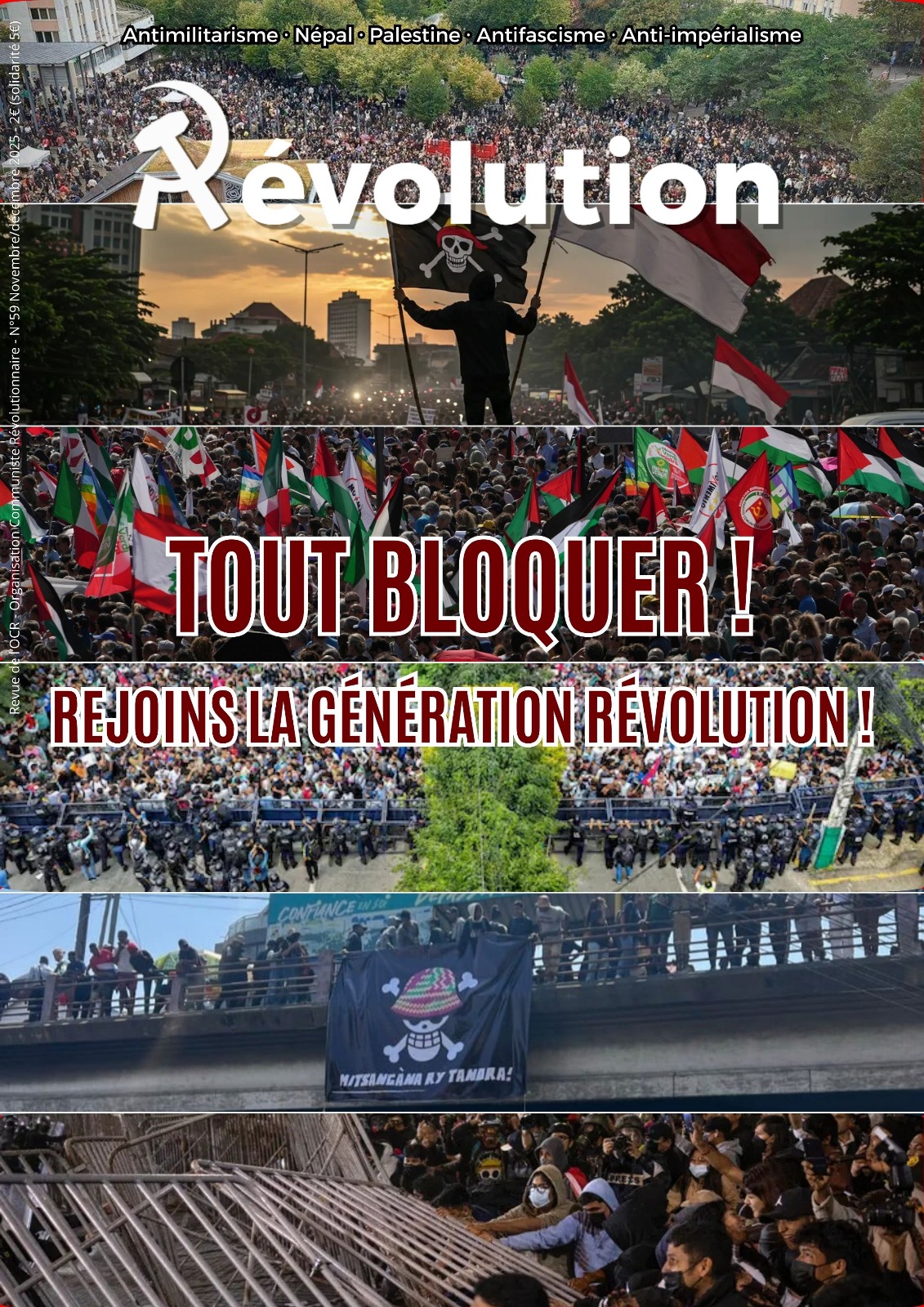Les coopératives ont fait couler beaucoup d'encre en Belgique ces derniers mois : certains sont convaincus que l'entrepreneuriat coopératif est un remède à la crise actuelle, une sorte de (nouvelle) troisième voie entre l’étatisation et les entreprises capitalistes traditionnelles. Lors des dernières semaines de novembre, la banque coopérative « New B » a ainsi été lancée avec le large soutien d'une partie de la société civile et des syndicats.
Dirk Barrez a consacré à ce thème une longue série d'articles dans De WereldMorgen : tous les soutiens de New B sont sincèrement à la recherche d'une alternative à l'observation passive, alors que la crise capitaliste détruit les emplois et les entreprises.
En 2013, "l'économie coopérative" était inscrite dans la nouvelle déclaration de principe du sp.a, tandis que Carine Neven, secrétaire générale de l'ACW Limburg, plaidait « pour la solidarité coopérative en réponse à Ford Elle était allée à la recherche d'idées à l’occasion d'un voyage d'étude dans la ville de Mondragon, au Pays Basque espagnol, vitrine de l'économie coopérative moderne. En 2012 Le Financial Times et ArcelorMittal avaient même osé décerner un prix « Boldness in Business » aux coopératives basques de Mondragon. « Un nouveau modèle de réussite », écrivait le journal des financiers britanniques, qui essaie (encore une fois) de nous convaincre que le capitalisme à visage « humain » est possible.
Les partisans des coopératives affirment que ces entreprises ont mieux résisté à la crise que d'autres formes d'entreprises capitalistes (comme les sociétés anonymes). Elles fourniraient beaucoup plus d'emplois dans le monde que les multinationales (100 millions ) et elles compteraient 1 milliard de membres, qui sont en quelque sorte copropriétaires de leur entreprise. On dit aussi que ces entreprises sont plus favorables aux femmes, plus respectueuses de l'environnement et beaucoup plus respectueuses des droits des travailleurs. Les managers n'y ont pas fait fortune et, au bout du compte, réalisent tout de même du profit.
Dans ce modèle d'entreprise, les « anciennes » contradictions entre capital et travail seraient dépassées. « Les coopératives - comme n'importe quelle entreprise - sont une affaire de commerce et de profit sur le marché, mais leur capital est au service des personnes dans et autour de l'entreprise, et non l'inverse », écrivait la ministre Freya Van Den Bossche dans son explication lors d’une journée politique sur le même sujet.
Il s'agit d'une discussion importante pour le mouvement syndical. Quelles sont les lois de l'économie capitaliste ? Est-il possible de les contrôler ou même de les transcender à travers l'économie coopérative ?
La première chose que nous devons préciser, c'est que le concept de coopérative recouvre des contenus différents, parfois très différents. Par exemple, il y a les coopératives de travailleurs du textile en Argentine, qui ont été créées à la suite de l'effondrement économique de 2002. Les travailleurs ne se sont pas résignés à la fermeture de leur entreprise : ils se sont organisés collectivement, ont occupé leur entreprise, ont violé le droit sacré de la propriété capitaliste et ont essayé de relancer l'activité. C'est ainsi qu'ils ont remis en question le capitalisme. Ils ont démontré dans la pratique que la production peut se faire sans patrons.
Ensuite, il y a les coopératives agricoles en France, auxquelles 9 agriculteurs sur 10 sont affiliés, ou les coopératives financières en Inde, qui sont complètement immergées dans le capitalisme financier. Beaucoup de petites coopératives ne survivent qu'en tant que sous-traitantes de grandes entreprises capitalistes. Alors que certaines coopératives ont vu le jour à la suite de luttes sociales et sont liées au mouvement ouvrier ou paysan, beaucoup d'autres ne sont que des sociétés de distribution de consommateurs organisés. Certaines coopératives s’inscrivent dans une tentative (socialiste, révolutionnaire ou autre) de changer la société ; d'autres (le plus grand nombre) ne se fixent aucun objectif social. Presque toutes font partie intégrante du système économique et financier existant et ne le remettent pas en question. Le dénominateur commun de toutes ces sociétés est d’être formellement entre les mains des " actionnaires-employés ".
Dans la production moderne, sous le capitalisme, aucun segment de l'économie, aucune entreprise individuelle ne peut échapper à la division du travail. Aucune entreprise, pas même une multinationale, n'a le contrôle de tous les aspects de sa production du début à la fin. Aucune entreprise ne peut produire seule, parce qu'elle dépend de la production et de l'organisation de l'ensemble de l'économie capitaliste. Aucune partie de la production ne peut s'isoler, en tant que telle, du reste de l'économie. Pour survivre et être compétitives, les coopératives doivent s'adapter aux intérêts du marché. De plus, dans un environnement de crise capitaliste, cela signifie que les actionnaires-salariés doivent recourir à l'auto-exploitation (journées de travail plus longues, salaires plus bas, etc.) afin de survivre. Même le licenciement est envisageable pour les empêcher de sombrer. Il est vrai que dans une coopérative, il n'y a plus de capitaliste individuel. Cependant, on assiste au développement d'une mentalité de petit propriétaire chez les actionnaires salariés, à une dilution de la conscience de classe. Il y a un risque réel que les « employés » commencent à penser et à agir, non pas en tant que capitalistes individuels, mais en tant que capitalistes collectifs . S'il n'y a pas une mais plusieurs entreprises (ou même des coopératives) actives dans un secteur ou un segment de production particulier, elles sont en concurrence les unes avec les autres. Il s'agit donc de « s'adapter ou disparaître ». De cette façon, les coopératives adoptent de plus en plus les pratiques des entreprises capitalistes traditionnelles afin de pouvoir faire face à la concurrence.
Le risque est également que d'autres travailleurs et employés soient de plus en plus considérés comme des concurrents et moins comme appartenant à la même classe sociale. Cela sape la solidarité. Lorsque les coopératives se généralisent, nous courons le risque que le mouvement ouvrier se divise, s'atomise et se fasse de plus en plus concurrence. Dans une économie de marché libre, les coopératives efficaces suppriment les moins efficaces, et l'objectif du changement social est relégué au second plan : la priorité est de garder la tête hors de l'eau. L'horizon politique de la lutte est ainsi réduit à la survie économique sur le marché capitaliste. De cette façon, les coopératives deviennent une fin en soi et non un moyen d'émancipation sociale plus large.
L'énorme avantage des coopératives est, bien sûr, de prouver qu'aucun capitaliste individuel n'est nécessaire pour gérer l'économie. Les employés peuvent gérer leur propre entreprise, comme cela a été prouvé à plusieurs reprises. Mais nous pensons qu'il est faux de croire que l'entreprise coopérative est une alternative à la société à responsabilité limitée ou au capitalisme individuel, tant qu'il n'y a pas de rupture totale avec le capitalisme.
Il serait bien plus profitable de lutter pour l'expropriation de la propriété capitaliste et de la remplacer par une économie démocratiquement planifiée et nationalisée. Les grands leviers de l'économie seraient alors en possession de l'ensemble de la société, en particulier de la classe ouvrière. Les entreprises seraient, elles, sous le contrôle des travailleurs et sous la gestion de leur propre personnel, mais également sous le contrôle de la majorité de la population à travers un plan central. Les excédents pourraient ensuite être dépensés dans les besoins que la société déterminerait collectivement, de façon démocratique.
Mondragon, tout ce qui brille n’est pas d’or...« Mondragon Coopération » est considérée comme un exemple à suivre du coopérativisme. Mondragon est une grande coopérative du Pays Basque. Depuis sa fondation, elle est devenue une véritable multinationale avec 83 000 employés dans le monde entier. Elle a développé une large gamme d'activités dans la construction, l'industrie, la recherche, le commerce et même dans le secteur financier. Seule la moitié des salariés y sont actionnaires. Oui, Mondragon fait aussi des bénéfices. « Nous faisons partie du marché, nous sommes en concurrence dans le monde capitaliste et la seule différence est comment et pourquoi nous faisons des affaires. Nous devons être compétitifs, nous devons être efficaces, nous devons livrer des produits de qualité... et nous devons aussi être rentables. En ce sens, nous ne sommes pas différents des autres entreprises », expliquait ainsi Txema Gisasola, l'un des dirigeants de Mondragon. C'est clair : Mondragon et ses actionnaires-salariés sont pleinement soumis aux lois du marché, à la recherche de la rentabilité (dans le capitalisme), de la productivité et de la compétitivité. Un autre directeur explique au magazine Le Mouton Noir (Québec) les conséquences de la crise économique actuelle sur l'entreprise. « José Luis Lafuente admet que le groupe joue sur le même marché que les autres. Nous avons également dû procéder à des réductions sur les salaires, sur la main-d'œuvre, diminuer les profits, augmenter la concentration de nos activités et réduire les investissements ». En 2008, 7 000 emplois ont ainsi été supprimés chez Mondragon. Plus loin dans l'article, l'auteur analyse : « Les travailleurs que nous rencontrons et qui travaillent pour l'entreprise Elorio, décrivent une situation socio-économique très difficile dans laquelle Mondragon est plutôt vu comme un capitalisme caché. La croissance du mouvement a conduit à ce que la prise de décision se fasse au détriment de la base. Par conséquent, dans les opérations quotidiennes, les pratiques de gestion sont semblables à celles des industries traditionnelles. » Il y a aussi de plus en plus de plaintes concernant la croissance de la tension salariale dans l'entreprise (c'est-à-dire la différence entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut ) qui est en contradiction avec la philosophie de la coopérative. Cela explique aussi pourquoi, en 2012, pour la première fois depuis longtemps, les travailleurs de Mondragon, avec d'autres entreprises, ont participé à la grève générale au Pays Basque. Eroski est la chaîne de grands magasins de Mondragon Corporation. Sur les 40 000 salariés, seuls 8 000 sont actionnaires ; cela signifie que les 32 000 autres employés sont recrutés / exploités par les 8.000 autres. Les 'actionnaires-employés' développent une conscience semblable à celle d'un petit propriétaire. La conscience de classe d'un travailleur salarié ou d'un employé diminue donc considérablement : certains pensent qu'ils ont des intérêts différents à ceux du reste de la classe ouvrière. C’est ainsi que, lorsque la bataille pour la semaine de 35 heures a éclaté dans le secteur du commerce de gros, les "travailleurs-collaborateurs" de la plupart des ateliers Eroski ont voté contre la grève. Ce faisant, ils ont exprimé leur réticence à améliorer leurs conditions de travail et celles de leurs collègues non actionnaires. Le personnel est divisé en " collaborateurs ", " aspirants collaborateurs ", " temporaires " et " indépendants ". Les "collaborateurs" ont plus de droits (ils ont injecté du capital...) que les autres qui se situent plus bas dans l'échelle hiérarchique. De nombreux intérimaires sont recrutés sur des contrats à court terme pour seulement 20 à 30 heures par semaine. Dans la section Galicienne d'Eroski, les syndicats ont pris des mesures contre le changement unilatéral des horaires et contre les licenciements. Ils parlent de la " dictature d’entreprise ". La direction s'efforce également d'éviter le paiement des heures supplémentaires. Leurs salaires sont inférieurs de 10 à 15% au salaire moyen du secteur, malgré les 18,65 millions d'euros de bénéfices que le groupe a enregistrés en Galice. On peut observer des conflits similaires surgir dans le groupe à d’autres endroits. Ce genre de conflit est typique d’une entreprise capitaliste et c’est la raison pour laquelle nous pensons que ce type de société n’est pas une réelle alternative. |
L'expérience belge : « s'attaquer au capitalisme avec du pain et des pommes de terre ».Dans notre pays, le mouvement coopératif a connu son essor au XIXe siècle. Au sein du mouvement ouvrier, il peut compter sur un large public. La crise des années 1870 et l'importation de céréales américaines bon marché ont été un terreau fertile pour la production et la distribution coopérativistes de pain, principal composant de l'alimentation de la classe ouvrière. Les tisserands ont levé des fonds de démarrage et ont commencé à faire du pain. En 1879, ils font cuire plus de 240 000 miches de pain. Très vite, une séparation s’effectue entre les pragmatiques, qui veulent laisser les coopératives en dehors de la politique, et les socialistes, qui veulent soutenir matériellement la lutte des classes avec les boulangeries. La coopérative socialiste Vooruit est fondée en 1880 sous la direction d'Edward Anseele. L'objectif est de promouvoir la propagande socialiste et l'organisation politique de la classe ouvrière. La cuisson du pain n'était donc pas une fin en soi. La gamme de produits s'élargit rapidement pour inclure l'épicerie, l'habillement, les chaussures, le charbon, etc. Les activités de l'entreprise ont également été élargies pour inclure la vente d'aliments, de vêtements, de chaussures et autres produits. Des pharmacies populaires ont également été ouvertes. En 1914, Vooruit avait un petit empire avec deux grands bâtiments, un grand magasin, quatre dépendances, un atelier de maroquinerie, une usine de chaussures, trois magasins de chaussures, une fabrique de pain, un entrepôt central, 23 épiceries, 7 pharmacies, une brasserie, une usine de chicorée, une filature textile et même une usine de tissage. Cette dernière a adopté le statut de société anonyme en 1910. C'est ainsi que le Vooruit est devenu la base à partir de laquelle la classe ouvrière gantoise a commencé à s'organiser. Elle a été rapidement imitée dans toutes les villes industrielles, et les coopératives ont prospéré dans tout le pays. Des caisses d'assurance maladie ont été créées ainsi que la première assurance ouvrière : la Prévoyance Sociale. Elles servaient alors à répondre aux besoins quotidiens de la classe ouvrière et constituaient l'épine dorsale financière et organisationnelle du socialisme en Belgique. La faiblesse de cette structure résidait dans le fait que toutes ces organisations ne représentaient les intérêts des travailleurs qu’en tant que consommateurs ou malades. Leur objectif premier étant de protéger la classe ouvrière contre les conséquences du capitalisme, le mouvement est devenu fortement défensif dans son orientation. A mesure que le succès de toutes ces organisations grandissait, certains dirigeants socialistes commençaient à considérer les coopératives comme le fer de lance du renversement du capitalisme. D'où l'illusion qu'il est possible de lutter contre le capitalisme sur son propre territoire avec des « entreprises rouges ». C’est en fait exactement le contraire qui s’est produit. Par le biais de la coopérative, ce sont les idées capitalistes qui se sont infiltrées dans le mouvement socialiste. Sous l'impulsion d'Anseele, certaines coopératives se sont transformées en sociétés anonymes. En 1911, il était également prévu de créer une banque. Le gantois Anseele la voyait ainsi : « Les petites gens ont retiré au moins 800 millions de l'épargne capitaliste pour les confier à une banque nationale du travail afin de faire du commerce, d'acheter des usines, des ateliers, des mines, des terres, des bateaux de pêche, etc. En quelques années, les travailleurs belges feraient des affaires pour des centaines de millions, ils gagneraient des millions par an et libéreraient des dizaines de milliers de travailleurs, de travailleuses ainsi que leurs enfants de l'oppression capitaliste. En moins d'une génération, ils deviendraient maîtres d'une grande partie du commerce, de l'industrie et de la banque ». Au fur et à mesure, les méthodes de gestion capitalistes ont été introduites et une bureaucratie de gestionnaires, de chefs d’entreprise et de permanents s'est développée. Ils étaient de plus en plus réticents à accepter des actions et des mouvements qui menaçaient l'existence même de leurs organisations. Ils sont devenus conservateurs et ont exercé une influence « modératrice » sur la politique du POB (Parti Ouvrier Belge). Sur le plan politique, ils ont formé la frange du mouvement ouvrier favorable à la prise de pouvoir progressive au parlement et à la participation au gouvernement avec les partis civils. Après la Première Guerre mondiale, les coopératives de consommateurs, en particulier, ont continué à se développer : en 1930, elles comptaient 1 million de membres. Les mutuelles de santé comptaient 800 000 membres. Les bénéfices n'ont pas été distribués individuellement, mais investis dans le travail social. Grâce à la politique sociale menée, ces organisations se sont entrelacées avec l'état civil ; elles ont également reçu des fonds publics. Les coopératives de production ont été transformées en sociétés anonymes avec la participation majoritaire du Vooruit et de la Banque du travail. Ce n'est pas seulement la gestion qui est devenue de plus en plus capitaliste : les relations sociales, elles aussi, se sont de plus en plus fondées sur des principes capitalistes. Par exemple, des échelles de salaires ont été introduites, et des dirigeants qui n'avaient rien à voir avec le socialisme ont été maintenus dans la structure. Dans certaines de ces entreprises, la loi des huit heures a été violée en consultation avec le syndicat. La Banque du Travail est même allée jusqu’à acheter une plantation de coton au Congo, la colonie belge. En conclusion, l'économie coopérative, conçue comme un moyen de supprimer le capitalisme, a eu l'effet contraire et c’est le mouvement ouvrier qui a été affecté par la mentalité et les pratiques capitalistes. |