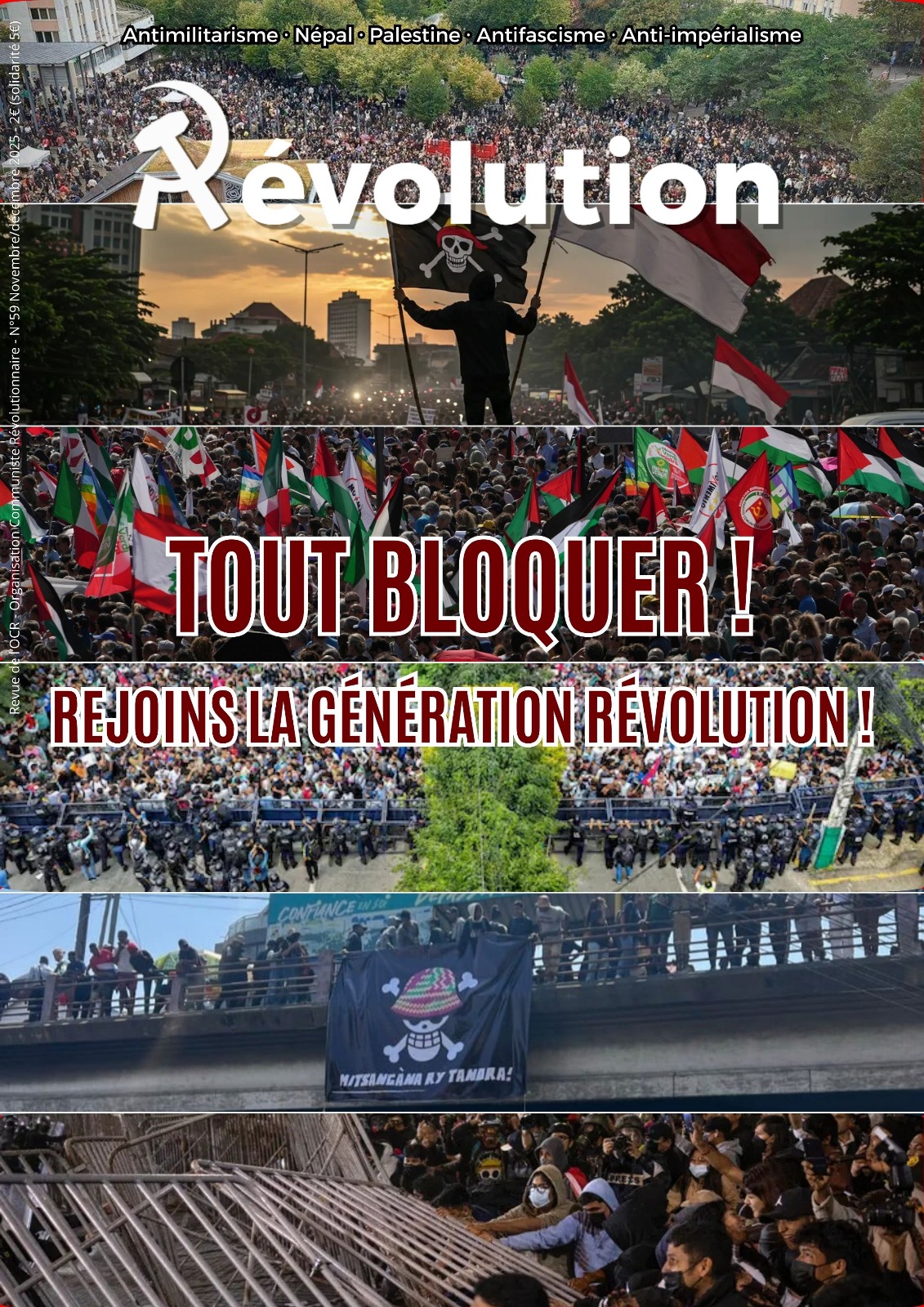En moins d’un mois, le monde entier a reçu une leçon d’économie
politique en grandeur nature. La crise financière a déchiré le voile
invisible de l’idéologie néo-libérale.En catastrophe, les états sont
intervenus, d’abord en ordre dispersé puis de manière plus concertée.
De la nationalisation partielle aux rachats des dettes« pourries » en passant par des recapitalisations, il fallait juguler la crise, éviter l’effondrement. Les sommes monétaires injectées, mises à disposition ou garanties dépassent les 2500 milliards de dollars. Les plus prompts à réagir à l’événement de la crise furent les gardiens du temple de la « phynance ». Ils chantent que l’intervention n’est qu’une parenthèse et qu’ensuite il faudra moraliser les marchés. « Régulation » est désormais le maître mot. Mais que faut-il réguler ? Et est-ce bien réaliste ?
Tout le monde a compris que le système bancaire risquait de s’effondrer par manque de liquidités. Mais pourquoi donc ? Derrière la crise liquidités se trouve un problème de solvabilité qui fait suite à la crise des subprimes de l’été 2007 lorsque les ménages états-uniens, endettés jusqu’au cou, n’arrivaient plus à suivre les taux variables de leurs crédits hypothécaires. Un an plus tard, plus d’un million et demi de personnes ont été expulsés de leur habitation. Les cours des titres de créance ont plongé et les banques ont dû les intégrer dans leur bilan pour finir par afficher des pertes. Comme bon nombre d’institutions financières avaient acheté et revendu ces titres, les dominos ont alors commencé à tomber : Bear Sterns, Fannie Mae & Freddie Mac, Lehman, JP Morgan, AIG, Fortis, Dexia, les banques d’Islande,…
Commencer la chronologie par la crise des subprimes suggère une cause évidente : il ne fallait pas prêter aux pauvres ! Faux : le secteur du crédit hypothécaire était obligé de le faire. Ce marché devait continuer à s’accroître faute de quoi les valeurs immobilières (cotées en bourse) allaient s’effondrer. La seule solution était d’élargir le marché aux revenus moyens et faibles, avec les risques que cela comporte. Ce risque fut mutualisé en mélangeant les crédits nouveaux avec d’autres à risque moindre dans des produits composés (les « véhicules »). Cette invention que l’on doit en grande partie à Alan Greenspan (1) a donc permis de poursuivre la fuite en avant. Conclusion : la crise de liquidités plonge ses racines dans un endettement massif. Autrement dit, l’iceberg flotte sur un océan de dettes …
Aux Etats-Unis, l’endettement des ménages a augmenté pour atteindre 120% de leurs revenus. C’est normal : le crédit était bon marché puisque les taux d’intérêt étaient au plus bas. Progressivement, le patrimoine entier des Américains a été utilisé comme bois de chauffe pour l’économie. Un équilibre fut rendu possible par l’apport d’argent fais des pays émergents (via l’achat de bons du trésor par les fonds souverains). Mais la croissance tirée par l’endettement ne pouvait durer éternellement. Reste à savoir pourquoi le crédit a connu une telle croissance.
Serait-ce les normes de consommation tourné vers l’opulence? Ne confondons pas cause et effet. Certes, le crédit est un carburant de l’économie mais dans ce cas précis, il a été beaucoup plus. Lorsque la part des salaires dans la valeur ajoutée baisse, lorsque les revenus réels disponibles des sept déciles inférieurs baissent ou stagnent depuis plus d’une décennie, le crédit bon marché permeten fait de surmonter (provisoirement)le problème de la surproduction.
Tel un cauchemar qui revient sans cesse, la crise de surproduction doit être évitée à tout prix pour le capital. La surproduction signifie qu’il devient impossible d’écouler les marchandises, et donc de réaliser le profit tiré du labeur humain. Or, chaque fraction du capital ne connaît qu’une seule rationalité, celle de la maximisation de ses profits. L’addition de ces rationalités se traduit par l’obligation de continuer à tout prix le processus d’accumulation. Chaque unité de capital doit être augmentée dans un mouvement cyclique qui embrasse production et consommation de marchandises. Quand le mouvement d’accumulation s’arrête, c’est l’infarctus, du moins pour certains tandis que d’autres, plus solides peuvent absorber et racheter.
Depuis les années 1970-1980, les pays de l’OCDE tendent à devenir des marchés de renouvellement, des marchés de niche. Il a fallu plus d’une décennie pour rétablir une profitabilité érodée dans un contexte de large contestation sociale. Les moyens mis en œuvre pour rétablir cette profitabilité correspondent étonnamment à ces mesures pour combattre la baisse tendancielle du taux de profit que Marx avait déjàidentifié en son temps : 1- augmentation du degré d’exploitation du travail (prolongation de la journée de travail et intensification du travail) ; 2 - baisse du prix du capital constant (innovations et allongement du temps machine) 3- accroissement de l’armée de réserve et surpopulation relative ; 4 - dévalorisation du salaire ; 5 - développement du commerce extérieur (élargissement de l’échelle de la production et de sa distribution) ; 6 - augmentation du capital par actions (2). De manière plus concrète, on peut dire que le capital a mené une contre-mobilisation, sous le drapeau du néo-libéralisme et de la globalisation : via le lean manufacturing, la précarisation et une paupérisation laborieuse ; la flexibilité et la mise en concurrence des protections sociales et des bassins d’emploi. Rétablir la profitabilité signifiait aussi inverser le rapport de force sur le champ social et politique, restreindre et réprimer l’action syndicale, démanteler les conquêtes et les droits qui avaient contribué à démarchandiser le travail. La réussite relative de cette contre-mobilisation portait néanmoins en germe une contradiction majeure : qui de l’Indonésie, des Philippines ou de la Chine dispose du pouvoir d’achat nécessaire pour acheter la production fabriquée dans leurs ateliers et vendue avec des prix déterminés sur le marché mondial ? Qui dans les métropoles capitalistes peut continuer à acquérir sans crédit les biens de consommation ? Le modèle de croissance des vingt dernières années était de nature profondément inégalitaire.
La rationalité capitaliste est d’autant plus aveugle qu’elle semble efficace. Les entreprises ont renoué avec les profits depuis la seconde moitié des années 1980. Surtout les firmes multinationales de l’industrie et des services. Les profits accumulés leur ont permis de créer des banques internes ; elles ont spéculé avec leurs capitaux sur les marchés monétaires ; ont développé lesinvestissements et les prises de participation dans les pays « émergents ». Il suffit d’étudier de près l’action de ces grandes multinationales pour comprendre que la financiarisation n’est pas une excroissanceparasitaire.Le taux d’investissement demeure constant (autour de 5%) laissant une bonne tranche aux actionnaires. Avec la « désintermédiation », les entreprises se sont financées directement via le marché en augmentant leur capital en actions au lieu d’aller voir l’intermédiaire qu’était le banquier. Les marchés financiers sont devenus un gigantesque monopoly pour ensuite devenir un casino géant qui permet de faire fructifier les capitaux accumulés et non réinvestis. Les fonds de pensions ont certainement accéléré le mouvement de financiarisation. Leur action est souvent présentée comme « prédatrice » car exigeant 15% de retour sur capital investi. Or, ceci est la logique même du capital. Celui- convertible est toujours attiré vers des endroits où la profitabilité est la plus élevée. Pour éviter sa migration sous des cieux plus rémunérateurs, il faut donc le nourrir autant qu’ailleurs. Ce qui s’appelle la péréquation des taux de profits. Au début, les entreprises lèvent des fonds, augmentent leurs actifs pour pouvoir grandir, notamment via des rachats et fusions. Elles poursuivent ensuite leur chemin, font fructifier les collateral debt obligations, credit default swaps et autres titres de créances. Parier sur des profits futurs est devenu plus profitable qu’augmenter les volumes de production. Mais le bal des transactions ne crée pas de richesses. L’écart avec l’économie « réelle » se creusait depuis 1998. Les banquiers et les assureurs ont commencé à jouer au casino aussi. L’orgie spéculative s’est déplacée de la net-économie au marché immobilier pour ensuite passer par le marché des biens alimentaires et des ressources naturelles. Jusqu’à n’en plus pouvoir.
Aujourd’hui, la récession va non seulement conduire à des restructurations massives et jeter sur le pavé des centaines de milliers de personnes en Europe et aux Etats-Unis, elle risque également de conduire à des déflagrations sur les marchés dérivés (concentrant plus de 60 000 milliards de $, une somme avoisinant le PIB mondial) et ainsi re-alimenter la crise bancaire et monétaire. La probabilité est élevée que les 2000 milliards d’euros injectés ici et là ne suffiront pas.
Un catastrophisme n’est pas pour autant justifié. Le capitalisme ne va pas s’écrouler de lui-même. Un éditorialiste du quotidien Britannique The Guardian écrivait fin septembre : « Lénine disait que les capitalistes pourront se sortir de chaque crise tant qu’ils réussissent à la faire payer par les travailleurs. Ce n’est pas très sexy de dire cela aujourd’hui mais c’est sans doute la meilleure description de ce qui est en train de se passer… ». En France, Sarkozy prépare le terrain : alimenter les peurs et appeler à l’union nationale tout en relançant l’offensive sur le travail dominical. Mais comment justifier des sacrifices après avoir ouvert les mannes de l’Etat, mis entre parenthèses le pacte de stabilité et fait fonctionner la planche à billets ? La récession appelle des mesures protectrices, des solutions concrètes : un bouclier social, une échelle mobile des salaires, un pôle de crédit public, des nationalisations sous contrôle des usagers et des salariés. Ceci dessine une ligne défensive, unitaire évidemment.
L’écrivain Gore Vidal a dit du plan Paulson que c’est le socialisme pour les riches et le capitalisme pour les pauvres… Chacun peut désormais comprendre que l’économie est politique par essence. Ce qui ouvre la possibilité de penser une autre économie et un autre système de production et d’allocations de ressources. Le mot « autre » signifie pour certains « un autre capitalisme » car il en existerait plusieurs. C’est oublier que ces variantes résultent des configurations nationales et des rapports de force construits au cours du 19e et du 20e siècle. Sachant comment la crise financière, alimentaire, écologique, sociale et bientôt géopolitique interagissent; sachant comment toutes ces crises plongent leurs racines dans l’ordre globalisé de la marchandise et du profit, on peut se demander si la proposition de construire un « autre capitalisme » sans les capitalistes ou contre leur gré est bien réaliste. La terre ne peut tourner autour de deux soleils en même temps : satisfaire ET la soif de profit de quelques-uns ET les besoins sociaux de tous les autres. La crise systémique invite désormais à trouver la porte de sortie, une alternative qui porte un nom : le socialisme. En le prononçant, il redevient possible de faire le tri des expériences passées et d’ouvrir un horizon d’avenir pour l’humanité.
Stephen Bouquin
Maître de conférence à l’université d’Amiens ; directeur de la revue « Les Mondes du Travail »
(1) http://www.nytimes.com/2008/10/09/business/economy/09greenspan.html
(2) K. Marx, Le capital, livre troisième, Tome 1, chapitre XIV.
Sidebar

 Révolution
Revue marxiste
Révolution
Revue marxiste
08
Jeu, Jan