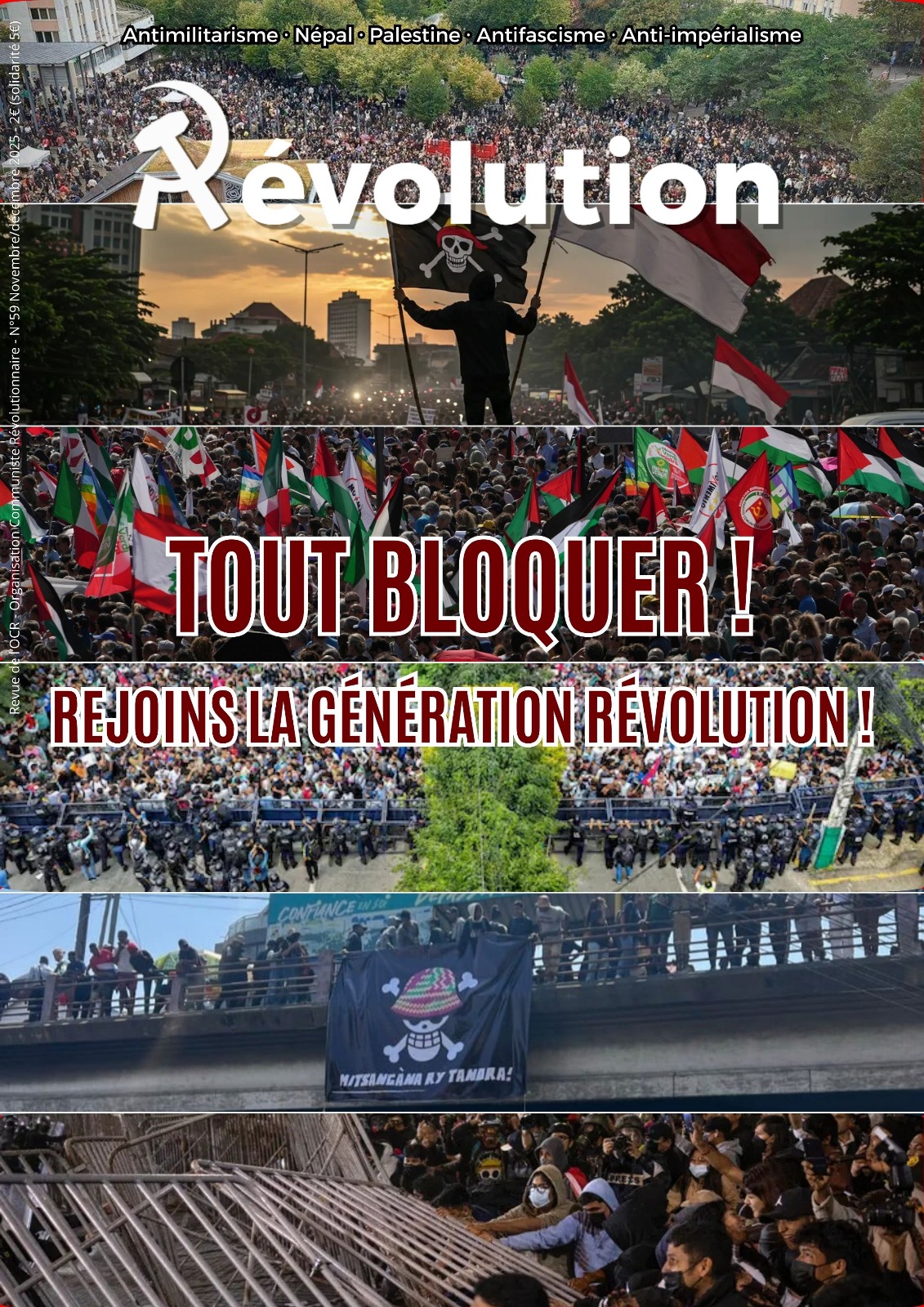La Bourse est à la fête. L’indice boursier belge, le Bel20, qui enregistre les cours des vingt actions les plus importantes, a augmenté de 20 % au cours des six premiers mois de l’année. Cette poussée s’est poursuivie pendant l’été. L’indice est désormais bien parti pour battre un record vieux de 14 ans, établi en 2007.
L’explication de ce phénomène est évidente. L’économie mondiale et donc aussi l’économie belge semblent se remettre du coup de massue de la crise du Covid-19. Après une contraction historiquement profonde et brutale en 2020, « la plus forte chute depuis la Seconde Guerre mondiale » selon la Banque nationale, l’économie rebondit. Les institutions internationales et belges prévoient une croissance significative du PIB cette année, entre 4 et 5,5 %. Un peu moins cependant l’année prochaine. Toutefois, cette croissance ne compense pas la forte baisse de plus de 6 % enregistrée l’année dernière. Ce n’est que l’année suivante que le PIB retrouverait son volume de 2019. De nombreux travailleurs qui étaient temporairement au chômage pendant la pandémie retrouvent un horaire à temps plein. Certaines entreprises commencent aussi à recruter du nouveau personnel ou transforment des contrats d’intérimaires en contrats fixes.
Le rebond actuel n’est pas une anomalie ni une surprise. Il n’existe pas « d’effondrement final » du capitalisme. Sans un renversement conscient du capitalisme par la classe travailleuse, le système trouvera toujours des moyens de se sauver. Il le fera sur le dos de la majorité de la population. Les traditionnels mouvements du cycle économique continuent de fonctionner dans toutes les phases du capitalisme, même pendant les crises comme aujourd’hui. La question est toutefois de savoir à quel type de reprise nous allons assister. Le renouveau est-il le signal de départ d’une nouvelle et longue période de prospérité économique ou simplement une pause entre deux crises ? Dans les années 1930, Trotsky a expliqué le lien entre les fluctuations du cycle économique et la crise du capitalisme : « Dans les périodes de déclin capitaliste, les crises ont un caractère prolongé, tandis que les booms sont rapides, superficiels et spéculatifs. »
Une reprise rapide, mais fragile et inégale
La forte reprise dans certains pays est d’abord le résultat de l’épargne thésaurisée pendant les différents confinements. C’est notamment le cas pour une partie de la population des pays industrialisés. Il est vrai que la crise sanitaire et économique a touché de grandes couches de la société. Mais d’un autre côté, il y a d’autres couches, y compris dans la classe travailleuse dont les revenus n’ont pas été affectés et qui n’ont pas dépensé leur argent pendant cette période parce que les restaurants et les cafés étaient fermés, et que les voyages étaient plus difficiles ou interdits. Selon la Banque nationale, les « Belges » auraient ainsi épargné 22 milliards d’euros durant cette période. La fin de la pandémie et la fin des mesures de confinement signifient presque mécaniquement la relance de la consommation. Bien entendu, cela a un effet positif sur l’économie.
Un autre moteur de la reprise est l’intervention massive des pouvoirs publics dans l’économie. Le coût des mesures prises par les gouvernements régionaux et fédéraux pour amortir les chocs économiques, sociaux et sanitaires s’élève à plus de 31 milliards d’euros. Pour oxygéner l’économie, la Banque centrale européenne (BCE) a également acheté massivement des titres aux gouvernements et aux entreprises. Cela a permis de maintenir les intérêts (le loyer de l’argent) à un niveau bas. Le bilan de la BCE comporte désormais 7 700 milliards d’euros de titres et d’autres actifs. C’est sans précédent. Tôt ou tard, cela alimentera également l’inflation, du moins dans les régions les plus industrialisées du capitalisme mondial. Aux États-Unis, l’inflation a déjà atteint 5 % sur base annuelle. Elle est aujourd’hui principalement due à la pénurie de nombreuses matières premières et de composants et à la limitation du transport mondial par conteneurs.
Tous sur le pont pour les bénéfices !
Les capitalistes eux-mêmes se rendent compte que cette reprise risque d’être de courte durée et font tout ce qu’ils peuvent pour produire le plus possible, le plus vite possible et le moins cher possible. De nombreuses entreprises ont profité avec avidité des aides gouvernementales depuis le début de la pandémie. Aujourd’hui, ils veulent tirer le maximum et le plus rapidement possible du regain d’activité aux dépens de la classe travailleuse. Les profits se redressent, mais ni nos salaires ni nos conditions de travail ne ressentent cette amélioration. La camisole de force rigide sur nos salaires (grâce à l’Accord Interprofessionnel), qui ne permet qu’une augmentation salariale de 0,4 %, en témoigne. Mais il y a plus que cela. Chez Volvo Cars à Gand, la direction veut faire passer le temps de travail hebdomadaire de 37,5 à 40 heures. Pour cela, les travailleurs ne seront même pas payés 40 heures. Les grèves spontanées du mois de juillet contre ce plan l’ont arrêté temporairement. Mais le ton a été donné. Volvo Cars est une entreprise test pour voir dans quelle mesure le patronat peut dégrader les conditions de travail dans l’ère post-Covid-19.
Ce sera également un test pour les syndicats. La proposition de la semaine de 40 heures contre laquelle les travailleurs se sont spontanément mis en grève a été scandaleusement défendue par les délégations syndicales de Volvo Cars !
Partenariat social ou lutte des classes
Nombreux sont ceux qui, au sein du sommet syndical de la FGTB et de la CSC, pour ne pas mentionner la CGSLB, jouent à fond la carte du « partenariat social ». En témoigne l’accord discrètement conclu entre syndicats et fédérations patronales, au sein du fameux G10, pour la « relance de l’économie dans l’ère post-Covid-19 ». Cette déclaration de début septembre de l’année dernière est entièrement baignée dans un esprit de « coopération » et de « consensus ». La FEB, en fait l’éloge sur son site web. « Ce message du Groupe des Dix constitue ni plus ni moins qu’un jalon, un point de référence dans les relations socio-économiques entre employeurs et syndicats. »
Tout le monde ne voit pas ces relations « socio-économiques » de la même manière dans le mouvement syndical. Heureusement. La grève de 24 heures contre la norme salariale le 29 mars, la forte opposition interne contre l’AIP dans les plus grands syndicats et la nouvelle manifestation contre la loi sur les salaires le 24 septembre en témoignent. Mais pour mener à bien cette lutte, les syndicats, du sommet jusqu’au militant syndical sur le terrain, doivent s’affranchir de la notion de « partenaires sociaux ». Il faut la remplacer par « lutte des classes » dans l’esprit et dans les pratiques des militants syndicaux. Après tout, nos intérêts sont contradictoires et incompatibles avec ceux du patronat. Le patronat n’est pas un partenaire « légitime » avec lequel on se dispute occasionnellement, mais qui a le droit d’exister. Non, les capitalistes sont une classe sociale exploiteuse et oppressive qui doit être expropriée. A sa place, les grands leviers économiques et financiers doivent être nationalisés et une économie planifiée doit être introduite. C’est le sens de la lutte des classes d’hier et d’aujourd’hui.
Lutte économique
La reprise économique n’est pas nécessairement une mauvaise chose pour la lutte des classes. Cela peut même devenir une bonne chose, car après une longue période de souffrance économique, pendant laquelle la classe travailleuse dans une certaine mesure a été paralysée, cela peut déboucher sur une période de lutte économique. Par lutte économique, nous entendons une lutte contre le patronat pour l’amélioration des conditions de travail et de salaire de la classe ouvrière.
Par le biais de la lutte économique, les travailleurs tenteront de récupérer ce qu’ils ont dû céder au cours de la période précédente. L’amélioration de l’état des entreprises (carnets de commandes pleins, nouveaux clients, production tournant à nouveau à plein régime, nouvelles embauches, profits qui gonflent) fera que les travailleurs voudront lutter collectivement pour avoir leur part du gâteau.
La résistance à la norme salariale va se manifester dans les entreprises et dans les secteurs. La manifestation nationale interprofessionnelle de la FGTB contre la norme salariale de 1996 qui a eu lieu le 24 septembre est unique. Dans le sens que c’est assez rare qu’une organisation syndicale se lance dans une nouvelle mobilisation après avoir approuvé un accord marqué par la loi de 1996. Elle témoigne d’un mécontentement croissant de la base et d’une partie de l’appareil syndical face à cette norme salariale étouffante, alors même que l’économie se redresse. Surtout à un moment où de nombreux prix s’envolent : le gaz de 38,8 %, le diesel de 15,8 %, l’électricité et l’essence de 15,3 %. Non seulement les prix de l’énergie, mais aussi ceux des denrées alimentaires sont en forte hausse. Selon Test-Achats, les prix des denrées alimentaires augmentent en moyenne de 2 à 5 %. Certaines grandes marques augmentent même leurs prix de 10 à 12 %. Il n’y a donc plus de place pour la résignation et l’acceptation silencieuse. Le risque est grand que la manifestation du 24 septembre soit purement « démonstrative » et ne soit pas suivie de grèves dans les entreprises, du moins si on laisse l’initiative aux mains des appareils syndicaux. Les grèves de juillet chez Volvo Cars indiquent une tension croissante sur le terrain. Ce phénomène est également ressenti dans d’autres entreprises comme chez Brussels Airlines, où les syndicats viennent de déposer un préavis de grève. Afin de faire sauter le verrou salarial et améliorer les conditions de travail, des grèves nationales seront à nouveau nécessaires. Nous ne devons pas payer la relance par une baisse du pouvoir d’achat et des conditions de travail dégradées. L’heure n’est plus aux discussions de salon avec les patrons. Il est temps pour que les dirigeants syndicaux sortent de leur prostration et lancent le mouvement syndical dans une bataille d’envergure.