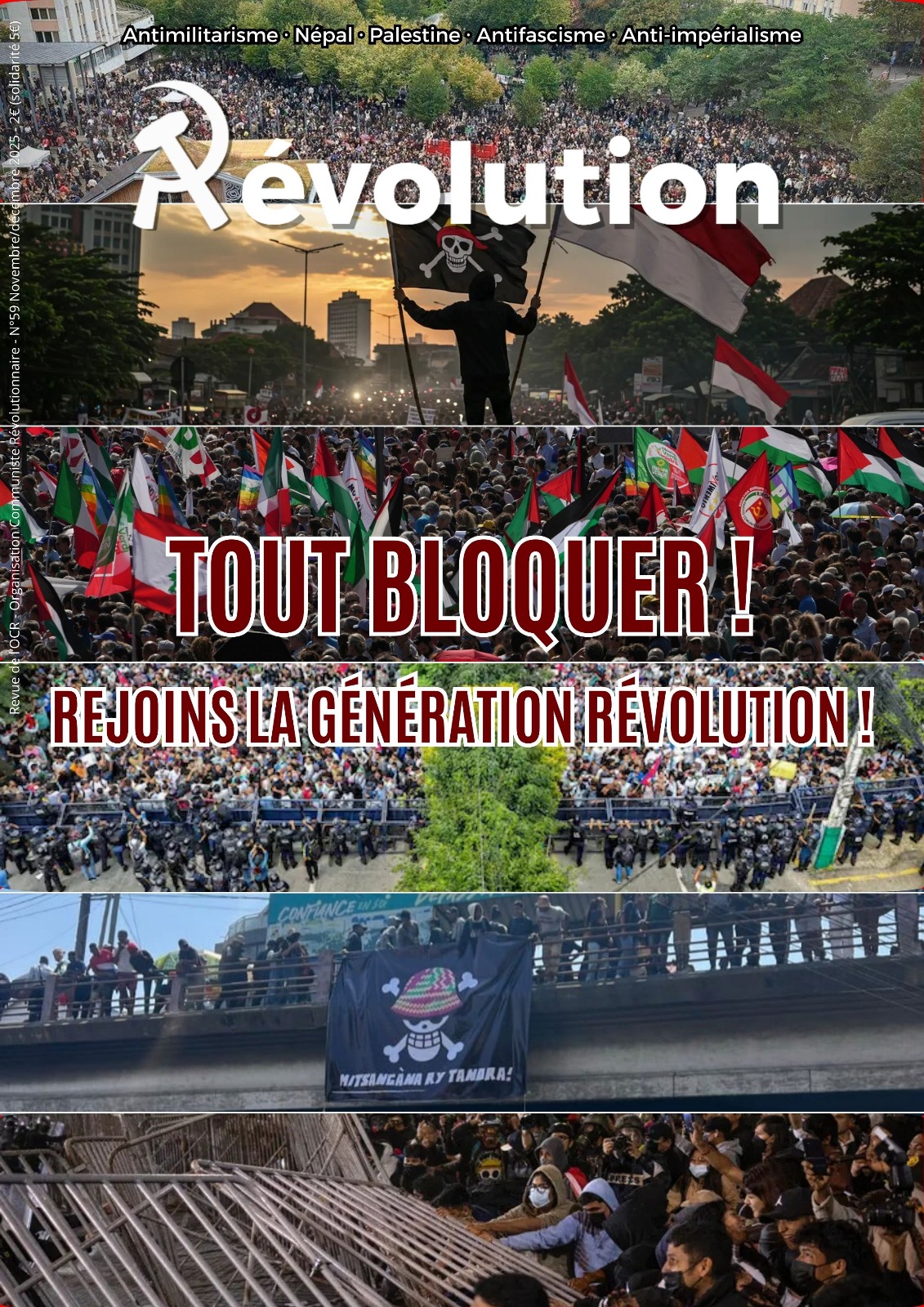Cela peut surprendre, mais la Belgique a une grande tradition de « grève générale ». Sous « grève générale », on entend aussi bien son expression la plus simple, telle que la grève nationale et interprofessionnelle de 24h du prochain 31 mars, que la grève nationale et interprofessionnelle de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les objectifs de ces grèves sont à la fois politiques et économiques. Leur trait commun est qu’elles concernent toute la classe ouvrière dans son ensemble. L’exemple classique belge est la grève de 1960-1961, qui a duré 5 semaines. En fait, la première grève générale en Europe a eu lieu en Belgique. Et ce n'est pas un hasard, parce que c'est en Belgique que se concentre, à la fin du 19ème siècle début du 20ème siècle, une classe ouvrière industrielle très importante.
Après l'Angleterre, la Wallonie et les centres urbains comme Gand et Anvers ont été les premières régions à être industrialisées sur le continent. La Belgique, à la fin du 19ème siècle, est la deuxième puissance industrielle au monde. Les premières grèves générales en Belgique ont été durement réprimées par l'armée et par la gendarmerie. Marx constate à l’époque « qu’il n’existe qu’un petit pays dans le monde civilisé où les forces militaires existent pour massacrer les grévistes et dans lequel chaque grève est volontiers prise comme prétexte pour massacrer officiellement les travailleurs. »
Citons quelques-unes des principales grèves générales. La première date de 1886. La grève a commencé suite à une commémoration de la Commune de Paris, qui avait eu lieu 15 ans auparavant. Quelques années plus tard, en 1893, une grève générale pour le suffrage universel dure 7 jours et s'étend dans tout le pays.
Au début du 20ème siècle, en 1902, éclate à nouveau partout dans le pays une grève générale de 7 jours pour mettre fin au système du vote plural en Belgique. En 1913, une nouvelle grève générale de 10 jours s’impose pour mettre fin au vote plural. Et entre les deux guerres mondiales, on va assister à des grèves encore plus importantes, avec une plus grande ampleur.
Par exemple, en 1932, une grève commence dans les régions minières du pays, d'abord en Hainaut, Mons, Charleroi, où les mineurs demandent une augmentation de salaire. Une grève spontanée, qui prend très vite des proportions insurrectionnelles. Elle va durer 30 jours.
En 1936, une grève générale aboutit au premier système de « congés payés », un peu à l’image de ce qu'il se passe en France au mois de juin. Elle va durer entre 20 et 30 jours. Elle obtient la réduction du temps de travail, la reconnaissance des syndicats et d'autres avantages.
Elle commencera d'ailleurs à Anvers, suite à l'assassinat de deux militants du syndicat du transport, Pot et Grijp, assassinés par des fascistes. Les deux militants sont dockers. Les dockers lancent alors une grève générale de 24 heures, qui s'étend rapidement au Hainaut et au reste du pays.
Après la Seconde Guerre Mondiale, on a eu la fameuse grève sur la question royale, au moment du référendum, pour le retour ou non du roi Léopold III. Celui-ci était le roi avant la Seconde Guerre Mondiale et était fortement identifié avec la droite, même l'extrême droite. Il n’avait pas hésité à exprimer sa sympathie pour Hitler et le fascisme. Pendant que le peuple belge souffrait sous la botte de l'occupation fasciste, il décidait allègrement de se marier. Lors du référendum de 1950, une majorité de travailleurs dans les grands centres urbains votent contre.
Cependant la majorité de la population vote pour le retour de Léopold III. Cela déclenche immédiatement une grève spontanée, d'abord en Wallonie, puis dans les grands centres urbains, et à nouveau à Anvers et Gand. Elle durera six jours.
Cette grève aboutit à la démission de Léopold III en faveur de son fils Baudouin. Puis il y a 1960-1961. C'est la fameuse « grève du siècle ».
La grève générale de 1960-1961 se développe contre la « Loi unique », une loi de régression sociale. Les gens l’appelaient à l'époque la « loi inique », la loi inégale, la loi injuste. Mais c'est aussi une grève générale, pas seulement contre quelque chose, mais pour une alternative de société.
Les grévistes revendiquent des réformes de structure anticapitalistes. Le contenu politique de cette grève est fortement influencé par une radicalisation dans le mouvement syndical, qui date des années 1950, et qui va aboutir à ce qu'ils appellent un programme de réformes de structure anticapitalistes.
Cette grève va durer 34 jours, partout dans le pays. Ce sera la grève d'un million de travailleurs. Puis plus tard, dans les années 1980, on assiste aussi à plusieurs grèves.
La plus importante, c'est celle des services publics, en septembre 1983, qui va durer deux semaines. Elle commence spontanément à l'initiative des cheminots de Charleroi et va s'étendre à tous les services et transports publics. Toute la Belgique sera paralysée. Cette grève commencera aussi à avoir un écho dans le secteur privé.
Même chose en mai-juin 1986, dans le secteur public d'abord, puis dans le secteur privé. Une série de grèves a également lieu en 2005. En 2012, une autre grève générale éclate. De quoi rétorquer aux esprits chagrins qui prétendent que « les Belges manquent de combativité » !
C'est un commentaire, comme le montrent les exemples ci-dessus, qui est basé surtout sur l'ignorance de notre propre histoire. Une histoire qui n'est pas enseignée, qui n'est pas transmise dans le mouvement syndical, qui ne fait pas partie d'un programme de formation de délégués, ni à la CGSP, ni à la CSC, ni à la FGTB, nulle part. A nous d’en prendre soin.