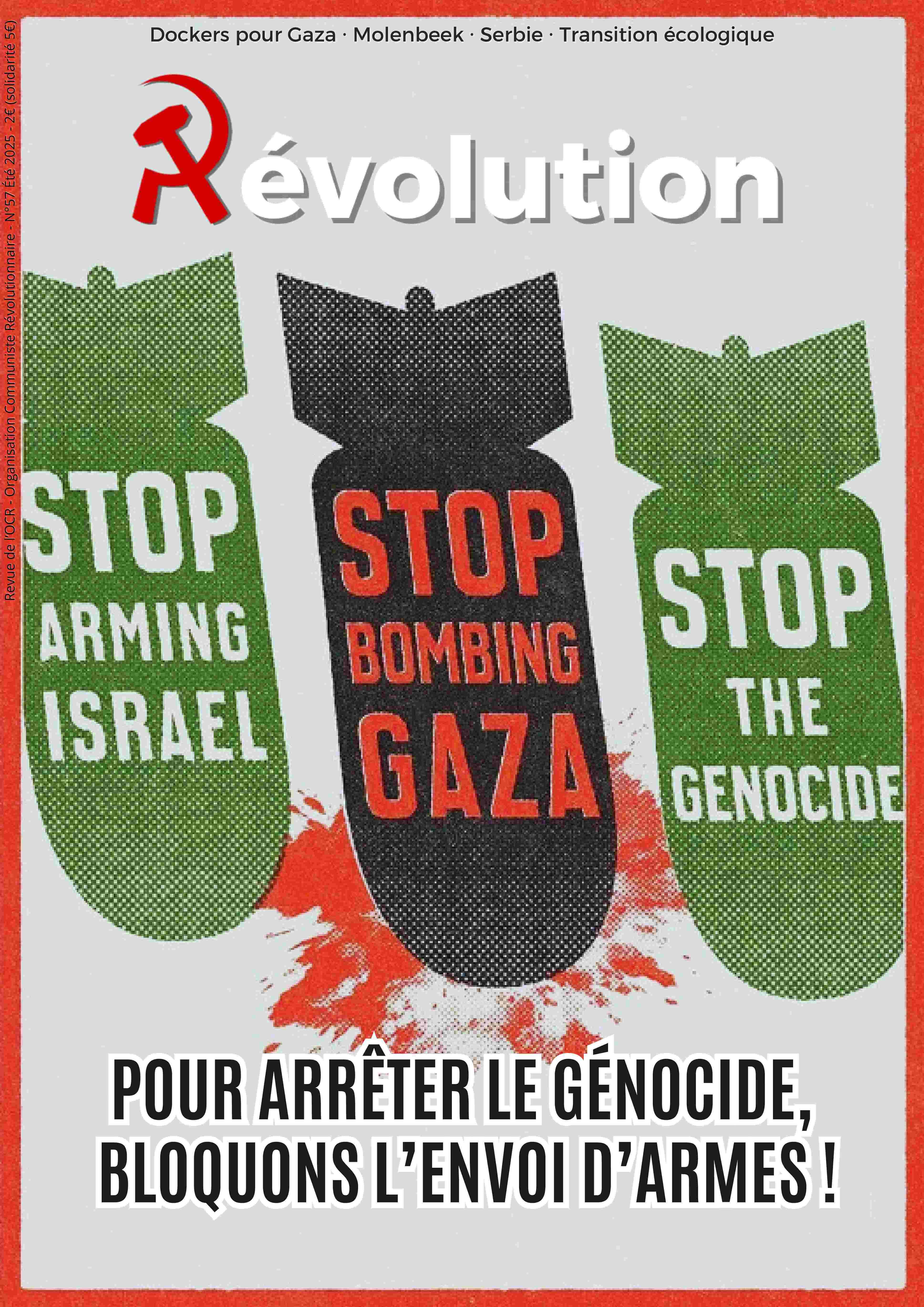J'étais il y a quelques mois en Amérique Latine et ce qui m'a frappé là-bas, c'est le clarté du langage politique. A gauche, on n'a pas peur d'employer certains mots. Ici, on parle de transformation sociale, là-bas, de révolution. Ce n'est pas du grand soir que l'on parle mais d'un processus, qui implique néanmoins une rupture. Un saut qualitatif si on veut. D'où les constituantes en Bolivie, en Equateur et il y a une dizaine d'années, au Venezuela. Ici, on parle de nantis, d'élites, là-bas on nomme l'adversaire avec clarté ; c'est l'oligarchie, la bourgeoisie.
Ici un tel langage sera rapidement qualifié de « langue de bois ». Pourquoi ? Parce que ce langage est faux ? Non, parce qu'il a perdu sa crédibilité lorsque les actes posés contredisaient les mots. Bref, quand la gauche n'a pas tenu ses engagements, au pouvoir mais aussi dans les luttes. La « langue de bois », c'est aussi manquer de nuances, certes, mais à force de nuancer, on devient inaudible. Sur la défensive, la gauche a tenté de changer de vocabulaire, de renommer les choses autrement afin de contourner la disqualification dont elle est l'objet. Même dans la gauche radicale, ce phénomène s'est développé. On ne parle plus de nationalisations mais d'appropriation sociale. On parle de souffrance au travail et non d'aliénation, d'exploitation. Je ne vais pas en faire l'inventaire ici ce serait trop long. Mais je pense que notre langage a été saturé par des euphémismes, ce qui tend à le rendre incompréhensible. Or, en face, avec ou sans Sarkozy, on avance masqué, on ment, on trompe, on détourne l'attention. Et si on veut démasquer les mensonges de la droite, il faut parler clairement, il ne faut pas avoir peur d'être caricatural. D'autant que les actes sont là : oui il y a bien une lutte des classes et elle se mène de deux côtés.
C'est mon premier point : on ne pourra résister à l'offensive du MEDEF, de Sarkozy, qu'en parlant clairement.
Le capitalisme ne surmonte ses crises périodiques que par une fuite en avant, l'accumulation du capital a besoin de paupériser les classes laborieuses ; le capitalisme a besoin de nouvelles marchandises et va donc marchandiser la terre, l'eau, l'oxygène que l'on respire (je pense aux droits de pollution qui s'achètent et se vendent) ; le corps, le cerveau, c'était déjà le cas sous la forme de la force de travail. Maintenant, cela va plus loin.
Pour maintenir ce système, il applique les mêmes recettes : diviser pour régner ; la carotte et le bâton. La « carotte », pour moi, c'est la féerie marchande (Marx parlait du fétichisme de la marchandise) qui répond à l'aspiration de bien vivre par une consommation aliénante. La jeunesse, le monde ouvrier aussi, sont soumis à cette offensive culturelle où les objets de consommation de luxe sont les uniques marqueurs de l'existence sociale. Et puis il y a le bâton, pas seulement les CRS mais aussi la sanction sociale, la stigmatisation des faibles, des pauvres, comme parasites, les loosers, les handicapés sociaux. L'incantation de la valeur travail sert a nous désolidariser les uns des autres. Avec la valeur travail façon Sarkozy, on occupe la position sur l'échelle sociale que l'on mérite… Bref, l'hiérarchisation sociale est une donnée naturelle et la compétition un facteur de dynamisme, de sélection. En haut les forts, en bas, les faibles…
Pour résister à cette offensive culturelle, il faut défendre d'autres valeurs, une culture du vivre ensemble où chacun prend soin de soi et des autres ; la solidarité, la fraternité, la sororité ; dans le présent comme dans le présent à venir. Dans la vie quotidienne comme au niveau d'un projet politique. Le communisme (ou le socialisme) prend ici tout son sens. Il est d'une actualité absolue. C'est mon second point.
Au 19ème siècle, la solidarité était une nécessité. Solidarité de classe, solidarité entre opprimés et exploités. Aujourd'hui, la solidarité redevient indispensable et petit à petit la conscience que l'on ne peut pas s'en sortir tout seul gagne du terrain. C'est pourquoi en face, on cherche tellement à diviser pour régner. Car il faut désunir le monde de celles et ceux qui pourraient se révolter, et qui inéluctablement se révolteront. Diviser pour régner, c'est opposer français aux résidents étrangers, travailleurs avec et sans papiers, actifs et chômeurs, jeunes et personnes âgés ; c'est agiter l'épouvantail des classes dangereuses, aujourd'hui ce sont les habitants des cités.
La volonté de diviser pour régner est masquée par une idéologie, le libéralisme autoritaire. Or, l'idéologie dominante colonise peut-être les esprits, mais elle ne change pas la réalité. Gramsci, que Sarkozy aime citer pour dire que les batailles se gagnent d'abord par la lutte des idées ; et bien, Gramsci disait aussi que l'hégémonie idéologique du capitalisme se fissure à partir de l'expérience concrète, le vécu quotidien. Et le vécu d'un très grand nombre – en fait, le vécu de la majorité de la population — est un vécu où l'on perd sa vie à la gagner, où les conditions d'existence se durcissent et se dégradent, mêmes pour les bacs +5, pour les techniciens, les cadres. Une condition sociale où les choix se réduisent ou requièrent des sacrifices. Les économistes disent que l'ascenseur social est en panne, les jeunes des cités disent « on est dans la nasse ». Il existe donc une communauté d'intérêts entre ce gens-là ; ils appartiennent à une même classe, la classe « en soi ». Ce sont, nous sommes, des semblables différents. Objectivement, nous sommes unis par le sort que le système nous impose.
Vous, ici rassemblés, savons pourquoi il en est ainsi ; pourquoi les conditions de vie se dégradent. Mais celles et ceux qui ne savent pas, qui pensent peut-être que les inégalités et les injustices ont toujours existé, et bien ces mêmes personnes n'accepteront pas éternellement les injustices qui leur sont imposées. C'est pourquoi on a connu et on connaîtra des révoltes, surtout en France où c'est une tradition.
Mais pour aller plus loin que la révolte, que l'indignation, il faut aussi lui donner un sens, politique bien sûr. C'est dire contre quoi l'on se révolte, dire ce que l'on combat. Certains seront tentés de prendre le néo-libéralisme pour cible. OK, mais on sait aussi que le « néo-libéralisme » est un programme de combat dont la finalité est de pérenniser un système inhumain qui menace désormais la survie même de notre écosystème qu'est la terre. En parlant de néo-libéralisme, on a mis en évidence la cohérence d'une période de contre-réformes visant à démanteler les conquêtes sociales. Mais, en ne parlant qu'en ces termes de libéralisme et d'anti-libéralisme, on s'interdit de porter la critique plus loin, de remettre en cause le système et on s'interdit donc de proposer une vraie perspective révolutionnaire qui propose une alternative, un autre horizon, le socialisme.
Et sans la perspective d'un autre système social, économique, politique, on ne peut faire que trois choses : 1). courber l'échine et se résigner ; 2). passer dans le camp adverse et défendre le système 3). le corriger, l'amender, bref jouer à l'ambulance sociale.
Mais cette troisième option, celle du réformisme, ne fonctionne plus. Pourquoi ? Deux raisons l'expliquent. Primo, historiquement, les réformes ont été concédées ou arrachées, sous le rapport de force ou lorsqu'il fallait faire des concessions. L'Etat-providence, la sécurité sociale, l'échelle mobile des salaires, les services publics ont été crées peu après la seconde guerre mondiale. Il fallait éviter que le communisme gagne les masses et accède au pouvoir en Europe de l'Ouest. Il a donc fallu faire des concessions de type structurelles. Aujourd'hui, bon nombre de ces concessions sont dysfonctionnelles par rapport à la guerre de concurrence économique mondialisée.
Le réformisme de la social-démocratie, c'est se limiter aux réformes que le capital veut bien concéder et c'est refuser d'aller plus loin. Aujourd'hui, le capital ne peut et ne doit plus rien lâcher. La social-démocratie n'est donc plus réformiste. Pour l'être, il faut oser penser une alternative à ce système et il faut donc être révolutionnaire. Ceci est surtout vrai pour les organisations politiques, pour les salariés, changer leur conditions de vie est une nécessité, même et surtout pas de réformes immédiates.
Dire les choses telles qu'elles sont, offrir une vision de société, n'est pas qu'une question sémantique, c'est une question de positionnement. Être en opposition à ce qui fait système, c'est devenir audible, visible et donc potentiellement écouté.
Faut-il un parti pour faire cela ? A cette question, je répondrai de manière positive. Roberto Michels a montré que la forme-parti est née avec le mouvement ouvrier. Le syndicalisme ne suffisait pas, même révolutionnaire. La démocratie délibérative est un élément de régulation du système mais aussi un champ de bataille. Les institutions le sont également. La forme-parti n'est pas nécessairement verticale, ni hégémonisante à l'égard des mouvements sociaux. L'expérience montre que, par-delà les fluctuations des luttes sociales ou des échéances électorales, un collectif militant doit perdurer. Faire des bilans et proposer des perspectives, programmatiques, revendicatives. Conserver et engranger des forces pour la bataille suivante. Certes, tout cela est un peu militaire. L'alternative est de recommencer à zéro à chaque fois et surtout répéter les mêmes erreurs.
Refuser la forme parti et lui préférer la forme mouvement, c'est un peu comme vouloir changer la société sans prendre le pouvoir. C'est une option mais elle relève d'abord d'une sorte de syndicalisme sociétal. Le syndicalisme est un contre-pouvoir, dans les entreprises ou sur le plan interprofessionnel. Dès lors que le syndicalisme cogère, il se dénature. Sur le plan politique, la question me semble différente même si on sait d'expérience qu'il ne suffit pas d'occuper un ministère ou deux pour changer la donne. Mener une lutte politique jusque y compris dans les institutions du système que l'on combat est un risque. Mais ne pas prendre ce risque, c'est aussi laisser d'autres remplir le vide. On ne peut le faire qu'en développant en parallèle d'autres institutions, nées de la mobilisation et qui démocratisent donc le pouvoir là où il est aujourd'hui monopolisé par une minorité. Dire cela, c'est dire également qu'un parti des communistes ne peut pas être un parti comme les autres. Qu'il est essentiel qu'il soit de toutes les luttes démocratiques et sociales, qu'il entretienne avec les mouvements sociaux un rapport dialectique, sans se diluer en leur sein ni masquer ce qui est sa spécificité, sa raison d'être, à savoir, agir pour un société libérée de la logique de profit, une société avec autant de libertés que d'égalité, une société socialiste, ici et ailleurs dans le monde.